
(House of Bamboo)
1955
Réalisé par: Samuel Fuller
Avec: Robert Stack, Robert Ryan, Yoshiko Yamaguchi
Film vu par nos propres moyens
Une guerre s’achève-t-elle réellement après la capitulation des pays vaincus ? Pour le Japon, au sortir de la Seconde Guerre mondiale et des terribles bombardements de 1945, rien n’est moins sûr. Si la barbarie du pouvoir politique nippon durant le conflit a de quoi révulser au plus haut point, la douleur de la population perdure durant les 7 années suivantes, alors que les forces militaires américaines occupent le territoire. La mission des USA semble louable sur le papier, avec en point de mire la tenue d’élections libres, mais une succession de décisions malheureuses de la part des troupes de MacArthur, associée à une forte précarité des civils, pèsent sur le moral des japonais. Ville dévastées, explosion de la prostitution, corruption et marché noir font de cette période une ère sombre pour le Japon. Fort heureusement, le traité de San Francisco, en 1951, et le “miracle économique” de l’archipel mettront fin à cette triste période, encore mal perçue aujourd’hui, faite d’une forme de détresse à laquelle de nombreux cinéastes japonais ont fait écho.
En 1955, le réalisateur américain Samuel Fuller pose sa caméra dans ce pays alors en pleine transition entre ces dures années et l’émancipation, mélangeant symboliquement personnages américains et nippons. Il y tisse un polar très proche du film noir, dans lequel l’inspecteur Eddie Kenner (Robert Stack) infiltre un gang de bandits américains établi au Japon, à la suite d’une macabre attaque de train. Progressivement, le héros gagne les faveurs de Sandy (Robert Ryan), le patron de l’organisation criminelle, mais il succombe également au charme de Mariko (Yoshiko Yamaguchi), une jeune femme du pays qui l’envoute.

Au premier abord, le film de Samuel Fuller prend des accents touristiques surprenants aux vues de son histoire, alors que le cinéaste se fait le témoin de la majesté des décors nippons. La Maison de bambou est l’un des premiers films américains tournés au Japon et le réalisateur en a conscience: le dépaysement est l’un des moteurs de son film, une étape cruciale dans le pacte qui unit l’artiste et son public. Le long métrage regorge ainsi de plans sur des monuments emblématiques et sur des échoppes typiques étrangement idylliques. De quoi dérouter un peu le spectateur au fait des événement historiques, mais considérer La Maison de bambou comme un film biaisé serait pourtant une grave erreur: oui, Samuel Fuller doit se conformer aux codes de son époque et ne peut pas risquer de se frotter à une censure qui ne tolère pas, en pleine Guerre Froide, d’altérer l’image des USA. C’est donc avec subtilité que le metteur en scène fait passer une succession de messages politiques à peine voilés, relevant parfois du constat, d’autres fois du souhait. Ainsi, la coopération entre la police américaine et japonaise qui initie l’enquête peut paraître fantasmée, sauf si on intègre la volonté de Samuel Fuller d’y voir une forme de solution au crime organisé qui gangrène le pays. La criminalité est le fléau de cette époque, et sa résolution passe par une réponse collective.

Le cinéaste propose également un grand écart à travers le temps. Le Japon qu’il nous montre est tourné vers le passé: au cours d’une scène cruciale où Eddie rend compte à ses supérieurs, c’est devant la gigantesque statue d’une divinité asiatique que la réunion a lieu. Les dieux regardent les jeux des humains, écrasent de leurs poids les protagonistes, et la volonté d’offrir des visuels en contre plongé accentue ce sentiment. À plus fortes raisons, les rituels ancestraux nippons sont souvent mis en scène avec une forme de volupté dans les mouvements de la caméra, témoignant de l’amour de Samuel Fuller pour le Japon. Mais le futur n’est pas oublié et c’est un rutilant parc de loisirs moderne qui est le terrain de l’affrontement final. En quelques dizaines de minutes, le réalisateur à tiré un trait d’union entre les époques, témoin subtil des années d’occupation et de leur fin.
Une autre volonté, d’apparence anodine, résonne différemment à la lumière de l’Histoire: celle de faire de l’antagoniste du film, et de sa bande, de purs américains. La Maison de bambou occulte presque complètement le monde des yakuzas pour montrer un mal issu du pays de l’oncle Sam. Pire, ces malfrats vivent de l’exploitation des japonais, et notamment du racket des établissements de pachinko, ce jeu de hasard typique de l’archipel. L’Amérique pille les richesses asiatiques sans redistribuer quoi que ce soit, comme de vils tortionnaires. L’attitude de Sandy le souligne un peu plus: le plus souvent vu comme une figure paternelle exagérément aimante pour ses hommes, allant jusqu’à se soucier de leur stress, il est également sévère, voire sadique, avec les femmes japonaises. La Maison de bambou dénonce implicitement les égarements des années MacArthur.

L’équilibre ne se vit donc qu’à travers Eddie, lui frappé par l’amour. La Maison de bambou est presque autant une romance qu’un film policier, et l’idylle avec Mariko est un axe essentiel à l’accomplissement de l’œuvre. Là où les malfrats traitent les femmes en bétail, les surnommant “Kimono”, le détective infiltré fait lui preuve de pudeur devant celle qui se trouve mêlée aux tourments de l’intrigue. Samuel Fuller chercherait-il toutefois à montrer que cette passion sincère est imbécilement vue comme un tabou par ses contemporains ? Il est légitime de le penser, compte tenu du secret dans lequel la romance s’épanouit, mais également dans la mise en image du cinéaste. Les scènes qui unissent les deux personnages sont souvent nocturnes, dans la pénombre de la chambre à coucher, parfois filmées à travers un rideau. Toujours est-il que Eddie est un personnage ambivalent: sa peau est blanche, ses employeurs réels et fictifs américains, mais il montre à l’image un attachement au Japon, comme lorsqu’il revêt un habit traditionnel, ou au moment de consommer des plats nippons.
L’écartèlement moral du héros se traduit à l’image. Si Samuel Fuller est relativement discret caméra en main, ses gestes de réalisation n’en sont que plus marquants. Régulièrement, le cadre se resserre rapidement sur Eddie comme si on se jetait sur lui, jusqu’à l’étouffer. Dans la scène du marché, le cinéaste propose même un surcadrage en guise de plan initial, avant de zoomer et de casser la fausse stature ainsi installée. La Maison de bambou emprunte le langage filmique du thriller, mais cet effet d’étouffements peut s’extrapoler aux américains de son époque, amoureux de l’Asie, mais contraint dans l’expression de cette passion par les diktats de leur pays.

Bien que forcé de se plier aux exigences de son temps, La Maison de bambou porte perpétuellement en lui un message politique latent, qu’il faut savoir tirer au clair à la lumière de l’Histoire. Samuel Fuller, habile dans ce jeu d’équilibriste, livre un divertissement prenant, au fond intriguant.
La maison de bambou est disponible en édition collector chez ESC.





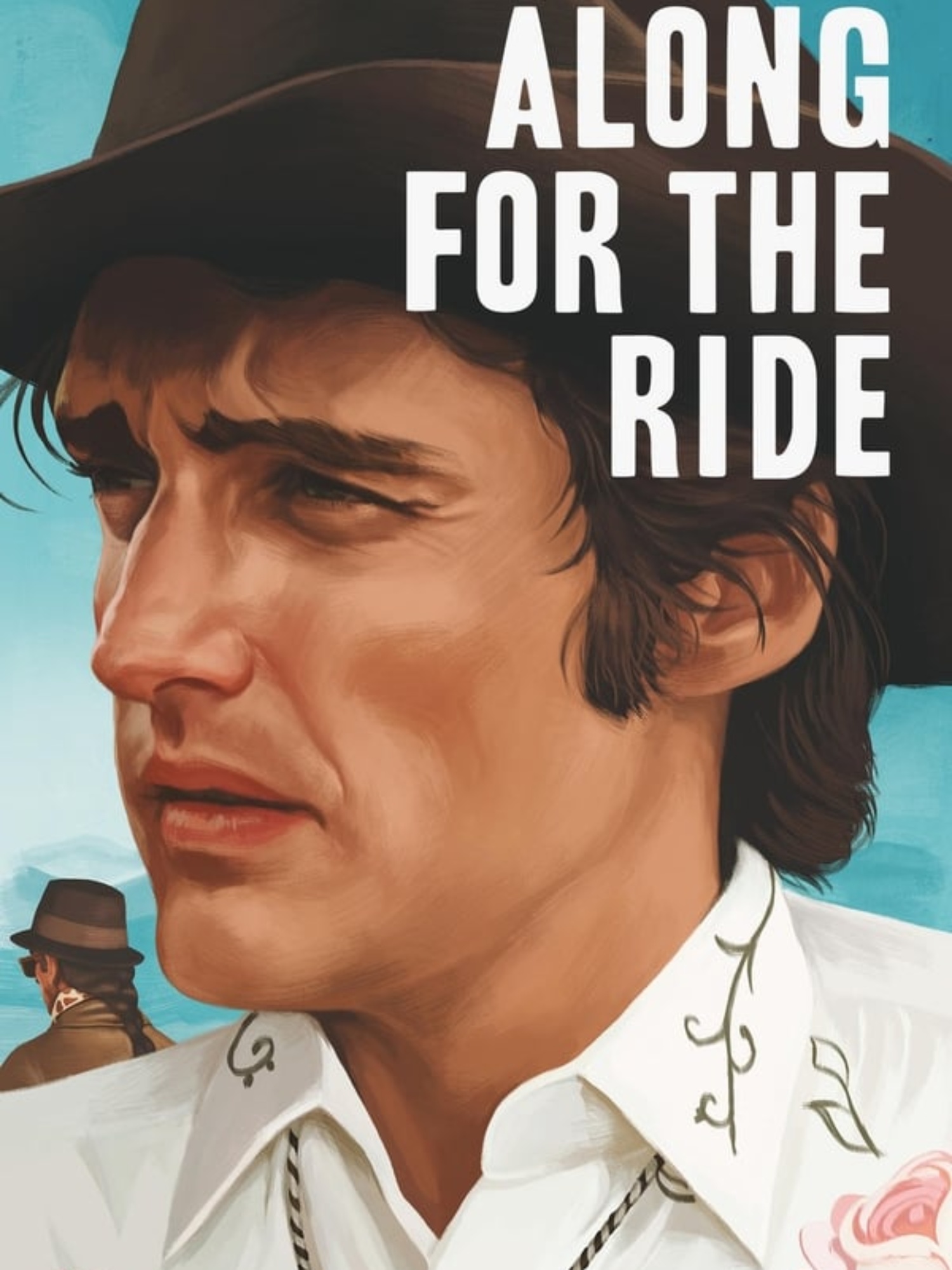

Ping : Un homme est passé - Les Réfracteurs