
2022
Réalisé par Todd Field
Avec : Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss, Sophie Kauer
Film vu par nos propres moyens
Réalisateur de 2 précédents films aussi inconfortables que son nouvel opus, Todd Field aime filmer les situations ambiguës et les relations non conformes. 16 ans séparent Little Children de Tàr. C’est peu de dire que ce film est un objet complexe. Par son aspect glacial, par son sujet élitiste et par ses dialogues d’initiés, le film peut ainsi repousser et laisser à la porte ceux qui ne se sentent pas suffisamment connaisseurs pour s’intéresser à ce sujet. Complexe aussi parce qu’à la première vision, le film paraît donner peu de clés de compréhension, laissant le spectateur à ses interrogations quant aux intentions du réalisateur. L’un y verra telle interprétation, l’autre y verra un sens parfois totalement opposé.
Lydia Tàr est une cheffe d’orchestre de renommée internationale au pic de sa carrière. Elle s’apprête à compléter l’enregistrement des 9 symphonies de Mahler avec le prestigieux philharmonique de Berlin. Mais une ombre plane sur les succès de Tàr, une ancienne protégée et amante éconduite qui la harcèle de mails et d’appels, et qui la suit.
Il y a plusieurs morceaux de bravoure mémorables dans le film, l’un des plus remarquables est un plan-séquence de 10 minutes lors duquel, Lydia Tàr déroule un discours devant les élèves de la prestigieuse Juilliard School. Dans ce quasi monologue, la cheffe s’oppose à la posture d’un jeune apprenti qui refuse de jouer Bach au prétexte que le compositeur était un mâle blanc, misogyne et père d’une famille très nombreuse. Évidemment, l’ascendant professionnel et culturel de Tàr, sa manière de s’accaparer l’espace et la parole, rend la réponse impossible pour cet élève très dans l’air du temps. Ce que Lydia Tàr soutient, c’est que les aspirants chefs d’orchestre doivent choisir des compositeurs qui ont une intention et peuvent donc être réinterprétés.
Lorsque sa vie échappe à Tàr, plus loin dans le récit, ce long monologue sans coupure est remonté, réduit et déformé par un adepte de ce qu’elle reproche à son élève récalcitrant, les réseaux sociaux. Lors d’un déjeuner avec une jeune violoncelliste, cette dernière explique qu’une partie de son éducation musicale s’est faite via YouTube. Tàr, déconcertée, se laisse peu à peu dépasser par la modernité.
Le film a une tendance irritante à citer des noms en permanence, à se référer à des personnalités connues d’un certain milieu ultra privilégié, mais obscures pour les néophytes. Les citer, c’est donner un mot de passe pour manifester qu’on appartient bien à ce monde. Certains spectateurs se sont posé la question de l’existence de Lydia Tàr et la confusion est compréhensible car le moindre nom cité est celui d’une personne réelle. Ainsi, le spectateur qui connaît Egon Brandstetter (tailleur), René Redzepi (chef cuisinier), Anna Thorvalsdóttir (compositrice) et autre Samantha Hankey (mezzo-soprano), sera satisfait de comprendre les références. Mais le spectateur qui n’y connaît pas grand-chose peut se sentir poussé vers la sortie. Or, ce serait une erreur d’interprétation.
Car si Lydia Tàr cite des noms, cite des poèmes, c’est pour renforcer le personnage qu’elle s’est créé, pour mieux se fondre dans la masse d’un monde dans lequel elle s’est fait une place mais dont elle n’est pas originaire. Son véritable nom est Linda Tarr, ses origines sont très modestes. À son élève de Juilliard, voici ce qu’elle dit : « Si vous voulez faire la danse du masque, vous devez servir le compositeur, vous devez vous sublimer, vous, votre ego, et oui, votre identité. Vous devez faire face au public et à Dieu, et vous effacer. » C’est effectivement ce qu’elle a fait, porter un masque, se sublimer (passer d’un état solide à un état gazeux, autrement dit inconsistant, insaisissable) et s’effacer. Tàr joue un rôle permanent, elle s’est modelée une image changeante. La première séquence du film entremêle la présentation de sa carrière, – en fait une page Wikipedia, discours visiblement bien rodé puisque son assistante Francesca le connaît par cœur – et la confection d’un costume en vue d’une séance photo pour l’illustration d’un prochain album. Cette pochette d’album est identique à celle de Claudio Abbado pour son édition Deutsche Grammophon de la Symphonie n°5 de Mahler. Dans l’appartement qui lui sert de garçonnière, Lydia se fait livrer les mêmes fauteuils rouges, fait relier la partition de la même couverture verte. Puis elle s’installe face à la glace et prend la pose. Elle lève les yeux pour vérifier si l’imitation est bonne. Et pour ajouter à l’enchevêtrement de la fiction et de la réalité, un concept album du film est sorti chez Deutsche Grammophon avec cette photo de Cate Blanchett/Lydia Tàr en Claudio Abbado.
Cet aspect du personnage se retrouve également dans son genre, un genre qui, semble-t-il, change selon les scènes. Ainsi, lors d’une interview elle discute de la place négligée des femmes dans le monde des chefs d’orchestre, regrette la relégation de certaines au rang d’artistes invitées. Dans la scène suivante, elle s’empresse de proposer d’ouvrir aux candidatures masculines la bourse qu’elle a créée en soutien aux artistes féminines. Au sein de sa famille, elle reproduit un schéma très patriarcal, se présente comme le père de sa fille Petra, et possède une tasse sur laquelle il est écrit « Dad ». Dans un geste de séduction enfin, elle détache ses cheveux face à une jeune femme qui lui plaît. Cette fluidité du genre souligne la dualité du personnage, en permanence confronté à des reflets, un personnage qui se remplit de l’image des autres, un personnage miroir. Après avoir cherché à imiter ses maîtres, Abbado et Bernstein, elle écoute une animatrice radio et imite les intonations de voix de celle-ci. Ou encore, elle fait l’éloge du sac rouge d’une admiratrice, et quelques plans plus tard, la voilà en possession de l’exact même sac. Pourtant, elle ne cesse de repousser les tentatives d’un de ses collègues qui voudrait lui soutirer ses secrets de cheffe d’orchestre : « Il n’y a pas de gloire à être un robot Eliot, fais ton propre truc. » De même, elle se désespère d’apprendre que même un compositeur incontestable comme Beethoven a copié Mozart. Pour ce personnage qui veut maîtriser absolument l’image qu’elle renvoie, le montage de son discours à Juilliard raccourci et réinterprété, est une gifle douloureuse et le signe que le contrôle lui échappe.
Le film présente une structure parfois symétrique, en tout cas géométrique. Il commence et se termine par un générique sur fond noir. La silhouette de Krista ouvre et ferme une séquence d’interview. Certains plans se répètent avec variations pour signifier l’évolution de la situation du personnage, comme les trajets en voiture, le jogging matinal, les conversations au restaurants, les réveils en pleine nuit. Dans la garçonnière, une photo au mur est disposée à l’endroit dans une pièce, et à l’envers dans l’autre. Le nom de “Tàr” est inversé pour devenir “Rat”. Certaines scènes se répondent non seulement à l’image mais aussi au son, comme si le film se constituait d’échos : dans un parc, Lydia entend des hurlements de femme et tente infructueusement d’en repérer l’origine. Puis dans un squat, elle entend un chant de femme et se laisse guider par la voix à travers un dédale souterrain ; un marteau-pilon marque un rythme, dans le plan suivant, on aperçoit l’affiche du spectacle Stomp en arrière-plan (spectacle où le rythme naît des bruits de la rue et du quotidien) ; dans un couloir d’hôtel, des femmes changent les draps, le geste et le claquement du linge sont répétés à l’identique. Et puis bien sûr, les circonvolutions de l’appartement labyrinthique de Lydia répondent aux dessins qu’elle voit partout et qui ne sont pas sans rappeler le motif étouffant de la moquette de l’Overlook Hotel dans le Shining de Kubrick.
Ces motifs sont inspirés de l’art Shipibo-Conibo, un peuple de la Haute-Amazonie péruvienne, connu pour ses dessins aux formes labyrinthiques. Ceux-ci sont révélés à travers des rêves faits après l’ingestion d’une plante psychotrope. Une autre pratique des Shipibos est de souffler de la fumée de tabac sur une personne atteinte d’un mal ou de lui chanter un air rapporté d’une plongée dans les rêves. Tàr a chez elle une photo d’un chaman qui lui souffle dessus. Au début du film, on entend un chant shipibo dont le titre est « cura mente », « guérir l’esprit ».
Dans la croyance de ce peuple, Ronin, le grand serpent, est l’être divin le plus puissant, il est associé à l’eau, il est à l’origine de toute chose. Lydia rêve de Ronin lors d’un plan onirique furtif. Quant à ce rituel du souffle, il explique peut-être les tocs étranges de la cheffe d’orchestre lorsqu’elle allume des bougies ou lorsqu’elle s’apprête à monter sur scène. Quel mal peut bien la ronger ? Qu’essaie-t-elle de chasser ?
Le film nous donne une clé dès le premier plan. Un portable la filme, sans doute est-ce Francesca qui converse avec Krista. Pour définir Lydia, elle utilise le mot « Haunted », hantée, ce à quoi son interlocutrice répond « Tu veux dire qu’elle a une conscience ». En réalité, il faut prendre le terme littéralement : Tàr est aussi un film de hantise. Ce personnage est très seul, s’isole volontairement, même de sa propre famille en se réfugiant dans cette garçonnière berlinoise. Elle a de nombreux face-à-face individuels, excepté lorsqu’elle dirige son orchestre, lorsqu’elle dispense un cours ou lorsqu’elle est interrogée, et même là, elle est séparée des autres. Lorsqu’elle est seule dans le plan, Todd Field fait entrer les autres personnages par des amorces silencieuses. Ces amorces sont une intrusion physique dans un espace précieux pour Tàr. Cela lui est si insupportable qu’elle sursaute quand son épouse Sharon entre dans son espace pour lui parler. Plus tôt, lorsqu’elle arrive dans l’appartement familial, elle surprend sa fille cachée dans son bureau – chose défendue – dissimulée derrière le voilage de la fenêtre, prenant l’aspect d’un fantôme dans sa représentation la plus basique. Un fantôme, il y en a un vrai dans le film, Krista évidemment, qui assaille Lydia de diverses manières. L’envoi du roman « Le Défi » de Vita Sackville-West, histoire d’amour entre deux femmes dissimulée sous un récit qui fut censuré à l’époque de sa publication, des ornements shipibo-conibos, des bruits parasites, des rêves, et, en arrière-plan ou en amorce, la présence de Krista elle-même.
Il semble que le film se déroule sur un plan psychique. Nous sommes à l’intérieur de l’esprit de Lydia. Les bruits et les choses qui la troublent sont à l’intérieur de sa tête et elle les extériorise. Une scène est parlante à ce propos : elle se blesse en trébuchant du haut d’un escalier et la voilà qui raconte qu’elle a été agressée et qu’elle s’est battue. Devant son orchestre, il lui faut diriger et c’est alors qu’elle se met à gesticuler comme si elle reproduisait le combat imaginaire qu’elle vient d’inventer : elle amène sa fiction dans la réalité des autres.
Lors d’un déjeuner entre elle et une nouvelle violoncelliste, Lydia emmène la jeune femme dans un restaurant prestigieux de Berlin où sont venus tous « les fantômes du passé ». Olga, la jeune musicienne n’est visiblement pas très impressionnée, ne connaît pas Barenboïm et n’a pas grand intérêt pour Rostropovitch. La jeune génération qu’elle croise n’a que faire des maîtres du passé, et qu’ils aient tort ou raison n’est pas vraiment l’enjeu. Le défi de Tàr est qu’elle s’est construite en référence au passé, qu’elle n’a cessé d’imiter les modèles d’avant, qu’elle s’est – comme elle le dit – oblitérée. Mais qu’apporte-t-elle de nouveau, elle qui n’arrive pas à composer un seul morceau ? Qui est-elle ? Qui est Tàr ?
La réponse est hors du film. Lors de la séquence de conclusion, la mise en scène nous montre une Tàr dupliquée à l’infini grâce à un jeu de miroirs. Dans le plan suivant, on retrouve l’aspect d’infini par un effet de correspondance visuelle à travers une enfilade de portes que Tàr franchit, s’enfonçant au plus profond de l’image. Sa silhouette noire est vêtue d’un ensemble banal loin des costumes sur-mesure du début, elle est remise à zéro. Ce n’est pas elle que le public est venu voir, elle est applaudie mollement, et ce n’est plus elle qui donne le tempo mais l’écran qui s’abaisse derrière l’orchestre pour la diffusion d’un film.
Lorsque le film commence, la trajectoire de Tàr est déjà finie, voilà pourquoi le film commence par un générique de fin. Ce que nous voyons n’est pas le récit d’un succès et d’une chute, cette dernière est déjà amorcée. La chanson shipibo que nous entendons, intitulée « Cura Mente », fait effet pendant le film et c’est à la guérison éprouvante de la cheffe d’orchestre que nous assistons. À la fin, rentrée chez elle, elle se rappelle ce qui l’a sans doute séduite autrefois dans la musique, à travers les mots de Leonard Bernstein. Non pas ce badigeon intellectuel qu’elle a rabâché pendant 2H30, mais l’approche sensible et parfois indicible de l’art. Après ce retour aux sources symbolique, elle se plonge cette fois physiquement dans l’eau d’une rivière, lieu et symbole de la renaissance chez les Shipibos. Elle accepte d’entamer cette « nouvelle histoire » préconisée par le communiquant de la CAMI. Cette fin qui peut être interprétée comme une humiliation et un anéantissement n’est ainsi peut-être pas un crépuscule mais un recommencement.

Tár est actuellement au cinéma.


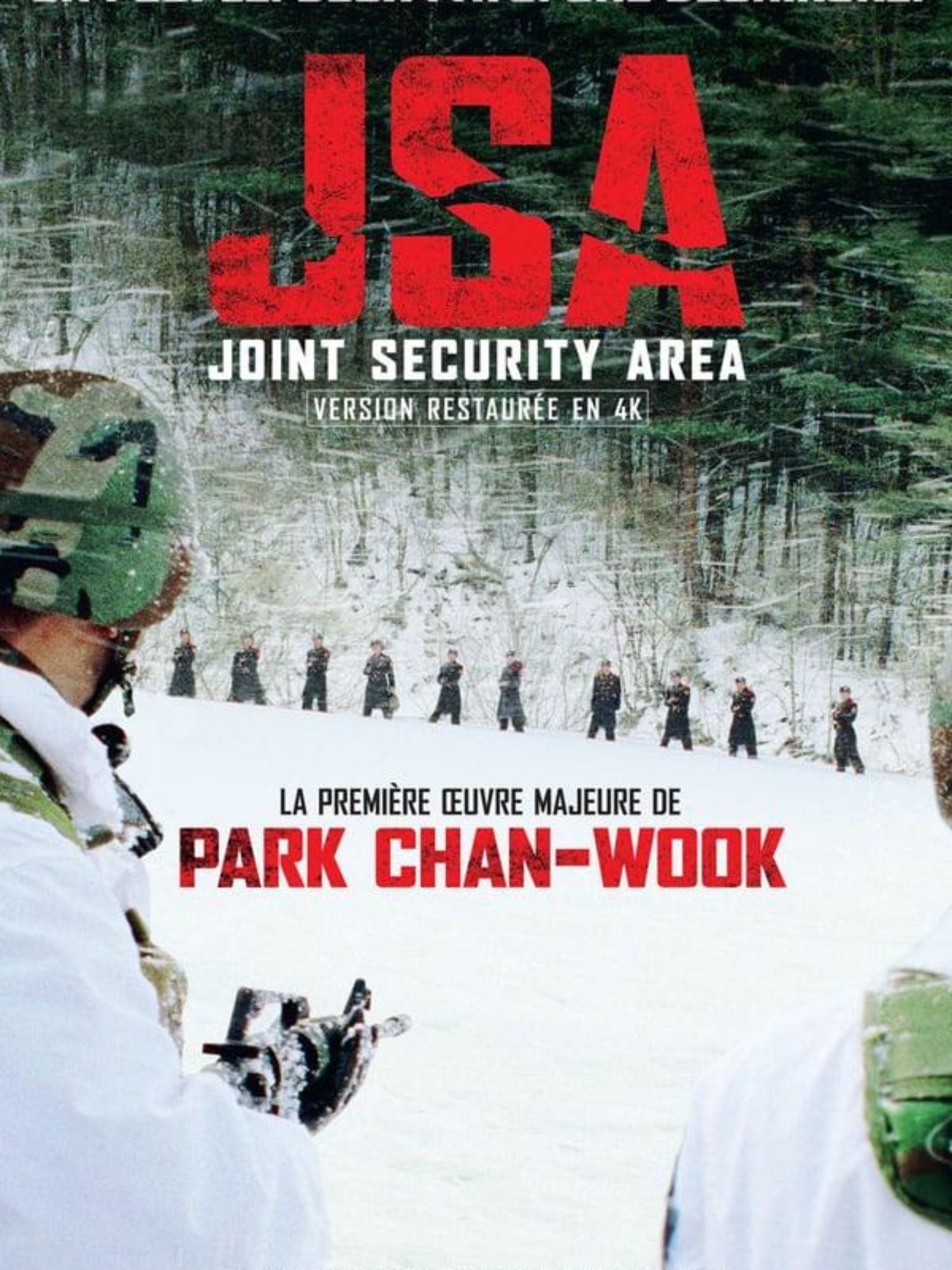

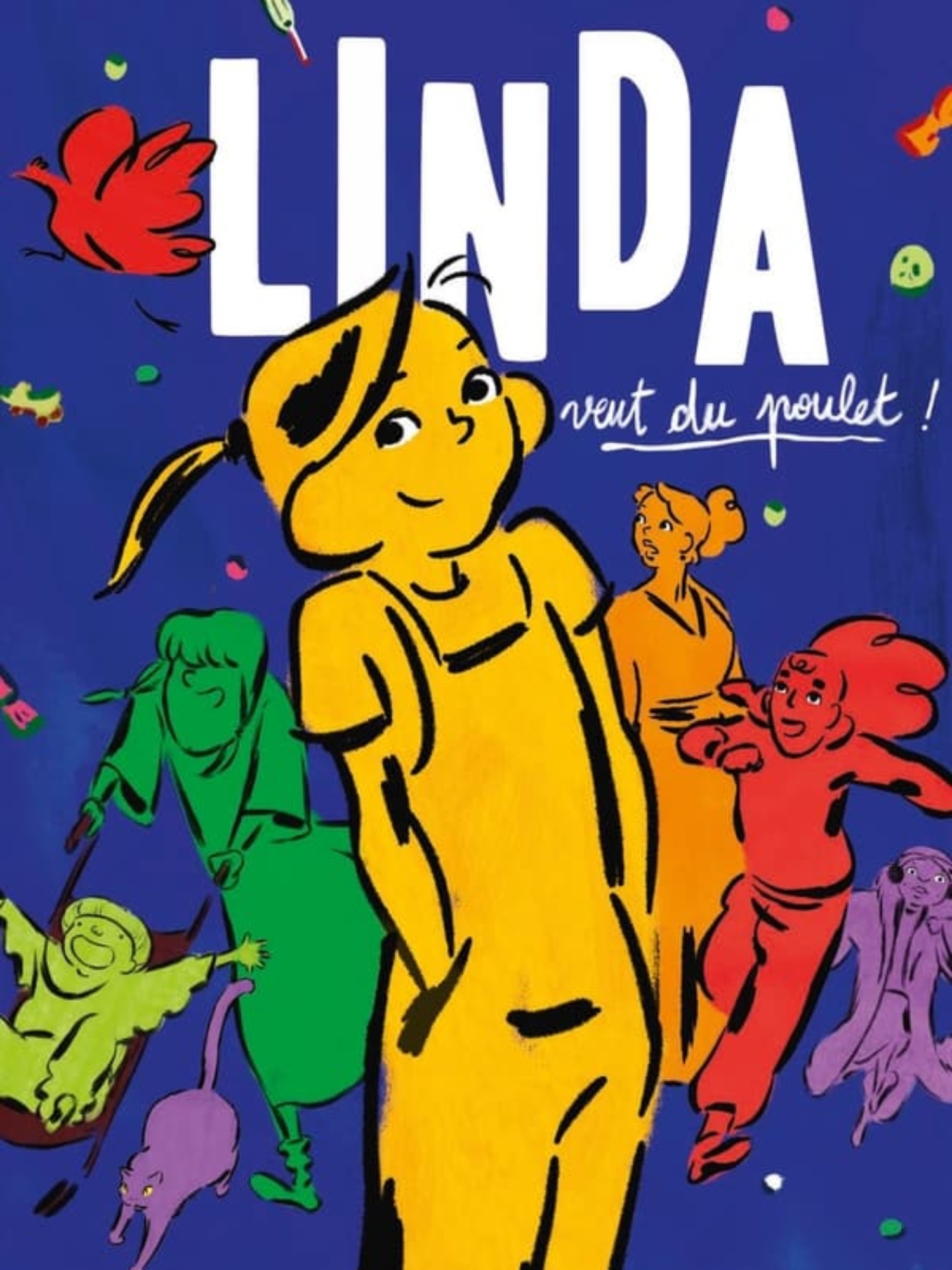

Ping : Les nominations aux Oscars 2023 - Les Réfracteurs