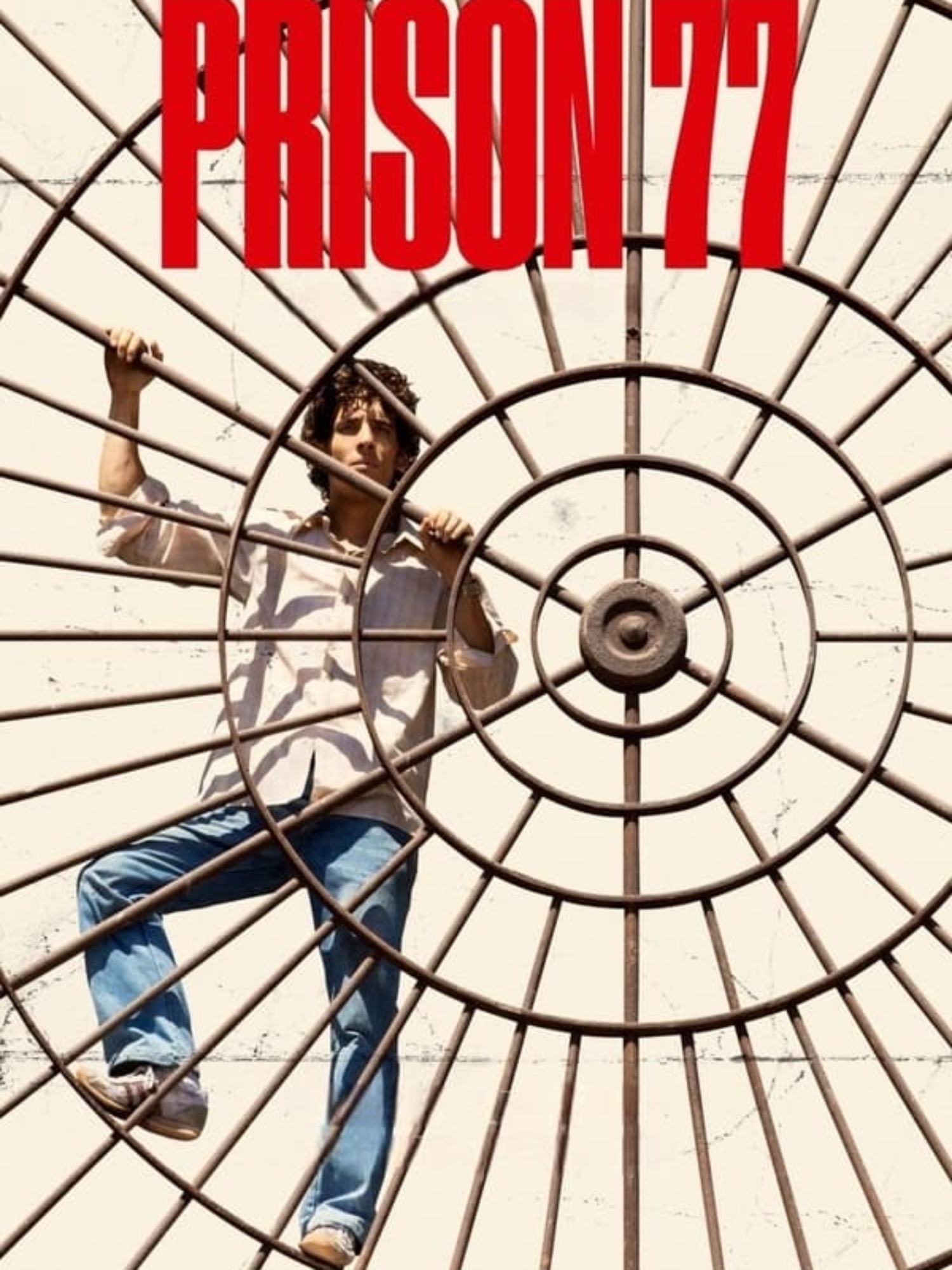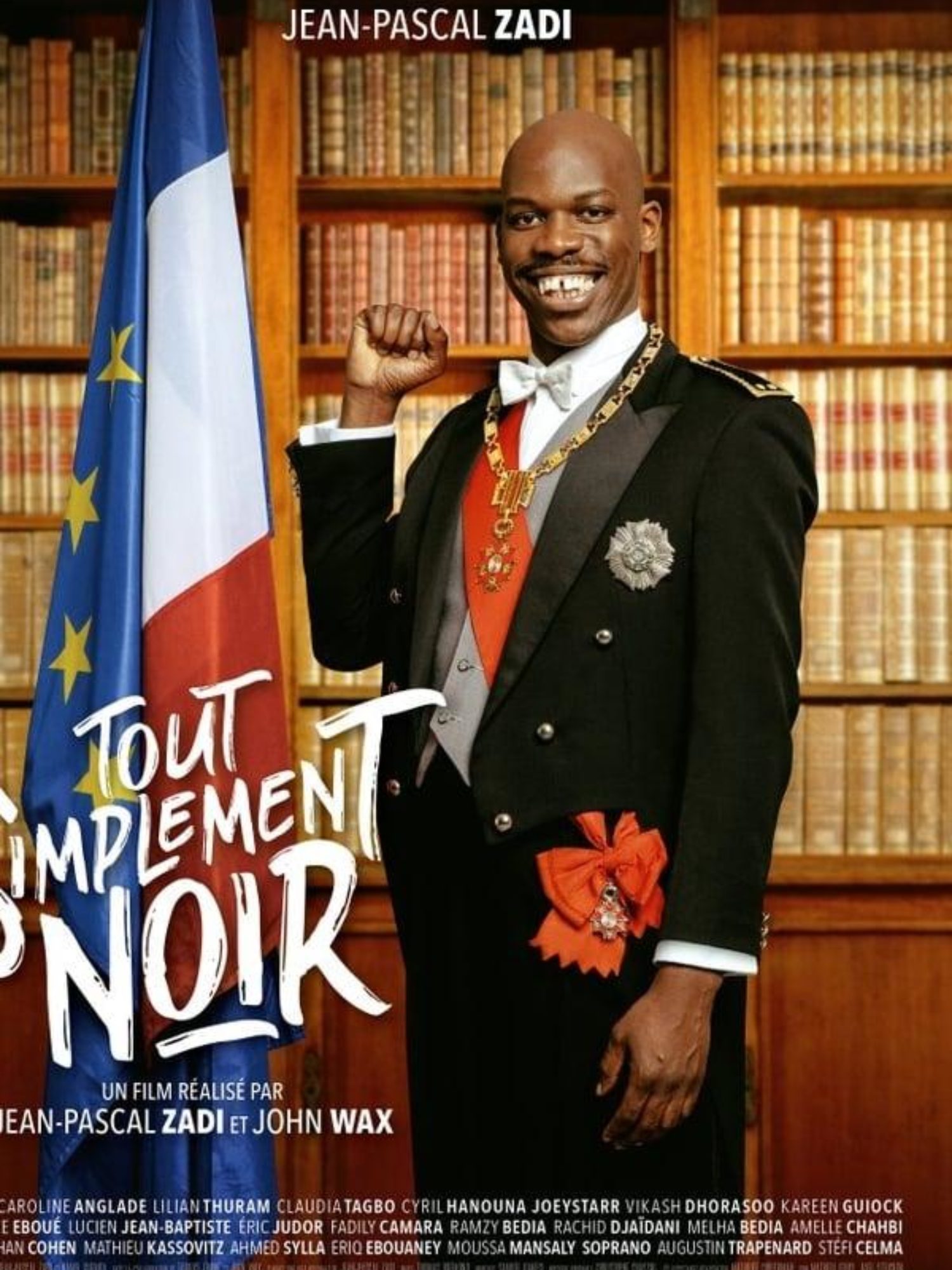2022
Réalisé par : Davy Chou
Avec : Park Ji-min, Oh Gwang-rok, Guka Han
Film fourni par Blaq Out
De la France qui l’a vu naître à l’Asie, terre de ses ancêtres, le réalisateur Davy Chou fait de son cinéma un trait d’union entre les continents. En quête d’une identité métissée, l’auteur transforme l’art en outil d’exploration de ses propres racines culturelles, longtemps restées fragiles et abstraites dans son esprit. Écartelé entre deux origines, l’artiste s’est construit difficilement durant l’enfance, privé d’une partie significative de son héritage. Au cours de ses jeunes années, l’artiste ne fait l’expérience du Cambodge natal de ses parents qu’à travers les récits qu’ils lui délivrent et qui narrent aussi bien la splendeur d’un pays jadis luxuriant que la folie sanguinaire des Khmer Rouges qui ont jeté leur dévolu sur une nation divisée. Vingt-cinq longues années s’écoulent avant que le jeune homme ne découvre pour la première fois le sol désormais en paix de ses aïeux. En 2009, Davy Chou effectue ce voyage fondateur, épouse son leg enfin complet et se lance dans une quête artistique souvent empathique mais parfois amère pour lever le voile sur le passé et le présent de cette patrie, et sur le destin de ses habitants. Deux ans après son périple, il s’attèle à l’élaboration d’un documentaire sur l’Histoire du cinéma cambodgien, de son éclosion dans les années 1960 à son arrêt brutal en 1975, lorsque les fous de guerre le mettent à mort. Prospecteur de la mémoire perdue, l’artiste fait œuvre utile avec Le sommeil d’or, et ressuscite l’esprit du septième art local. En 2016, il capte les inégalités cambodgiennes contemporaines avec Diamond Island, vision acerbe de la modernisation irraisonnée du pays et du destin brisé de ses jeunes ressortissants. Sélectionné à la Semaine de la critique cannoise, le long métrage illustre la sensibilité de son auteur, engagé socialement. La Croisette accueille chaleureusement l’un de ses nouveaux fils chéris et accompagne l’émergence d’un metteur en scène à la patte sensible et subtile.
Avec Retour à Séoul, Davy Chou change de latitudes pour investir la péninsule sud-coréenne, mais il injecte dans son film une importante part de ses angoisses. Fruit de plus d’une décennie de gestation, le long métrage est lointainement inspiré du parcours d’une connaissance du cinéaste, française d’adoption mais coréenne de naissance, et des rapports conflictuels qu’elle entretient avec ses parents biologiques. Témoin de ces relations tumultueuses au cours d’un voyage pour une projection du Sommeil d’or au Festival de Busan, le réalisateur reconnaît chez son amie son écartèlement culturel intime. Actrice principale de Retour à Séoul, la plasticienne de métier Park Ji-min partage une même douleur. Elle aussi est une déracinée, née en Corée du Sud mais exilée en France à l’âge de huit ans. Devant et derrière la caméra, les cœurs vagabonds s’affranchissent des frontières pour construire leur propre identité, parfois dans la souffrance.
Française d’adoption, la jeune Freddie (Park Ji-min) gagne la Corée du Sud sur un coup de tête pour tenter de retrouver la trace de ses parents biologiques, mais aussi pour s’imprégner de la culture de son pays de naissance qui lui est jusqu’alors inconnu. Dans les rues de Séoul, elle écume les bars s’abandonnant régulièrement à la nuit et à sa fureur. Grâce à ses recherches et avec le concours du centre d’adoption Hammond, elle réussit à établir le contact avec son père (Oh Gwang-rok), un homme rural qui manifeste une grande repentance quant au passé et à l’abandon de sa fille. Dans les larmes, au fil de dialogues brisés et parfois dans la colère, le lien entre deux personnages qui ne parlent même pas la même langue apparaît ténu. Alors que les années passent et que la protagoniste tente de s’inscrire dans la société sud-coréenne, la fracture entre eux reste vive. L’homme voudrait ouvrir son cœur à Freddie, mais sa fille refuse de céder, complexe et fascinante, inflexible et pourtant si fragile.

Couchée sur la pellicule, la sensibilité mise à nue de Freddie se découvre lentement, au gré d’instantanés volatiles qui s’évaporent dans les limbes du temps perdu qui jamais ne se rattrapent. Solitaire face à l’adversité, esseulée face à la montagne de son parcours de vie tortueux, la protagoniste de Retour à Séoul a pour seules armes son caractère indomptable et sa témérité. Silhouette effacée dans les rues de la capitale sud-coréenne, presque absorbée par les néons tapageurs, elle subsiste face aux épreuves d’un passé impossible à reconstruire. Doucement, sa tristesse lancinante gagne le spectateur, habité par une mélancolie éprouvante. Freddie n’a pas été malheureuse en France, l’apparition inopinée sur l’écran du téléphone de sa mère d’adoption atteste d’un amour sincère et altruiste, mais lancée en quête de vérité, l’héroïne doit découvrir seule son histoire cachée. Elle refuse le secours des autres, elle se détourne de la sollicitude, elle confronte son âme brisée au récit froid de son adoption. Enfant d’une époque complexe dans la construction sociétale coréenne, au cours de laquelle un nombre incalculable d’enfants a été confié aux services d’adoption, elle se heurte en préambule à la ligne de chiffre sans humanité des registres de la fondation Hammond. Freddie n’est qu’une parmi tant d’autres, presque ignoblement un numéro avant d’être une personne, une unité de plus dans les dizaines de milliers de petites filles délaissées dans l’espoir qu’un avenir meilleur leur sera offert, loin de la fatalité de la précarité.
Pourtant elle est assoiffée de reconstituer un lien avec ses origines secrètes, toujours obstinée à découvrir une vérité taboue. Avec douceur et un onirisme implicite, Davy Chou assimile la découverte des origines de son personnage principal à une renaissance. Dans sa chambre d’hôtel, Freddie perçoit à travers les murs les accords mélodieux d’une douce musique, comme un enfant dans le ventre d’une mère, et elle se colle aux parois de la pièce pour écouter ces sons venus d’ailleurs. Puis vient le coup de téléphone de la fondation Hammond qui l’informe de la réponse positive de son père à sa demande de rencontre, et qui transforme le fil du combiné en cordon ombilical artificiel. Initialement impétueuse, un brin candide et malicieuse comme une petite fille, l’héroïne revit en accéléré une enfance dont elle a été privée. Néanmoins, tisser un véritable lien est impossible. Les liens du sang ne remplacent pas les instants perdus à jamais. Reconstituer des souvenirs est un projet vain et vide de sens qui ne fait que souligner la détresse émotionnelle de Freddie et de son père. Face à des photographies d’un autre temps, déjà si lointaines, ils tentent naïvement de rattraper le temps, mais ils ne font que se heurter à l’illustration des années d’absence qui se sont écoulées. Rien ne peut changer le passé et le croisement de leur destin devient presque l’acceptation d’un deuil, celui des moments qui n’ont jamais été partagés. Inclure Freddie dans cette nouvelle famille ne fait qu’exacerber la peine, la demande de pardon perpétuelle démultiplie la douleur et rappelle sans cesse la cassure qui les oppose. Avant l’émergence d’une connivence précaire, parents biologiques et enfants doivent contempler le fossé qui les sépare, lancer un dernier regard mélancolique en arrière, vers une mère qui refuse le contact ou vers un père qui n’a que son chagrin à offrir. Seulement alors une sincérité émotionnelle peut naître. Férue de piano, Freddie découvre que son aïeul partage une même passion, exprimée avec amateurisme mais sincère à chaque note jouée. Au-delà de leurs différences, une parenté improbable les unis dès lors, loin des artifices de la vie et de ses tourments du quotidien. La protagoniste est fille par le sang et par un spectre de traits communs découverts, même lorsqu’elle tente de se détacher de son héritage.

Parfois davantage que le drame familial, la plongée de Freddie dans la société sud-coréenne accompagne Retour à Séoul en filigrane. En cinéaste curieux, Davy Chou épouse toutes les facettes du pays pour dépeindre son portrait complexe et cosmopolite, érigeant même l’expérience de la terre comme un élément essentiel de la construction de son héroïne. En quête de son histoire intime, la protagoniste découvre, succombe et épouse le mode de vie local. Des territoires ruraux à la frénésie d’un Séoul électrique, dont les lumière criardes cinglent la pénombre nocturne, la protagoniste se perd dans les décors, succombe à l’appel d’une autre société, et s’abandonne dans les nuits sans sommeil de la capitale. La ville ne s’éteint jamais, ses lueurs aguicheuses ensorcellent Freddie et la dévorent presque, au bout de l’épuisement physique et moral. La jeune femme n’offre pas son coeur à la cité, elle rechigne parfois à cotoyer les foules, pourtant elle abandonne son corps aux mains de partenaires improbables, parfois corééns, parfois français exilés. Charnellement, elle fusionne avec le maillage social de Séoul, pour réclamer par la chair l’affirmation de son identité nouvelle, fruit de des origines. Entre “le vin qui endort”, et l’extasie qui réveille les corps intranquilles, elle parcourt un nouveau monde, exploratrice d’une nouvelle société, de ses codes et de ses règles absurdes et pourtant essentielles. Elle croque l’expérience d’une autre vie, se faisant parfois plus coréenne que les natifs, se pliant aux us dans les incessantes scènes de repas qui émaillent le film. Manger devient une cérémonie, un moment clé de réunion où servir de l’alcool à son convive est une marque de respect, selon la tradition locale, tandis que se verser soi-même un verre devient signe d’apitoiement et de scission avec les autres. Attablé, le père de Freddie s’enivre seul, loin d’elle et pourtant si proche affectivement une fois la rancune effacée. Le monde de l’apparat et des coutumes les sépare, celui de l’esprit les réunit douloureusement, une fois le masque des convenances tombé.
L’abnégation et le mutisme froid ne sont que des carapaces au-delà desquels point une solitude extrême. Retour à Séoul erre dans les rues bouillonnantes de la ville et à travers le temps, étalant son récit sur de très nombreuses années. Séoul est une sirène qui rappelle à elle les âmes perdues et qui les noie dans la transe artificielle de ses bars, de ses clubs, et de ses sous sols où explosent les fêtes de tous les excès. Le futur est un concept abstrait, sans cesse bouleversé, remodelé, changeant. Les projets d’avenir sont allégoriques, lorsqu’en une ellipse stricte le film les fait voler en éclats. Perdue aux heures ténébreuses de la nuit, Freddie se saoule pour s’endormir, érige son ébriété en prétexte pour des étreintes désespérées avant de s’endormir à même le bitume. Marginalisée dès sa naissance, elle s’entoure de parias, de figures tatouées et unique, mais effacées par les ombres du crépuscule. Elle épouse les excentriques, trouvant chez eux le réconfort de la différence. Elle refuse parfois la Corée du Sud traditionnelle pour s’endolorir et s’ankyloser au centre de l’assemblée des créatures de l’ombre. Parmi les autres femmes du récit, Freddie se fait tour à tour disciple et guide. Elle a appris des conseils d’une sud-coréenne francophone, s’est reposée sur elle pour affronter ses dilemmes profonds, jusqu’à s’en croire brièvement amoureuse, et la protagoniste emploie cet enseignement pour se transformer elle-même en aide d’une autre enfant adoptée à la recherche de ses parents. Les épreuves se réitèrent, mais le combat des aînés instruit les descendants. Les personnages de Retour à Séoul ne sont jamais vraiment seuls, ils sont entourés de gens qu’ils pensent semblables, pourtant en un mot cruel mais sincère, ils s’effondrent, esclave solitaire de leur propre mal-être.

“Tu es une personne très triste” lui assène une amie de Freddie, faisant ainsi céder les digues dialectiques. Retour à Séoul prend parfois des allures volontaires de Babel moderne, où se confrontent les langues différentes, entre français, coréen et anglais. Un dédale du verbe où à chaque traduction, la parole est déformée pour se plier aux usages, et où en conséquence une part de la sincérité des mots se dissipe. Face à cette perte de l’essentiel, les échanges les plus bouleversants deviennent ceux qui ne s’embarrassent pas du superflu. Le désespoir est un langage universel, le chagrin se lit dans les yeux, et les premiers mots qu’apprend Freddie attestent de ses obsessions. “Mija”, mère en coréen, cette femme qui est absente de presque tout le récit et que la protagoniste cherche éperdument. Transmettre la subtilité des jeux littéraires est impossible. En introduction du film, un étudiant en lettres énonce ouvertement cette vérité à l’héroïne. Jamais une transcription ne pourra la contenter, pour comprendre la Corée, elle doit l’épouser, l’exilée doit adopter son nouvel environnement. Converser avec une personne ne peut également se faire que sur un même terrain d’entente. Même en épousant la langue locale, les message de Freddie adressés à sa mère sont des bouteilles à la mer, des appels à l’aide et à la considération qui ne seront jamais entendus. Néanmoins, une autre forme de dialogue unit les hommes, la musique. L’art s’affranchit des limites et enjoint les personnages autour d’un même ressenti primaire. Lascive sur la piste de danse, Freddie est en transe, elle ondule frénétiquement sur les airs d’une autre contrée, communie avec sa culture davantage qu’avec ses habitants. Les chants populaires sont des hymnes transmis à cette française qui devient coréenne le temps d’un morceau, comme une fête, tandis que les accords de piano la renvoient à sa solitude et à son désarroi, lorsque seule, elle fait face au déchiffrage d’une partition. Comme une musicienne qui se jette dans l’inconnu, Freddie tente de faire sens de son histoire personnelle.

Doux et sensible, Retour à Séoul jouit d’une délicatesse et d’une mélancolie communicative. En errance dans une Corée du Sud aux multiples visages, une femme tente de tracer sa route.
Retour à Séoul est disponible en DVD chez Blaq Out, avec en bonus :
- Un entretien avec Davy Chou
- Des essais de casting et des extraits de répétition de Park Ji-Min