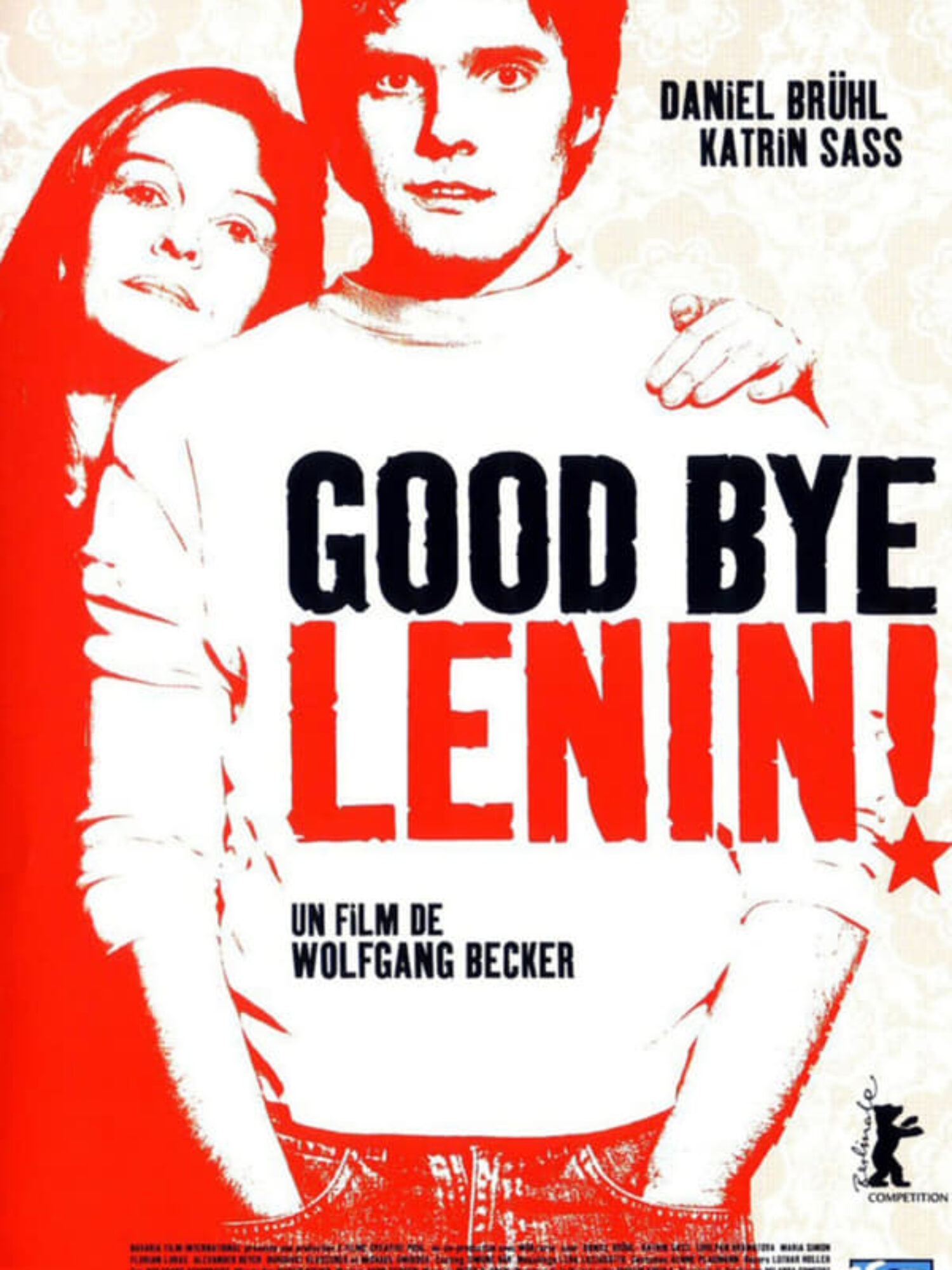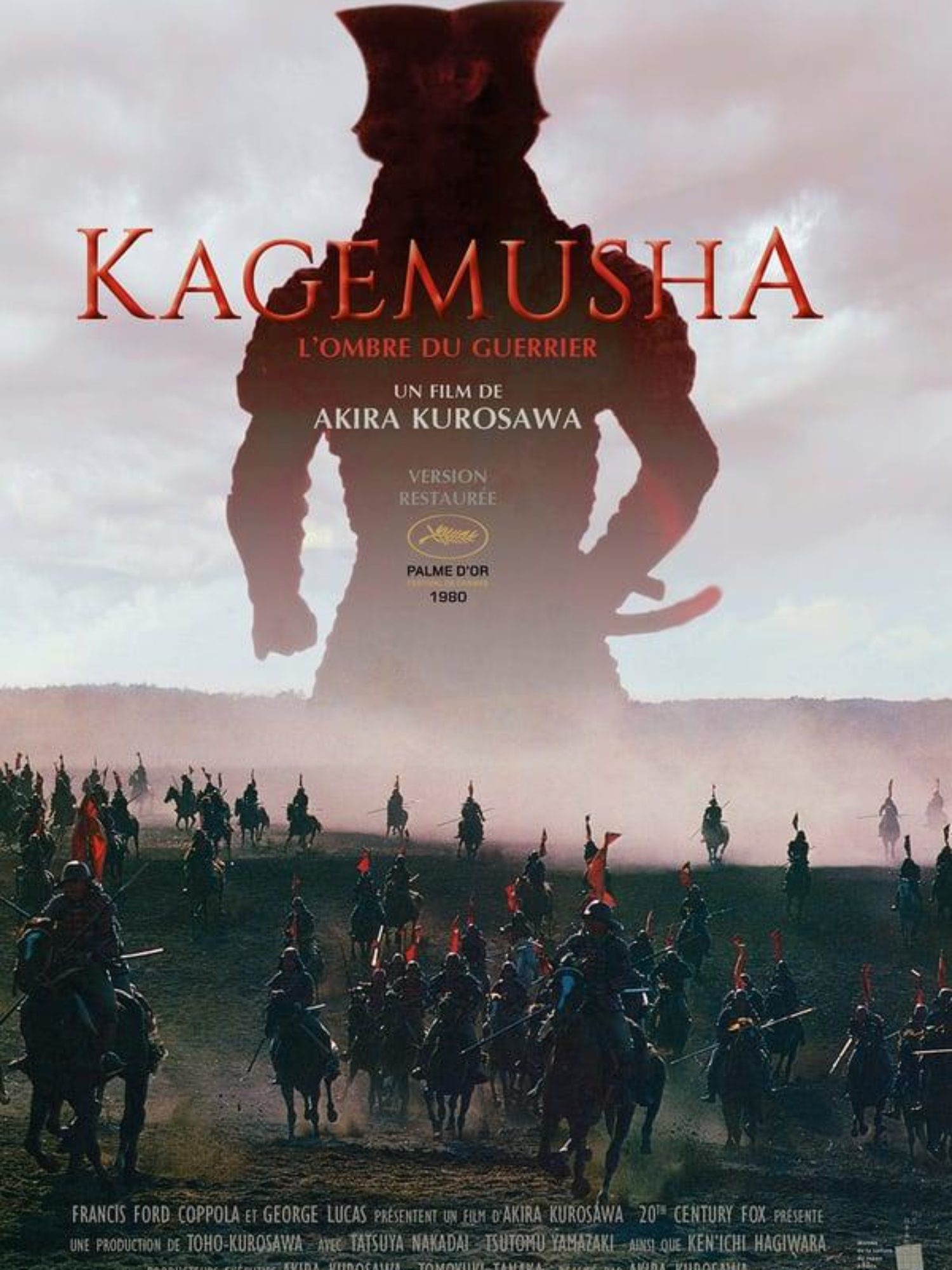(しとやかな獣)
1962
Réalisé par : Yūzō Kawashima
Avec : Yūnosuke Itō, Ayako Wakao, Hisano Yamaoka
Film fourni par Badlands Édition
Dix ans avant l’avènement de la Nouvelle Vague japonaise, les œuvres de Yūzō Kawashima marquent le crépuscule de l’ère classique. Fin observateur social et politique d’un pays en pleine métamorphose, le cinéaste renie l’image idéalisée d’une nation portée par certains grands maîtres de son temps pour poser un regard désenchanté sur la reconstruction sociétale nipponne. Entre les mains du virtuose, le cinéma devient une révolution thématique et stylistique flamboyante et permanente, les frontières entre les genres s’effacent et les personnages marginaux étalent leurs destins tragiques. Parfois si nihiliste qu’il en devient cynique, Yūzō Kawashima est un caméléon hypnotisant, un audacieux expérimentateur du septième art, mais aussi un électron libre partiellement incompris de son vivant. À l’entame des années 1960, sa liberté artistique effraye les grands studios, qui n’exportent que très rarement ses longs métrages. Son train de vie dissolu, sa fougue créatrice et son refus d’être inféodé à une firme, contrairement à ses pairs, font de lui une anomalie d’un système particulièrement codifié, précurseur de l’évolution d’une industrie. Lorsqu’il décède en 1963 après une nuit de débauche, à seulement 45 ans et quelques jours avant la sortie de son dernier film Ichi ka bachi ka, le réalisateur est davantage reconnu comme un metteur en scène de petits films d’exploitation que comme un géant du cinéma japonais unanimement salué. S’engage alors un lent processus de réhabilitation de son œuvre, notamment incarné par son élève prodige Shohei Imamura, qui après avoir transporté les cendres de son maître vers son ultime demeure, lui consacre un long texte passionné dans un ouvrage analytique aux allures d’hommage à ce génie incompris de son vivant. Avec l’émergence des ciné-clubs dans les années 1970, le Japon redécouvre son patrimoine et adoube enfin l’un de ses artistes les plus fascinants, dont la fulgurance de la carrière n’a d’égal que l’incroyable productivité. En 20 ans, Yūzō Kawashima a signé 51 longs métrages, aujourd’hui inscrits au panthéon du septième art, et commentés chaque années dans des dizaines d’essais, faisant du cinéaste un artiste particulièrement étudié de son pays. Le paria est devenu icône.
En éditant en Blu-ray et DVD dans de magnifiques écrins les trois films que Yūzō Kawashima a mis en scène pour les studios de la Daei, Badlands Édition entretient brillamment la mémoire du cinéaste et contribue à populariser son œuvre en France. Trait d’union de ce triptyque ensorcelant, la comédienne Ayako Wakao trouve dans Les Femmes naissent deux fois, Le Temple des oies sauvages et La Bête élégante des rôles parfaits qui permettent de prouver à tous sa faculté à apporter grâce et nuance à des partitions complexes. L’actrice est déjà une idole au moment de collaborer pour la première fois avec le réalisateur, mais les femmes qu’elle incarne pour lui apparaissent plus torturées, prémices de celles qu’elle campera par la suite pour Yasuzo Masumura, dont elle deviendra l’égérie. Dans La Bête élégante, son rôle pourtant secondaire contribue grandement à magnifier la peinture sociale au vitriol qu’expose le film. Si Yūzō Kawashima est passionné par le cinéma de Yasujirō Ozu, son long métrage marque une rupture notable avec l’image idyllique et bienveillante de la famille nippone qu’a si souvent mis en scène son maître. Le Japon se désagrège à l’écran, les aïeux corrompent leurs enfants, la bestialité évoquée dans le titre, et au cœur de la réflexion du scénario du légendaire Kaneto Shindō, fragilise les liens affectifs. Le pays est en pleine mutation, l’essor industriel, économique et démographique impose une transformation totale pour toute une nation qui s’apprête symboliquement à accueillir les Jeux Olympiques de 1964. Pourtant dans les murs des appartements nouveaux, l’homme se replie vers ses instincts primaires.

En huis-clos dans le logis d’une famille résidant dans ces immeubles modernes, La Bête élégante dissèque le quotidien d’une lignée pervertie par l’avarice rendue compréhensible par un passé précaire brièvement évoqué. Les Maeda sont des marginaux d’une nation en pleine ébullition, qui vivent dans le luxueux confort obtenu grâce aux transgressions morales et légales. Le patriarche Tokizo (Yūnosuke Itō) incite son fils Minoru (Manamitsu Kawabata), prompt à s’exécuter, à piller sournoisement la société pour laquelle il travaille, et monnaye les charmes de sa fille Tomoko (Yûko Hamada), maîtresse d’un écrivain en vogue. Accumulant les biens matériels, les Maeda n’éprouvent presque aucun scrupule, jusqu’au jour où les détournements de fonds de Minoru sont découverts. La fraude incrimine l’ensemble de sa société, qui se révèle tout aussi corrompue que les protagonistes, et notamment la comptable Yukie (Ayako Wakao), jeune veuve désireuse de s’émanciper de son poste et de sa relation charnelle avec le fils Maeda pour ouvrir une auberge.
Observateur discret et subtilement voyeur, Yūzō Kawashima montre à tout un pays une réalité qu’il refuse de voir d’ordinaire. Le cinéaste s’infiltre dans le logis et il investit chaque espace pour offrir un point de vue intrusif sur l’appartement des Maeda. Dans un placard, derrière des toilettes, sous une table ou à travers une fenêtre, la caméra se loge dans l’intimité pour capter les errances morales et affectives de ces tristes héros. Le secret du logis vole en éclat, La Bête élégante s’immisce dans tous les recoins pour relater la vérité crue du Japon des invisibles. Comme si l’immeuble avait été disséqué pour en montrer les mécanismes internes, une vue aérienne couvre le décor du foyer, privant les personnages inconscient d’être observés du refuge de l’intimité. Entre les murs, les tensions du Japon sont miniaturisées, l’échelle intime convoque une réflexion globale sur les rapports de forces changeant dans l’archipel. Les plus jeunes bravent les anciens, les démunis résistent aux fortunés, et les femmes s’affirment face aux hommes. Dans l’espace réduit, les conséquences de la métamorphose effrénée d’une nation désormais prise en étau entre tradition et modernité explosent à l’écran à travers la cohue des mots et des corps. La Bête élégante fait du minimalisme un écho vertigineux de toute une société en perte de repères. L’appartement est ainsi lieu de transit pour une poignée de destins différents, venus jouer leur futur dans le domaine des Maeda. L’extérieur gagne l’intérieur, un monde s’impose davantage qu’il ne s’invite. Ses apôtres, hommes d’affaires ou artistes, ne frappent pas et errent dans les quelques pièces comme des maîtres sévères, avant que la famille ne les renvoie insidieusement à leur extrême fragilité et à leur dépendance. Les Maeda ont trompé ces dompteurs en se faisant passer pour serviles. La bête s’est rendue élégante, pour mieux mordre. Pourtant l’appartement est souvent semblable à une cage dont la famille de protagonistes est prisonnière. Métaphoriquement, l’attrait du confort incite les enfants, oiseaux de nuit, à revenir vers leur nid dès que le jour laisse poindre ses premiers rayons ; concrètement, Yūzō Kawashima joue de l’angle de la caméra pour obstruer le champ de vision du spectateur des barreaux de la rambarde du balcon, faisant de ses héros de véritables détenus lorsque la détresse des sentiments s’exprime. L’animal est insoumis, mais sa rage est contenue. L’espace de quelques minutes, protagonistes et spectateurs sont captifs de cet espace clos, condamnés à ne percevoir du monde extérieur qu’un infini vacarme sonore continu, ponctué par le bruit des avions militaires qui témoigne de la frénésie de toute une nation. À la fenêtre, parfois à l’aide de jumelles, les Maeda observent sans être inclus.

Dans cette bulle hors du temps, l’âme ancestrale du Japon agonise et s’exprime dans un dernier baroud d’honneur avant l’âge du crépuscule. Les aïeux ne survivent que dans les dernières bribes d’une autorité déclinante, désormais contestée. Tokizo jouit d’une forme de déférence, mais le respect qui lui était dû jadis s’évapore dans les limbes d’une modernisation dont il est exclu. Les liens affectifs ne sont plus exprimés qu’à travers le mètre étalon du Yen, les illusions de grandeurs sont devenues fantasme refusé par une nouvelle génération consciente des torts de leurs parents. Le père est fragilisé, une maladie qui l’afflige est évoquée sans compassion, sa mort est même parfois espérée. La sagesse de l’âge est désacralisée, réduite à une simple conformité à des ordres obscurs motivés par la protection d’une opulence dérobée davantage que méritée. Les grandes figures vacillent avant une chute inexorable vers le malheur et se révèlent étrangement mutiques lors de certaines joutes verbales. Le père à démissionné de son rôle de modèle moral pour ne plus vivre que dans la repentance de la défaite de la Seconde Guerre Mondiale, perçue dans le texte comme une injure, évoquée dans une scène où Tokizo est poignard en main, ivre de croire qu’il a encore un avenir. Le colosse n’est pas encore tombé, il continue d’ordonner son monde, mais il n’est plus que profiteur des errances de ses enfants, simple catalyseur des richesses dérobées, un maître chanteur bientôt abattu. La Bête élégante restitue les dernières heures d’un règne ténébreux, la fin d’un ère mise à mort par l’émergence de nouveaux codes tout aussi pervers que les anciens. À la nuit tombée, Tokizo est seul avec son épouse Yoshino (Hisano Yamaoka), dans l’obscurité la plus totale alors que la radio laisse entendre des sutras immémoriaux. L’autorité parentale s’évanouit dans le confort de la nuit, le jour ne la ressuscitera pas. Dernière âme servile d’une cour qui s’effondre, Yoshino est effacée dans les dialogues mais omniprésente dans le geste. La mère ne s’exprime que très peu, mais elle est sans cesse en mouvement, entre la cuisine et le salon, pourvoyeuse des soins matériels essentiels. La protagoniste muette est témoin du malheur et de la décrépitude du foyer, première affligée par les transgressions des Maeda. Au terme du film, elle est dépositaire du secret des conséquences funestes des agissements des siens. Confrontée au supplice d’un homme trompé, unis à lui par une même douleur spirituelle propre aux négligés, elle fait de son silence une preuve de résilience et un acte de merci pour sa famille, leur épargnant une culpabilité qu’elle endosse seule.
Un génération s’éteint, une autre naît, dans une explosion de fureur, la rage de vivre au bout de chaque mouvement. Minoru et Tomoko veulent exister, laisser éclater au grand jour leur esprit rebelle et libre, malheureusement contraint par le spectre d’une oppression sociétale obscure, parfois désincarnée. Dans une danse volcanique, leurs corps se désunissent et se réunissent, voltigent, s’étreignent et se repoussent. Silhouettes intranquilles dans la lumière d’un soleil déclinant, ils vibrent dans une sarabande endiablée qui projette Tomoko contre la parois de verre de l’appartement, animal colérique prenant conscience des barreaux allégoriques qui l’enferment. La télévision hurle, la jeunesse rugit. Les accessoires modernes qui leur sont associés ne sont qu’un déguisement qui camoufle à peine la nouvelle cage qui leur est imposée, un pis-aller face à l’adversité, une piètre rétribution diaboliquement échangée au prix de leur droiture morale. Le polaroid de Minoru ou la robe occidentale de Tomoko sont de maigres compensations octroyées par un pouvoir qui n’a pas changé de main. Dans la reconstruction d’un Japon nouveau, les fils de précaires restent opprimés, ils caressent la richesse sans en être dépositaires et marchandent leur vertu contre un peu de confort, loin d’être décisionnaires. Corps et sentiments sont une nouvelle monnaie effroyable, une possession mise en gage, explicitement pour la jeune fille qui vend ses charmes, implicitement pour le garçon trompé par Yukie. Aimer est un luxe qui leur est inaccessible. Ils ne sont qu’un matériel que le romancier au bras de Tomoko emploie pour ses romans, qu’on devine assez médiocres, salué pour son rythme d’écriture et non pour la qualité de sa plume. Un univers régent entretient l’illusion de leur liberté et met en scène leur existence sur les pages blanches d’un artiste en mal d’inspiration. Ils n’existent que pour consommer et se consumer. Les parents ne quittent pas leur prison, les enfants y retournent sans cesse.

Toutefois, une flamme anime les Maeda, un mot suffit à justifier leurs actes, à les comprendre, à leur pardonner, et même à les approuver dans une certaine mesure : “Pauvreté”. Le parasitage sonore de la rue est incessant et oppressant durant toute La Bête élégante, mais lorsque la douleur se confie et explique les entorses morales, le silence absolu se fait. Dans un monologue aussi bouleversant que somptueux, Yūnosuke Itō, proche collaborateur d’Akira Kurosawa, impose l’émotion et dérobe le cœur du spectateur. La pauvreté, celle qui colle à la peau, celle qui s’infiltre jusque dans les os, celle qui est un poignard dans la chair, son ombre opaque est la seule alternative à ces existences brisées. Dans le Japon des années 1960, mieux vaut vivre dans le confort matériel et le tourment de l’âme que dans la précarité. Les Maeda s’en sont extirpés, tous les moyens sont bons pour ne pas y retomber. La pauvreté, l’épée de Damoclès surplombant des destins tragiques, torturés, mais défait d’un statut social ostracisé. L’appartement n’est alors plus une cage mais un refuge. Dans ce lieu a été monétisé l’honneur, mais un poste de télévision, un canapé ou une simple bière sont des petites victoires, des coups d’estoc contre un avenir désormais confortable. Néanmoins, dans ce monde où tout s’achète, où une fraude de “100 yen ou 1000 yen revient au même”, l’essentiel manque. Le décor est mouvant, se vide dans l’entame du film avant de se remplir progressivement, mais il est dépourvu de tout sentiment. Les Maeda ont échangé l’amour contre une cafetière, ils ont sacrifié le respect des aînés, l’affection parentale et la droiture pour ne plus jamais être dans le besoin. La pauvreté a jadis soudé la famille autour d’une même peine, mais maintenant qu’elle n’est plus qu’un vieux démon, les enfants sont privés de la construction de leur propre foyer. Le tissu sentimental s’est déchiré, remplacé par une dictature des billets de banque qui entrave la marche du cœur. Sur le balcon, Yukie et l’un de ses amants sont réunis, un dialogue relatant leur liaison s’entend mais leurs lèvres ne bougent pas. La passion reste un sentiment inexprimé, des mots à jamais perdus que seul le spectateur entend. Pauvre mais heureux ou riche mais solitaire, le choix est impossible, celui qu’ont fait les Maeda est légitime.
Pourtant, cette vie chèrement acquise a tout d’une mort spirituelle. Le quotidien est un chemin de croix, entre menace de figures d’autorité et peur de la perte d’un oasis précaire de confort. Le père et le fils ne sont pas inscrits dans la société, ils en sont de nouveaux esclaves, autant profiteurs qu’exploités par de nouvelles lois, de nouvelles règles, de nouveaux bourreaux. L’avenir se disloque et s’évapore, l’existence actuelle n’est qu’un sursis avant un âge d’ombre prophétisé. Confronté à son supérieur hiérarchique, Minoru prolonge la métaphore mortifère en évoquant une même corde autour de leur cou, la sienne étant simplement plus serrée. Les hommes profitent néanmoins d’une marge de manœuvre dont sont dépourvues les femmes du récit. Tomoko est tributaire du choix de ses aînées, elle ne peut exprimer ses pulsions profondes, réduite à un bout de chair malléable. Dans le salon, son avenir se joue entre ses parents et l’écrivain, tandis que la jeune femme ne peut observer ce sinistre spectacle que dans le secret d’une maigre entrebâillure des portes de l’appartement. L’être est privé de sa volonté, il n’en a pas conscience mais son destin se décide sans lui, témoignage de la reconstruction défaillante d’un pays. L’émancipation de Yukie est la seule victoire qu’autorise La Bête élégante au public. La comptable a pourfendu le dragon du patriarcat, elle s’est jouée de ses supérieurs pour tirer profit de la situation, et accéder à son indépendance. Ses sacrifices sont immoraux, mais la finalité de sa quête rétablit un semblant de justice. Lumière au milieu des ténèbres, Ayako Wakao est le phare de Yūzō Kawashima, une étincelle fragile mais omniprésente qui souffle chaque scène de son talent. L’ostracisée caresse la gloire et suscite l’admiration des anciens. Yukie a réussi l’impossible, celui auquel ont renoncé les Maeda. Dans des séquences stylistiquement épurées et saisissantes de brio, la jeune femme gravit les marches vers l’ascension sociale alors que son supérieur hiérarchique les descend, condamné par ses fautes. Néanmoins, au terme du film, Yukie devra dégringoler. Face à la détresse d’un homme, elle sera rappelée à ses origines, son émotion et sa culpabilité seront clairement établies par ce geste allégorique du réalisateur. Dans un Japon entre deux âges, le salut de l’âme est un rêve inaccessible.

Yūzō Kawashima magnifie l’art du huis-clos avec La Bête élégante. Le minimalisme d’apparence sert une réflexion complexe sur le Japon de l’époque, et sur les rapports de domination sociétaux toujours omniprésents.
La Bête élégante est disponible en Blu-ray et DVD chez Badlands Édition, dans une superbe édition limitée à 1000 exemplaire, avec en bonus :
– Présentation du film par Bastian Meiresonne (29′)
– « Kawashima, l’héritage » (34′)
– Bandes-annonces