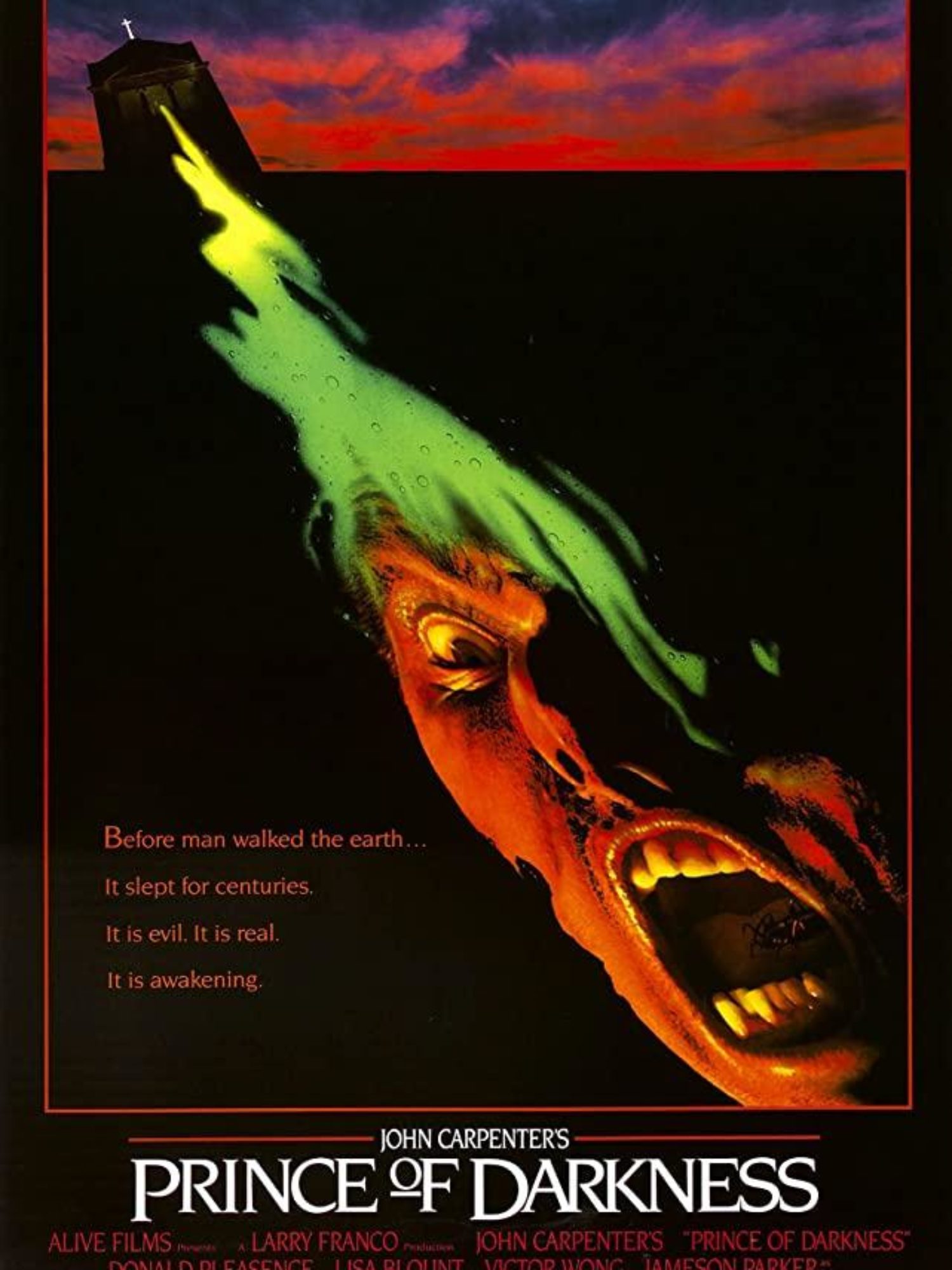2019
avec: Niels Schneider, Vincent Rottiers, Ella Rumpf
Pendant plus de 3 ans, entre 1992 et 1995, Sarajevo fut le théâtre d’affrontements sanglants quotidiens. D’un côté, les Serbes qui encerclent la ville et la maintiennent dans un état de siège permanent. De l’autre, retranchés à l’intérieur des immeubles en ruine, les Bosniaques, dont des milliers de civils luttant pour leur survie dans un état de précarité le plus total. Un rapport de force complètement déséquilibré: des centaines de tirs d’obus quotidiens réduisent chaque jour un peu plus la ville en miettes. Et des morts…Toujours plus de morts…
Pour les gens de la génération de vos Réfracteurs, cette guerre est un souvenir étrange. Un choc pour les enfants que nous étions à l’époque, le premier constat de l’absurdité de la guerre et de la cruauté de l’être humain. Chaque soir, bien à l’abri à l’autre bout de l’Europe, ce sont des images de carnage incessant, à jamais gravées dans nos mémoires, que ressassaient les journaux télévisés. Ce sont aussi des témoignages radiophoniques de journalistes sur place, qui dépeignaient vocalement l’horreur ambiante de ce siège meurtrier. Parmi eux, Paul Marchand, le héros de “Sympathie pour le diable”, un correspondant de guerre qui a bel et bien existé et dont le film retrace le parcours dans les décombres de Sarajevo.
Au début de l’oeuvre, l’indécence. Retranchés dans un immeuble presque luxueux en comparaison des ruines qui l’entourent, journalistes de tous pays sont regroupés. Une ambiance bon enfant règne, entre jeux de cartes, parties de foot dans le hall de l’hôtel et blagues cyniques. Ces hommes et ces femmes sont déconnectés de l’horreur que vivent les Sarajéviens et Pierre Marchand est lui-même presque hermétique à la misère d’un peuple affamé et régulièrement privé d’eau. Une distance peut-être voulue, pour ne pas trop s’impliquer émotionnellement, mais qui invite au malaise.

« Va falloir faire un constat là »
Ces journalistes sont comme les casque bleus dépêchés sur place: impuissants. Ces deux factions réduites au simple rôle d’observatrices ne font que constater et dénombrer tirs d’obus et victimes qui viennent quotidiennement alourdir le bilan d’une guerre immonde. Les correspondants n’hésitent d’ailleurs pas à se mettre en scène pour étoffer leurs reportages, et c’est déjà là un axe de réflexion du film: cette théâtralisation problématique de la guerre, forcément immorale, mais seul moyen de tenter (souvent en vain) d’alerter le reste du monde. Paul Marchand n’hésite d’ailleurs pas au début à s’y employer.
Mais au hasard d’une rencontre avec une traductrice dont il va s’éprendre, Paul va progressivement changer d’approche. Lui qui était si distant commence peu à peu à être marqué par la détresse du peuple bosniaque: de moins en moins robotique, jusqu’à finalement être humain. Fini le goût du risque insensé pour notre héros, qui à bon rythme va assimiler l’horreur de ces gens endeuillés. Cette traductrice, Boba, est l’un des symboles les plus forts du film: en tombant amoureux d’elle, Pierre se prend d’affection pour le peuple. Elle est l’une des métaphores de l’oeuvre, à l’instar de cette scène où des casques bleus brûlent du pétrole reçu en grande quantité au lieu de l’offrir aux habitants désoeuvrés. Ou encore comme cette famille mixte, de parents serbes et bosniaques, qui démontre la fraternité que l’on pourrait espérer si on déposait les armes.
Cette intelligence du propos, elle est accentuée par une réalisation sobre, sans fioritures. Là où plus d’un film de guerre aurait multiplié les effets spéciaux, “Sympathie pour le diable” fait le choix de l’économie. Peu de musique, voire presque pas du tout, des scènes simplement filmées à l’aide d’une ou deux caméras, et ces séquences d’affrontements où l’image tremblotante qui suit les protagonistes restitue l’urgence du moment.
Mais ce film, c’est aussi la performance hors-normes d’un acteur, Niels Schneider. Aidé par l’écriture fantastique de son personnage, il participe grandement à la réussite du pari fou du film: s’identifier à cet homme glacial au début et qui finalement tend de plus en plus vers les sentiments qu’il a enfouis en lui pour faire son travail. À mesure que le long-métrage avance, il progresse lui aussi dans sa réflexion avec un naturel déconcertant jusqu’à devenir d’une intensité rare à la fin de cette sombre histoire.

Il y a les “films de guerre”, parfois bons, là n’est pas la question, et les “films sur la guerre”. L’œuvre d’aujourd’hui tombe dans la deuxième catégorie de par son humanité, et en devient l’un des meilleurs porte-drapeaux récents car ses émotions ne sont jamais retranscrites avec une putasserie parfois malséante.