
2021
Réalisé par: Steven Spielberg
Avec: Ansel Elgort, Rachel Zegler, Rita Moreno
Film vu par nos propres moyens
Projet risqué à plus d’un égard, West Side Story version Spielberg est pourtant une formidable démonstration, celle d’un cinéaste qui renaît de ses cendres et prouve que la nostalgie n’empêche pas l’instinct créatif.
Qui a eu cette idée folle, un jour de réadapter West Side Story ? Curieux projet, en effet, que de se frotter au mètre-étalon de la comédie musicale. Le film de Robert Wise (10 Oscars et quatre ans à l’affiche en France, rien que ça), sorti en 1961, ne se présente ni plus ni moins que comme une œuvre intouchable aux atours résolument modernes, à la musique cristalline, un joyau patrimonial de son temps. Bref, faudrait-il être dérangé, si ce n’est pire, pour s’attaquer à un tel monument.

Mais l’inconscient du mois n’est pas un bleu. Et il n’a pas son pareil pour dépoussiérer les vieilles archives. Qu’elles soient historiques (La Liste de Schindler, Munich) ou cinématographiques (La Guerre des Mondes), Steven Spielberg a pris un malin plaisir, durant sa longue carrière, à regarder dans le rétroviseur pour mieux renseigner notre monde actuel. Quel meilleur réalisateur, donc, pour moderniser un film au discours éminemment sociopolitique ? D’autant que le réalisateur n’a jamais tu son admiration pour le film original : « J’écoutais le disque en boucle, la musique fait partie de mon ADN », décrit-il. Le rapport à l’enfance, toujours. Un rapport conflictuel, attendri autant que délétère. Steven Spielberg pour réadapter West Story Story (car oui, le film n’est pas un remake du film de Robert Wise mais bien une réadaptation de l’œuvre originale de 1957), c’est donc plus qu’un bon choix. C’est l’évidence même.
La fin de l’innocence
Jets. Sharks. Derrière ces sobriquets se cache surtout l’affrontement de deux Amériques. Les premiers, descendants d’émigrés, nés aux Etats-Unis, contestent aux seconds, venus de Porto Rico, leur statut d’Américains. Au sein de l’Upper West Side de Manhattan, dans les années, s’installe une lutte territoriale intestine, pour un territoire déjà condamné. Et au milieu, l’amour. Celui de Tony (Ansel Elgort), ancien membre des Jets, et Maria (Rachel Zeigler), sœur du chef des Sharks. Un amour shakespearien, impossible, tragique.

Difficile de ne pas voir ce qui a passionné Spielberg là-dedans, lui dont le cinéma se parsème de ces figures modestes, dont la petite histoire fait la grande. Le combat de ces deux fratries, c’est d’abord celui d’une Amérique qui, au crépuscule des années 50, fait le constat d’une violence sourde, des conséquences d’un racisme latent, d’une pauvreté qui désabuse la jeunesse. Dans West Side Story, ce symbole est celui de Riff (Mike Faist) et Bernardo (David Alvarez). Le premier, leader des Jets, ne croit plus en rien, certainement pas en lui-même. Le second, à la tête des Sharks, ne se résout plus qu’à la violence, physique et psychologique. Deux enfants abandonnés, sans repères (la figure du père est quasiment absente du film), qui en guident d’autres dans leur chute. C’est ce rapport à l’enfance, cher au papa d’E.T., qui guide le long-métrage. C’est d’abord et avant tout ce constat d’adolescents jouant dans un monde en ruines.
De l’art de la grandiloquence
Mais loin d’une austérité, Steven Spielberg enrobe l’ensemble dans une orgie étincelante et débordante. Son cinéma est d’abord un cinéma du mouvement, celui de la caméra ou des personnages. La comédie musicale semble ainsi un genre tout trouvé, et le cinéaste s’en donne à corps joie, multipliant les séquences parfaitement minutées, les plans en grue qui offrent relief et amplitude aux scènes et les plans clinquants. Parfois trop, certes. On frôlerait l’indigestion. Mais dans l’ensemble, le travail de Janusz Kamiński, directeur de la photographie et fidèle parmi les fidèles depuis La Liste de Schindler en 1993, reste une pure merveille visuelle. Un élégant travail de la lumière, sublimant la carnation et l’incarnation, en parfaite symbiose avec la grandiloquence spielbergienne.

C’est au sein de cet écrin doré que se révèlent donc des talents insoupçonnés et des duos poignants. Pour les interprètes principaux, Ansel Elgort et Rachel Zeigler, c’est de leur effacement, leur volonté de cacher, de tempérer, que nait l’émotion. Du bruissement d’un sourcil, d’un geste de la main. D’une goutte faite tempête. Un jeu effacé, voire un sous-jeu mais justifié par les autres moteurs de ce film : Mike Faist et David Alvarez. Les deux leaders de clans rivaux. Deux brutes sublimées par la danse. Deux tensions, homosexuelle chez l’un, machiste chez l’autre. Des fantômes grandguignolesques d’un monde déjà perdu, qui se démènent par un jeu plus outrancier, non moins subtil. Dès le premier échange se lit toute la haine latente, l’avidité d’un combat attendu, dans leur regard. Ils sont le symbole du penchant social du film, véritable clé de voûte à laquelle l’histoire d’amour vient donner sa grâce. Toute shakespearienne si elle en est (West Side Story reste une réinterprétation de Roméo & Juliette), ce que Spielberg n’oublie pas, venant capter le détail, l’indicible dans un gros plan, l’émotion dans un regard, l’amour dans un murmure. Tout, dans West Side Story participe d’un émerveillement perpétuel. En formaliste aiguisé, le réalisateur pense son film de A à Z. Tout est millimétré. Mais Steven Spielberg, c’est un grand enfant forcé de poser un regard d’adulte sur le monde. West Side Story n’échappe pas à la règle.
Spielberg, technicien accompli
Des ombres menaçantes, comme acérées, filmées avec le regard divin, qui finissent par se confondre : la déclaration d’intention est là, en un plan déjà spielbergien. Celui de deux « ligues des ombres », deux factions sublimées par une mise en perspective des corps, une noirceur délicate et la patte d’un artiste depuis longtemps arrivé à maturation, pour qui le langage cinématographique n’est qu’un langage parmi d’autres.
Le jeune enfant qui rêvait en regardant West Side Story a grandi. Son regard, malgré lui, a perdu en naïveté. A « gagné » en cynisme. L’époque veut ça. Le mouvement, cher au cinéaste, devient un instrument de distanciation, le témoin de la vacuité de ce monde. Il contextualise les personnages dans un monde perdu et condamné (c’est d’ailleurs dans des ruines que s’ouvre et se ferme le film, là où l’original s’ouvrait sur un plan de New York). La géographie, en ce sens, devient primordiale : elle étouffe, enferme les personnages dans leur réalité. Des grands enfants dans un champ de bataille dont les instants de sortie sont toujours brefs, souvent réservés au duo amoureux.

Steven Spielberg a parfaitement su, visuellement, se réapproprier une œuvre tutélaire. La moderniser, offrir l’ampleur nécessaire à un récit qui dépasse le cadre de son genre. Et, entre respect et appropriation, a saisi la sève de l’œuvre originelle pour en faire une œuvre d’auteur, qui renseigne autant sur le monde d’avant que sur notre monde actuel.
Une conscience de la modernité
Quoique, plutôt que de respect, Spielberg friserait presque avec l’obédience. Stephen Sondheim et Leonard Bernstein peuvent dormir tranquille : Tonton Steven n’a touché ni aux paroles de l’un ni aux compositions de l’autre. La sève est là. Mais modifiée par micro touches : Somewhere, à l’origine cri du cœur du duo amoureux, devient là le déchirement de Valentina (Rita Morena, qui jouait Anita dans le film original ; la boucle est bouclée) qui pleure un avenir où la paix pourra régner ; Doc, le pharmacien, devient donc Valentina, sa veuve, miroir de la relation Tony-Maria… Une manière pour Spielberg de signer sa paternité et s’éviter les procès d’inutilité d’une telle entreprise filmique. Il corrige en outre certaines erreurs du premier film, évitant le piège du white-washing, faisant réellement chanter ses interprètes… Sans doute y a-t-il là moins de féérie, moins de folie, mais l’œuvre y gagne investissement et émotion.

Enfin, Spielberg achève le somptueux tableau en montrant pourquoi faire un remake de West Side Story n’a pas le risque d’être suranné, dans une Amérique post-Trump. La question du port d’armes, de la préférence ethnique (les blancs restent les mieux traités par les autorités), celle de l’homophobie latente (un personnage clairement transgenre est conspué tout le film pour sa condition) ainsi que le rapport au melting-pot sont autant de thématiques déjà fortes dans les années 50, et d’autant plus aujourd’hui. Sans gros sabots, le réalisateur démontre toute la puissance d’un propos soixantenaire, comment le sentiment d’abandon et d’injustice crée le conflit entre deux clans qui partagent finalement les mêmes problèmes et les mêmes ennemis.
Place aux cowboys ?
West Side Story version 2021 ne surpassera jamais son aîné, c’est une certitude. Le prétendre, c’est tendre à la folie d’imaginer qu’un film aux 10 Oscars puisse être aussi facilement réadaptable. Avec toute sa modestie et sa rigueur, Steven Spielberg réussit pourtant le tour de force de moderniser un chef-d’œuvre. D’en faire une œuvre propre, où le rapport à l’humain est toujours présent, où le regard s’attendrit et se durcit coup sur coup, chaque rouage technique étant une démonstration sans accrocs d’un cinéaste que l’on sait depuis longtemps accompli. Un cinéaste adulte, pas le plus subtil, mais qu’importe, qui comprend mieux que quiconque ces enfants perdus dans ce monde désabusé, et qui les filme avec d’autant plus de tendresse. Steven Spielberg avait deux rêves à accomplir avant de rendre les armes : réaliser un musical. C’est chose faite. La deuxième ? Un western. Tâche de prouver qu’après Robert Wise, ce sera un John Ford ou un Howard Hawks qui auront les honneurs de voir le plus moderne des cinéastes nostalgiques s’attaquer à un genre qui, lui aussi, aura offert au cinéma ses plus grands rêves de grandeur.
West Side Story est distribué par la 20th Century Fox, et surement en salles près de chez vous.

La preuve que remake ne rime pas avec fainéantise. Steven Spielberg se réapproprie le mythe de la comédie musicale, lui apportant la grandiloquence de sa mise en scène et le regard attendri de l’enfant qui admirait, jadis, Natalie Wood. Une réussite formelle incontestable.



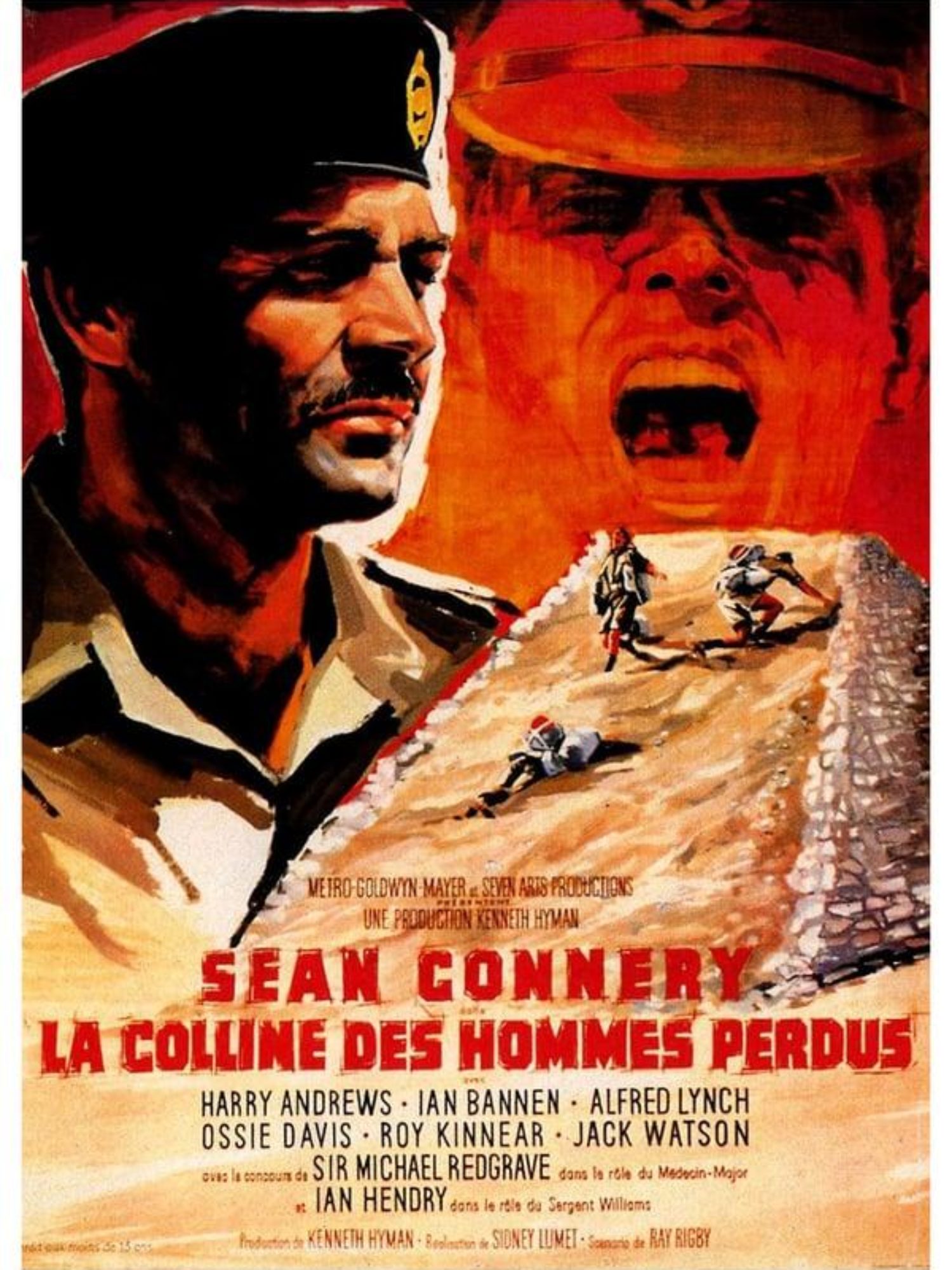


Ping : Les nominations aux Oscars - Les Réfracteurs