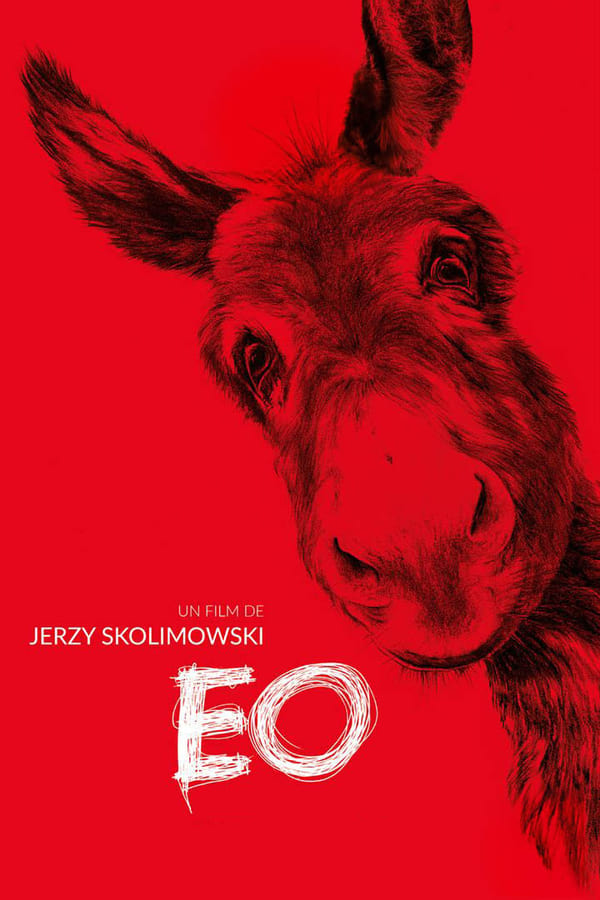
(Io)
2022
Réalisé par : Jerzy Skolimowski
Avec : Sandra Drzymalska, Isabelle Huppert, Lorenzo Zurzolo
Film vu par nos propres moyens
Après plus de soixante ans de carrière, le réalisateur Jerzy Skolimowski continue d’étonner le public au fil de ses longs métrages profondément déroutants. Pour appréhender la filmographie de ce porte-drapeau du cinéma polonais, il faut accepter de se perdre dans un labyrinthe artistique où les règles conventionelles du septième art sont torturées, malmenées et souvent brisées. Le metteur en scène semble souvent davantage expérimentateur de la caméra que conteur d’histoires, assumant pleinement la confusion que fait naître la plupart de ses œuvres. Depuis ses débuts, l’auteur impose sa vision et refuse de se plier au dogmes cinématographiques usuels, faisant de l’insoumission un moteur de sa démarche. Toutefois, si Jerzy Skolimowski est un électron libre au regard troublant, son talent est reconnu internationalement dans les festivals du monde entier. De Berlin à Cannes en passant par Venise, le rebelle est un habitué des récompenses, qu’elles honorent ponctuellement l’un de ses films ou l’ensemble de sa carrière. Dès 1967, Le départ récolte ainsi un Lion d’Or et confère au réalisateur une réputation nouvelle qui lui permet de quitter l’Europe de l’est afin de tenter quelques incursions en Grande-Bretagne, notamment avec son chef-d’œuvre, Deep End, sorti en 1970. Entre succès public parfois timide et reconnaissance critique, l’artiste poursuit son périple sans se plier aux diktats commerciaux. Aujourd’hui âgé de 84 ans, il n’a rien perdu de sa fougue déroutante, de son envie de cinéma et de son aura. Avec EO, à la structure narrative sous forme de fuite perpétuelle proche de Essential Killing, un de ses films précédents, Jerzy Skolimowski continue d’attirer les regards des observateurs curieux, en s’inspirant de Au hasard Balthazar de Robert Bresson qui dénonçait déjà les tourments de l’âme humaine à travers les pérégrinations d’un âne, cette fois dans les Pyrénées des années 1960. Récompensé du prix de la mise en scène à Cannes et de nominations aux Césars et aux Oscars dans la catégorie “Meilleur film en langue étrangère”, le metteur en scène perpétue son héritage, entre réussite esthétique ponctuelle et échec scénaristique.
EO, c’est le nom d’un âne, héros du film éponyme, arraché au cirque où il effectue ses tours à la suite d’une réforme législative visant à garantir le bien-être des animaux. Confié aux soins de différents fermiers, l’animal est victime des turpitudes des hommes qu’il observe de son regard innocent. Incapable de trouver sa place dans un monde décadent, EO prend la fuite en quête d’un nouvel idéal, sans cesse contrarié par la folie humaine ordinaire.

Dans une expérience sensorielle relativement unique qui transcende le cadre habituel d’un long métrage, EO propulse le spectateur dans la peau de l’animal, seul support à l’identification. Presque tout le film se présente comme une invitation à devenir un âne et à en ressentir les angoisses, loin des contradictions du monde moderne souvent perçues à travers les yeux du protagoniste. L’incompréhension de ce personnage principal face à la déliquescence d’une société défaillante est au cœur de la démarche de Jerzy Skolimowski qui refuse à ce titre une part d’explication concrète à son récit, créant ainsi un sentiment profond d’impuissance. Si le long métrage est généralement bien trop grossièrement écrit pour que le drame ne tourne pas à la farce, le cinéaste réussit au moins la prouesse de captiver la vue et l’ouïe pour parvenir à offrir une vraie personnalité à Io, souvent plus sensible que les hommes. À travers une multitude de plans en vue subjective, mais surtout lors des longues séquences ne montrant que l’animal, isolé de son environnement par un jeu de focale habile, le public éprouve la solitude absolue de l’âne nomade. La sphère sonore accentue la détresse ressentie, notamment à travers des distorsions volontairement désagréables des bruits perçus par l’animal et par une récurrence de tonalités graves évocatrices d’une peur primaire, qui trouve son sens profond dans la conclusion de l’œuvre. La subtilité de l’exercice sensoriel était parfaitement suffisante pour susciter une adhésion implicite profonde, mais EO commet l’erreur d’exacerber les sentiments artificiellement. Les larmes qui coulent des yeux de l’âne au moment où il est arraché à sa dresseuse, ou un coup de sabot rebelle à un gardien néfaste, brisent la cohérence du récit, laissant à penser que cet animal ordinaire est en réalité hors du commun. L’attachement affectif n’est plus naturel, il devient factice, fabriqué par un réalisateur omniprésent. La fuite de EO reste néanmoins touchante. Puisque le récit en a fait de lui un être à part entière, sa volonté de s’émanciper de ses chaînes, qu’elles soient concrètes ou idéologiques, apparaît légitime et emporte les cœurs durant quelques instants malheureusement trop brefs. Les hommes sont les coupables moraux du film mais sont pourtant libres, tandis qu’EO est innocent par nature mais le plus souvent en cage. D’un affranchissement fantasmé entraperçu à travers des barreaux et illustré par des chevaux qui galopent fougueusement, le film bascule dans l’accomplissement concret de ce désir lorsque le protagoniste gagne la nature. Pourtant la faune et la flore sont hostiles au héros du long métrage, et le propos profond de Jerzy Skolimowski devient obscur, voire malhonnête. Sa narration partielle montrent ses limites dès l’entame de l’épopée, alors que le cinéaste assimile le cirque à un paradis perdu. Tout le reste de son œuvre est critique envers les humains, pourtant, durant des instants de communion, le film refuse de juger trop sévèrement celle qui contraint l’animal à effectuer des tours, se permettant même de les réunir dans une scène relativement pathétique de partage de gâteau.
Cet instant de bonheur éphémère et terriblement naïf accentue néanmoins intelligemment le contraste entre une sérénité disparue et des évocations récurrentes de la mort. Une fatalité constante plane sur le récit tandis que chaque rencontre entre l’homme et la nature semble vouée à faire naître une corruption profonde de l’environnement. Durant quelques secondes visuellement spectaculaires, des dizaines de viseurs lasers sont pointés sur des loups, dans les ténèbres de la nuit, avant que ne résonnent des coups de feu. L’humain est devenu prédateur et le pourvoyeur d’un déséquilibre que semble vouloir dénoncer Jerzy Skolimowski avec une grande maladresse. La déconnexion entre l’homme et la faune est si constamment martelée que l’issue du récit ne fait presque aucun doute et est d’ailleurs prophétisée par les premières minutes du film où EO est allongé, comme agonisant. La nature se meurt et est destinée à être remplacée par des avancées technologiques humaines d’apparence néfastes. EO est ainsi ponctué de séquences particulièrement perturbantes et nébuleuses, où l’écran se teinte uniquement de rouge et de noir pendant que le bien-être de l’animal est contrarié par les désirs de l’homme. De façon tout à fait inattendue, l’un de ces instantanés s’affiche après que l’âne ait été rué de coups par des hooligans idiots. La souffrance d’EO est conjuguée avec la vision saugrenue d’un robot à quatre pattes qui se relève après une chute, comme si la science triomphait terriblement de la faune. L’interprétation ne reste pourtant que supposition tant Jerzy Skolimowski s’enferme dans une logique de mystères malvenus qui gangrène son œuvre au point de la rendre douteuse. Lors d’une autre de ses scènes monochrome, le cinéaste vraisemblablement très heureux de pouvoir piloter un drône sur le tournage puisqu’il y passe de très longues secondes, confronte ouvertement l’image d’une éolienne à celle d’un oiseau mort. Écologie et cadavre se marient à l’écran, dans une relation de cause à effet particulièrement gênante. Impossible de discerner concrètement le propos du cinéaste autour des énergies renouvelables sans risquer de se heurter à une mentalité rétrograde et spéculer sur le parti pris idéologique de l’auteur, avec une pointe d’effroi. Cette séquence n’est qu’un des innombrables symptômes du mal profond d’EO. Jerzy Skolimowski revendique le droit légitime de nous faire vivre l’aventure à travers le regard de l’âne partiellement inconscient de la réalité, pourtant il semble bien que selon son bon vouloir, le cinéaste renonce à cette idée pour faire naître aléatoirement des réflexions plus denses et franchement étranges sur la société, sans jamais aboutir sur des conclusions claires malgré ses envolées esthétiques oppressantes. Les velléités politiques et philosophiques du réalisateur parasitent le concept initial, allant jusqu’à contredire le message de communion avec la nature. Le spectateur accepte une part de confusion voulue dès l’entame du récit, mais finit par se désintéresser presque totalement du périple face aux errances du film.

Fort heureusement, la dénonciation de la souffrance animale reste au cœur du long métrage. Malgré ses innombrables torts et grossièretés exaspérantes, EO mène un noble combat. Néanmoins, dans cette bataille pour retrouver un équilibre avec la faune, le film semble s’armer des mauvais outils. L’âne est un martyr d’une société humaine devenue folle, parfaitement perçue sans besoin d’exagérér à outrance les éléments de mise en scène, pourtant l’animal se voit étrangement doté d’une sensibilité et d’une psyché qui trahis à nouveau son unicité. EO n’est plus une simple victime supplémentaire de la démence des hommes lorsqu’il manifeste sa détresse envers des poissons enfermés dans leur bocal, dans un de ses seuls hennissements. Le long métrage lui confère une conscience supérieure artificielle et brise le pacte de la normalité avec le spectateur. Le héros devrait être impuissant face au monde dont il fait l’expérience, pourtant il exprime constamment son insoumission. EO en perdrait presque son caractère universel en incarnant trop explicitement l’âne. Malgré cet exemple d’un des nombreux élans irraisonnés du long métrage, quelques évocations plus subtiles de la condition animale défaillante parviennent à émouvoir avec davantage de tact, en restant implicites. Dans leur première apparition, les chevaux sont ainsi synonyme de liberté, de beauté face à l’aspect un peu grotesque de EO et de bons soins prodigués par l’homme, avant que le spectateur ne comprennent en même temps que le protagoniste que les propriétaires humains forcent un accouplement. En montrant les échidnés dans l’une des séquences en rouge et noir, prisonniers d’un parc équestre, leur mal-être est souligné relativement habilement. L’âne au cœur du film est lui-même victime de sa condition, condamné à régulièrement tirer des charrettes lourdement chargées, contre son gré, ou en étant réduit au rang de mascotte par des politiciens peu soucieux de son état. Toutefois, si Jerzy Skolimowski affirme fièrement à la fin de son œuvre qu’aucun animal n’a souffert pendant le tournage, il est permis de douter légitimement de son affirmation. Passé la réflexion autour de la fiction en elle-même, il convient de se demander si entourer un âne d’hommes hurlant et fumant tout contre son visage n’a pas angoissé l’animal sur le plateau.
Si la séquence provoque, à nouveau, une gêne certaine, elle demeure l’expression claire de ce que pense faire Jerzy Skolimowski, utiliser un protagoniste animal pour davantage parler de l’humain. EO est un observateur neutre sur l’ensemble de nos semblables. Dès lors, tout jugement moral porté par le spectateur sur les hommes et femmes du récit trouve une dimension originale. Le public ne fait plus partie de la masse, il est extérieur à cette société le temps du film. Âne et humain sont à ce titre souvent réunis allégoriquement. Lorsque l’animal tire sa charrette, le parallèle implicite avec le chauffeur routier montré quelques minutes plus tard, traînant la remorque de son camion semble évident. Malheureusement et tragiquement puisque c’est le cœur du récit, le film additionne paresse d’écriture et mauvais goût au moment de poser un regard acerbe sur l’humanité. L’acidité voulue par la logique du film le métamorphose en gigantesque pitrerie propice à une philosophie de comptoir détestable. Dans les rares moments où EO ne se camoufle pas derrière des scènes rigoureusement incompréhensibles, il expose les franches limites d’une pensée étriquée. Ainsi, si un gardien de but obèse devient héros du match, soufflant l’idée qu’un être au physique différent peut lui aussi tutoyer la gloire, Jerzy Skolimowski ponctue la scène d’un amalgame effroyable autour des supporters de football, forçant le spectateur à admettre qu’une équipe amateure peut avoir des hooligans et que d’une façon grotesque, les adeptes de sport sont tous de véritables benêts. EO est une œuvre d’un autre temps, jamais réellement critique et perpétuellement aigrie. L’acmé de ce regard absurde, voire dangereux sur le monde est atteinte lorsque sur une aire d’autoroute, des migrants sont montrés égorgeant un homme sans raison valable. Nul doute que le cinéaste à une idée profonde derrière son geste, qu’on espère moins détestable que ce qui s’affiche à l’écran, mais il échoue lamentablement à la communiquer au spectateur. Le long métrage en devient frauduleux, puisque plus les minutes s’égrènent, moins le public est mis dans la peau de EO. Le réalisateur démissionnaire abandonne progressivement son idée originale pour s’écarter de l’âne et ne cibler que l’homme, dans des instants qui non seulement n’apportent rien au récit, mais en plus perdent toute consistance. Trouver un sens profond au segment mettant en scène Isabelle Huppert devient un véritable défi. Son apparition n’est qu’une pierre de plus dans un gigantesque monticule de l’escroquerie intellectuelle.

Puisque tout est permis dans ce royaume de l’absurde, puisque la vision du monde est biaisée, et puisque de toute façon EO ne respecte même pas le contrat initial avec le spectateur, impossible d’admettre le film en tant que satire cohérente de la société. Vivre le long métrage pour sa beauté esthétique ponctuelle reste possible et se noyer dans une expérience abstraite pourrait même être pertinent et enrichissant. En poursuivant sur cette voie , installer des situations et laisser libre cours au spectateur de tirer ses propres conclusions est un exercice ludique que des milliers de cinéastes pratiquent régulièrement, avec brio. Malheureusement, ce n’est absolument pas le cas de EO, qui ressemble davantage au monologue d’un vieil homme à la vision arriérée qu’à une conversation philosophique sur l’état réel du monde entre auteur et spectateur. Soucieux de ponctuer chacune de ses scénettes par un étalage tapageur de son maniement de la caméra, Jerzy Skolimowski oublie d’offrir des respirations au public pour laisser planer la réflexion voulue. Au comble de la prétention, le metteur en scène agresse de ses images dépourvues de toute logique, comme l’illustre un plan sur skieur montré à l’envers, disposé ici de manière hasardeuse. La suréthétisation perpétuelle invite sans cesse à considérer que le cinéaste est le seul à connaître le but de sa démarche, qui est dès lors complètement vaine. Entre rétention des réponses quand cela arrange son auteur et harcèlement par des visuels incongrus, EO perd toute sa tension dramatique et devient un calvaire.

Difficile de comprendre où cherche à aller EO, si toutefois il a une destination claire dans son périple scénaristique. Noyé sous un orgueil éprouvant et caché derrière un mystère factice, Jerzy Skolimowski livre un film qui ne vaut presque que pour l’exercice esthétique.

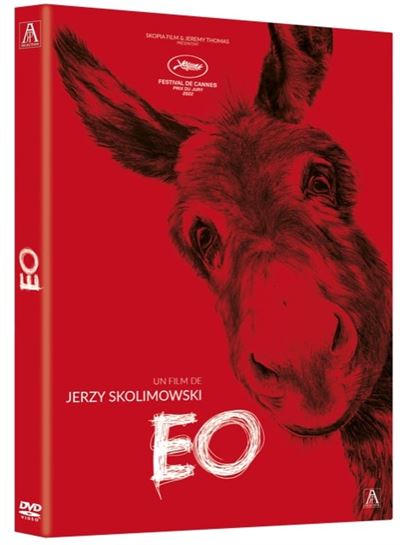

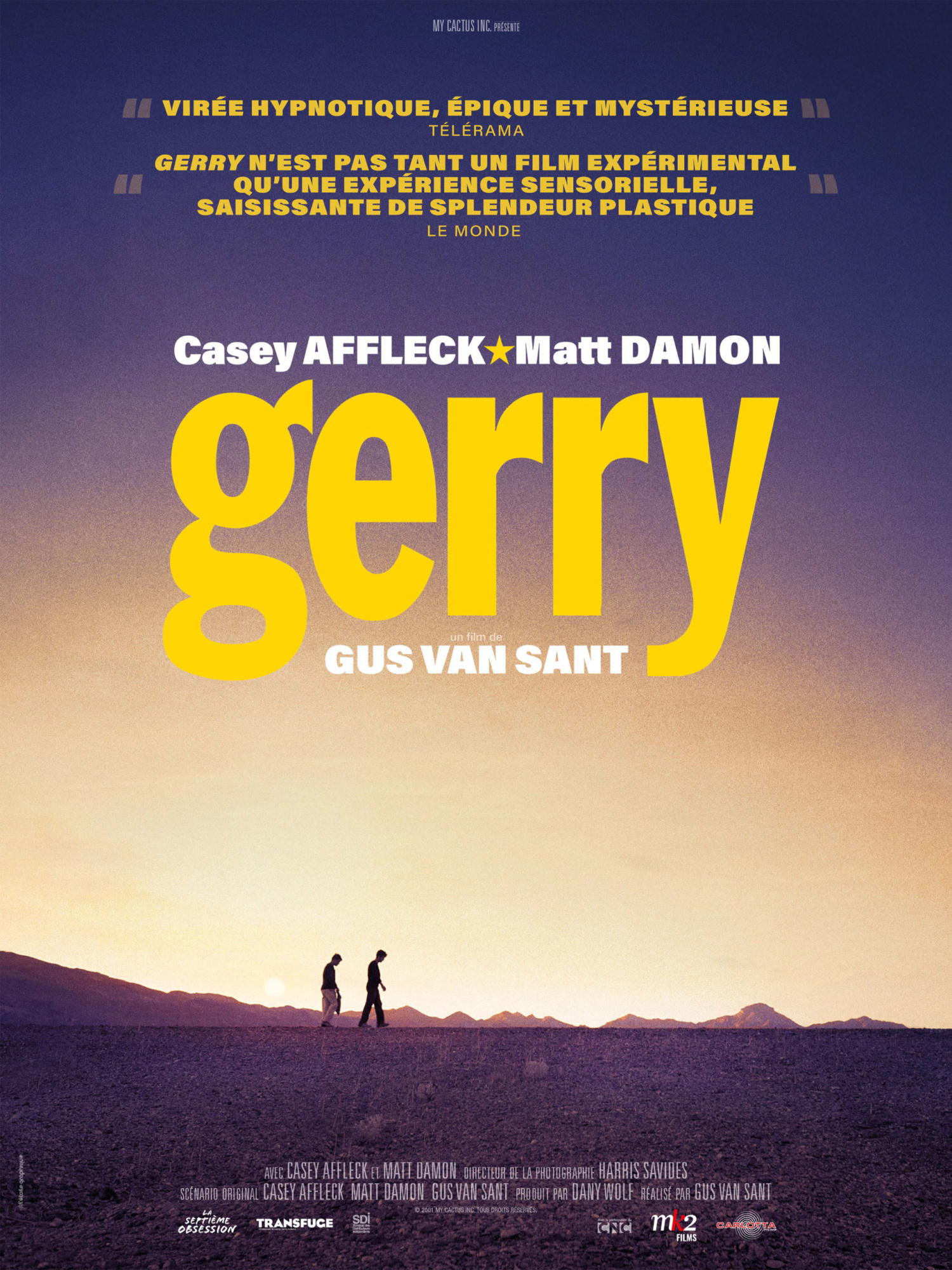


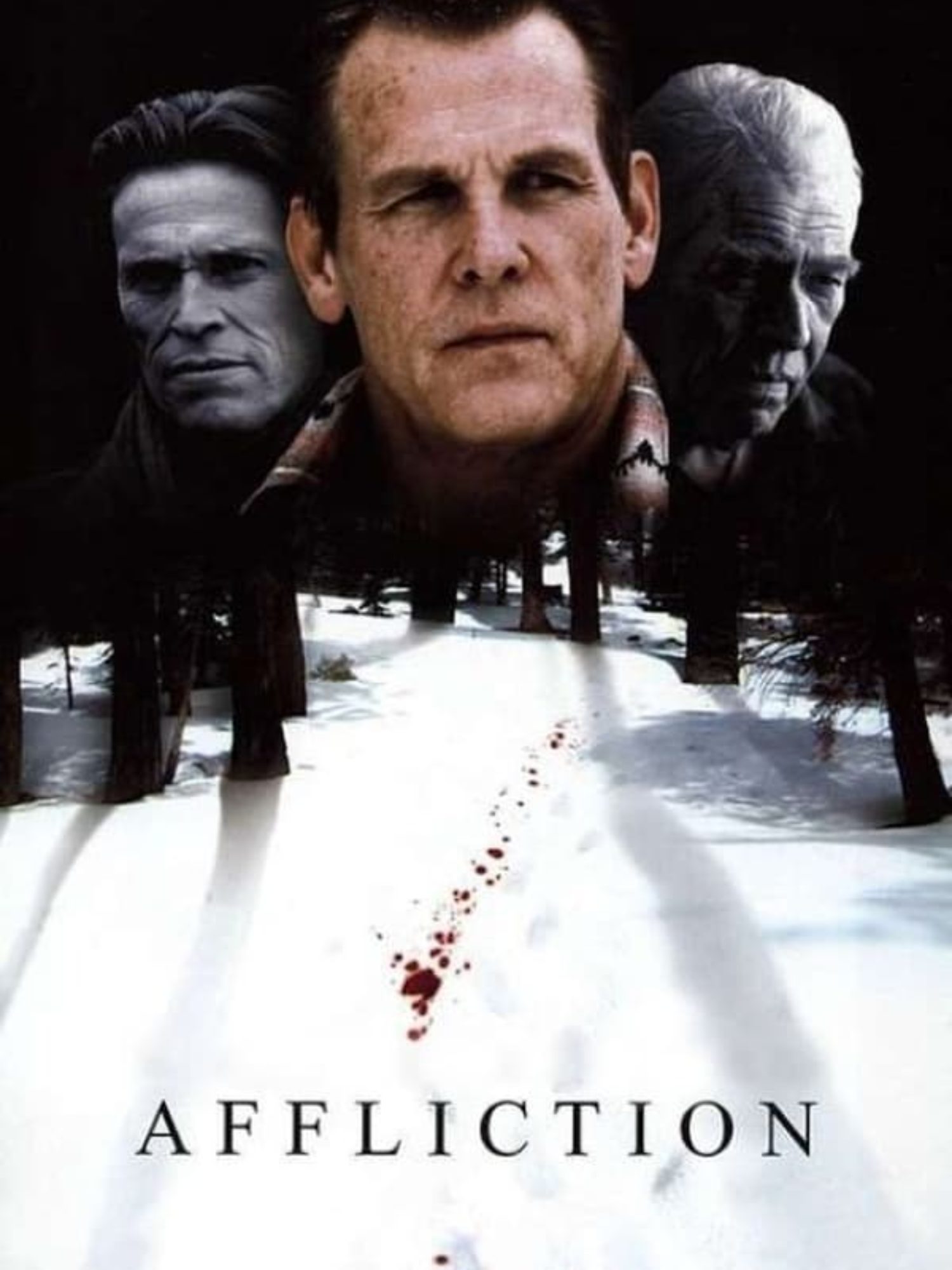
Ping : Les nominations aux Oscars 2023 - Les Réfracteurs
« L’un de ces instantanés s’affiche après que l’âne ait été rué de coups » lapsus révélateur, – roué de coups. Cette ruade contre le film EO est brutale. Ce film m’a bouleversé. Je me suis attaché à cet âne. Et le plan final m’a chopé parce que je ne m’y attendais pas. Le premier plan est sublime de beauté. La denonciation de l’usage des ânes même pour servir une bonne cause – des personnes handicapées- est dérangeante parce qu’elle dénonce toutes les formes de domination comme celle drapée sous une noble cause. C’est un film dérangeant, cruel mais utile.