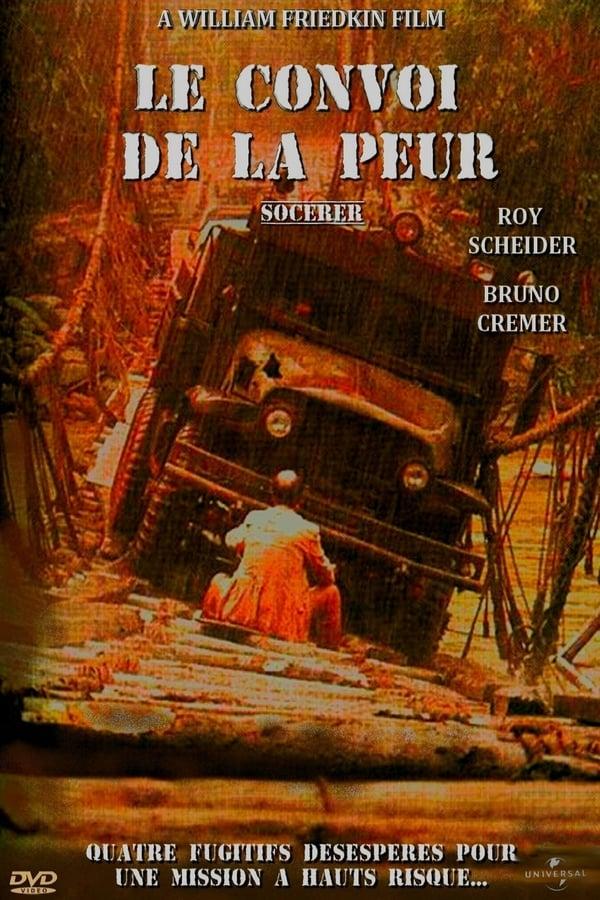
(Sorcerer)
1977
réalisé par: William Friedkin
avec: Roy Sheider, Bruno Cremer, Francisco Rabal
D’un même livre, “Le salaire de la peur” de Georges Arnaud, deux cinéastes peuvent tirer des films très différents. La vision de l’écrivain se confronte à celle des réalisateurs: chaque auteur, qu’il gratte le papier ou déroule les pellicules, s’approprie l’histoire, lui donne une couleur particulière et donc une identité propre. Alors que ce matin nous évoquions le premier long-métrage de Henri-Georges Clouzot tiré du roman, c’est une journée un peu spéciale qu’on vous propose en nous penchant ensemble maintenant sur son remake de William Friedkin, au tournage parmi les plus galères de l’Histoire du septième art et pourtant un vrai chef-d’oeuvre. Deux films cousins mais tout de même parfois éloignés dans leur approche: jeu des différences et ressemblances avec “Le convoi de la peur” (A.K.A. “Sorcerer”)
Pour ce qui est du scénario, on prend à peu près le même postulat et on replonge: coincé aux fins fonds de l’Amérique du Sud, quatres voyous en cavale vont accepter un job périlleux pour quitter le pays. Leur mission? transporter des caisses de nitroglycérine hautement volatiles à plusieurs kilomètres de là. Simple souci, le moindre chaos dans la route peut être synonyme d’explosion et donc de mort pour ces casse-cous poussés au bout d’eux-mêmes.
C’est avec un grand respect pour le film originel d’Henri-Georges Clouzot que William Friedkin va aborder “Le convoi de la peur”, qu’il dédie d’ailleurs au cinéaste français. Friedkin est conscient de l’héritage qu’il porte en dépoussiérant un véritable film culte, et le réalisateur va totalement épouser cette mécanique des deux camions qui poursuivent leur funeste course à distance. Un ludisme dans l’écriture qui font de l’œuvre un véritable thriller avant d’être un drame humain. Signe du temps qui passe et de la grammaire cinématographique qui évolue, Friedkin va employer de nombreuses ellipses, bien plus que dans le film de Clouzot. On reste sous pression perpétuelle dans “Le convoi de la peur”, peut-être davantage que dans le film de 1953 malgré un déroulé relativement similaire.
Là où Friedkin va se démarquer également, c’est dans la façon d’appréhender le destin des quatres aventuriers. Si Clouzot donnait un cadre social clair, faisant du “Salaire de la peur” un film parfois militant, Friedkin va en fait lui se concentrer bien plus sur l’humain, troquant la politique pour la philosophie, voire une forme de mysticisme comme l’évoque le titre en version originale (“Sorcerer”). Certes, on voit toujours le patronnat qui réduit en esclavage ceux qui ont tout perdu, mais l’essentiel ne semble plus réellement là.

« Et en plus il flotte. »
Friedkin va d’ailleurs développer un peu plus que Clouzot les destins croisés de ses protagonistes. Si c’est principalement le hasard qui réunissait les quatres larrons dans “Le salaire de la peur”, “Sorcerer” fait le choix de creuser ces personnages et de les unir par un fait du destin commun: ils sont tous des bandits plus ou moins flamboyants qui ont tout perdu à vouloir trop jouer. Les héros ne sont plus des paumés, ils sont des parias.
En conséquence presque directe, Friedkin va tracer une limite entre la raison et la folie beaucoup plus floue que celle de Clouzot. Le français réfléchissait à la “prise d’otage économique”, l’américain va venir chercher quelque chose de plus viscéral. Ses personnages principaux sont plongés dans l’enfer et s’accrochent malgré tout à un espoir factice, presque impossible à concrétiser. À quel moment l’humain lâche-t-il la rambarde du bon sens pour se jeter dans le vide? Il semblerait que les héros du “Convoi de la peur” soit des hommes en pleine rupture, presque déments.
Si Clouzot choisissait de centrer son récit principalement sur deux des quatres larrons, Friedkin fait le choix lui d’être plus chorale dans son approche. Compliqué de mettre en lumière un de ces bandits plus que l’autre tant le cinéaste s’amuse à renvoyer la balle entre eux. Il esquisse une idée commune de l’être humain, mais à eux quatre dans leur ensemble, pas dans un rapport de force factice. “Le convoi de la peur” pourrait sembler plus complet que son ancêtre.
En véritable métronome du film, le montage de Friedkin apparaît virtuose. On est pris de vertiges devant la maîtrise et le rythme du cinéaste, pris à la gorge pendant deux heures, suant à grosses gouttes devant chaque regain de tension. Friedkin ne nous lâche pas, son enchaînement de prises de vue est l’artifice numéro un d’un film où le suspense est la clé, la signature d’un auteur.
Dans sa photo, le réalisateur va convoquer la nature dans ce qu’elle a de plus destructrice. Torrents de boue, pluie diluvienne, gerbes de flammes: le monde se déchire dans “Le convoi de la peur”, à tel point que le parcours du combattant des 4 héros prend des allures de calvaire surnaturel. Dans les couleurs qui émanent de la pellicule se forge l’identité d’un film aussi unique que respectueux de son matériel de base.

“Le convoi de la peur” transcende son aîné grâce à son respect mais aussi à son style propre et assumé. Un classique du thriller complètement intemporel.

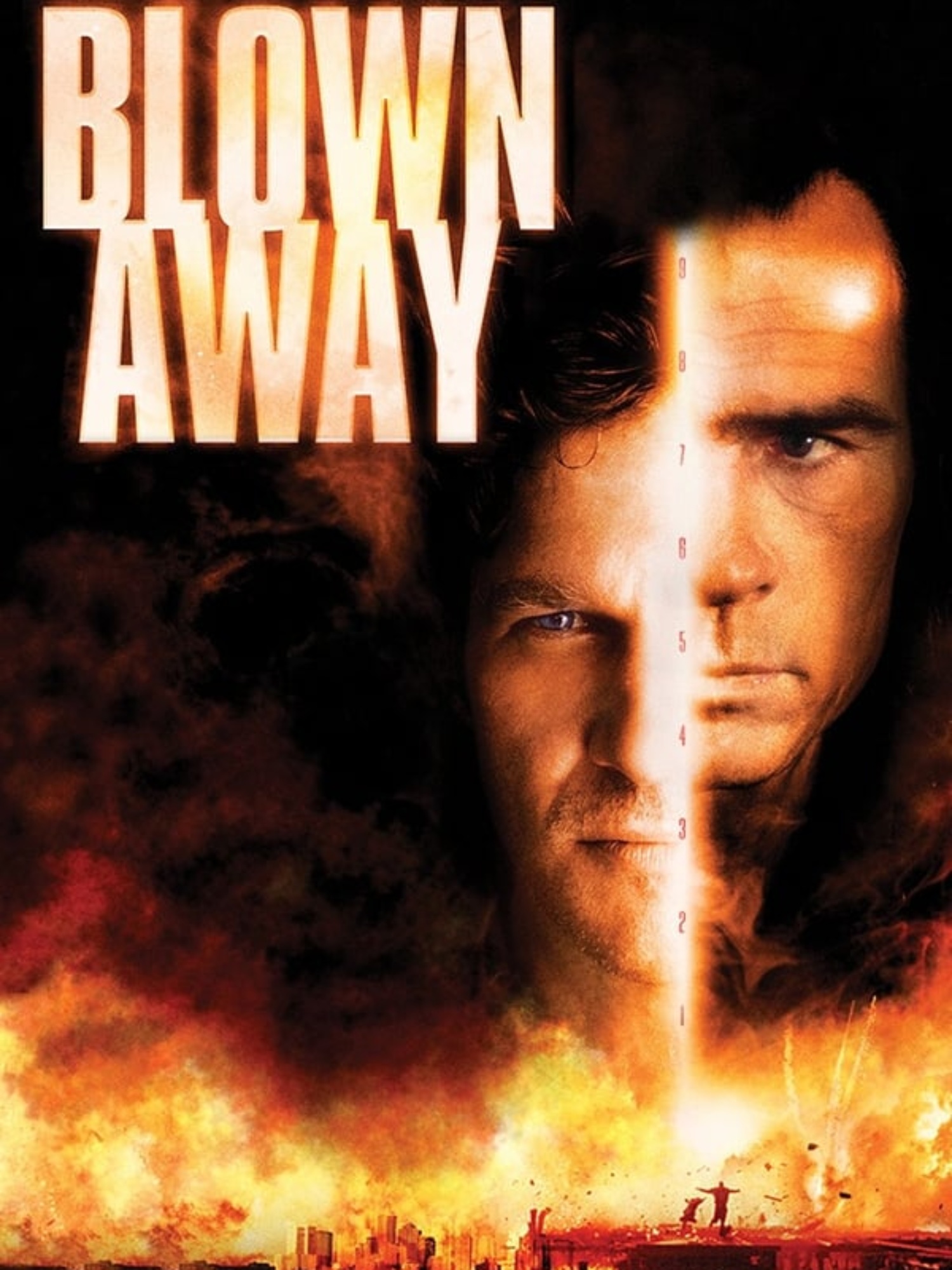


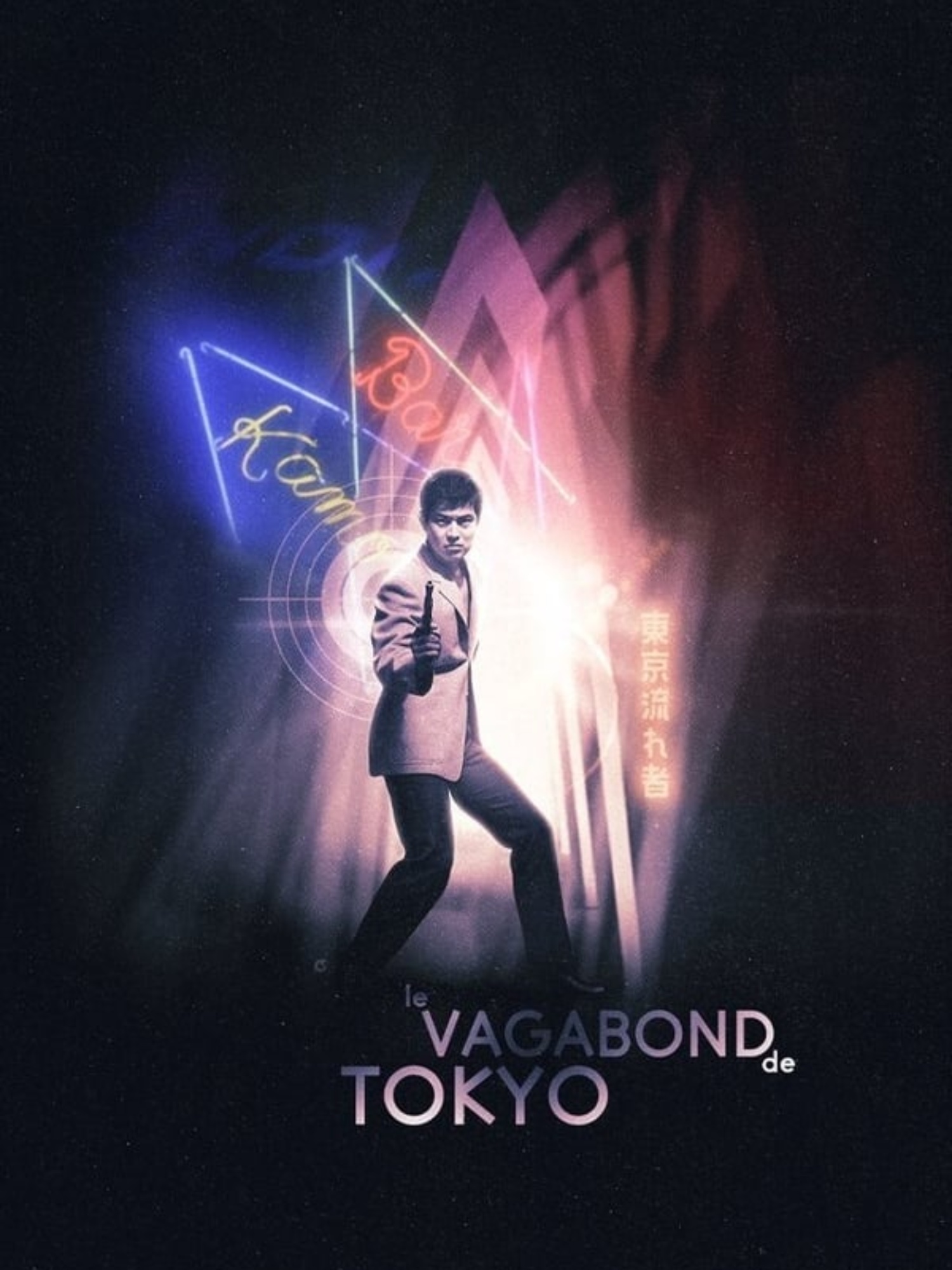

Ping : Les Garçons de la Bande - Les Réfracteurs