
(Im Westen nichts Neues)
2022
Réalisé par : Edward Berger
Avec : Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer
Film vu par nos propres moyens
En 1929, Erich Maria Remarque, romancier allemand, publie À l’ouest rien de nouveau. Ouvrage pacifiste évoquant la première guerre mondiale du point de vue d’un jeune soldat allemand, le livre est un succès mondial dès sa sortie et reste encore aujourd’hui incontournable. Dans l’Allemagne nazie, sa vision et sa dénonciation de l’absurdité de la guerre n’est pas appréciée et le livre est victime d’autodafés. L’écrivain est d’ailleurs destitué de la nationalité allemande en 1938.
En 1930, un an après sa parution, le roman connaît sa première adaptation cinématographique avec le film éponyme réalisé par Lewis Milestone, puis un téléfilm par Delbert Mann est sorti en 1979. Fin 2022, la troisième adaptation du roman voit le jour sur Netflix, réalisée par l’allemand Edward Berger. Récompensé notamment de 7 BAFTA, dont ceux du meilleur réalisateur et du meilleur film, et jouissant de 9 nominations aux prochains Oscars, À l’ouest rien de nouveau n’a en rien démérité son succès et se pose en digne héritier du long-métrage de 1930, récompensé lui des Oscars du meilleur film et du meilleur réalisateur.
Paul Bäumer, jeune soldat allemand, se retrouve sur le front occidental pendant la Première Guerre mondiale, avec ses camarades de classe. Incités à s’engager par leurs professeurs qui voient en eux les héros de demain, ils font face à l’épouvante à peine arrivés dans les tranchées. L’euphorie des débuts se transforme en immense désillusion.
Le film débute par des scènes de vie : la forêt, les animaux vivant paisiblement… Puis la guerre se fait entendre et résonne au loin. C’est à présent à une vision d’horreur que nous sommes confrontés, désormais face à une étendue de cadavres de soldats, dans une ambiance glaciale. L’infamie au front nous frappe dès les premières minutes, les premiers combats, et Edward Berger nous immerge d’hors-et-déjà dans les tranchées. Ces soldats tombés au combat vont être entassés dans des fosses communes et dévêtus afin que leurs uniformes soient lavés, recousus et servent alors à de nouvelles recrues, envoyées à leur tour au front. Déjà, cette scène est intense et prend aux tripes, portée par la merveilleuse musique dramatique de Volker Bertelmann et ces trois notes mécaniques qui reviennent régulièrement nous saisir. Les vies perdues sont rapidement remplacées par de la chair fraîche. Ces nouvelles têtes, ce sont Paul Bäumer (Felix Kammerer) et ses camarades de classe, poussés par leur professeur à aller combattre pour leur pays. Exaltés par l’envie d’être des héros et de servir la nation, ils déchantent rapidement une fois au front et se rendent compte de l’horreur qu’ils vont vivre. Ils veulent d’ailleurs très vite rentrer chez eux, regrettent leur choix d’être partis sur le champ de bataille et ne veulent pas participer à cette boucherie sanguinaire.
“Feu roulant, tir de barrage, rideau de feu, mines, gaz, tanks, mitrailleuses, grenades, ce sont là des mots, des mots, mais ils renferment toute l’horreur du monde.”
Le film nous donne de la violence à voir à tous les niveaux, qu’elle soit physique ou morale. La mort est omniprésente, perpétuelle, et Edward Berger n’hésite pas à montrer au spectateur la réalité de la guerre, en nous offrant des scènes crues, choquantes. Des corps déchiquetés suspendus aux arbres, des hommes qui se font écraser, exploser… Le sang coule à flot. La monstruosité de la Grande Guerre n’est pas implicite à l’écran, bien au contraire, ce qui appuie ce sentiment de dégoût et de pitié. Comme dans l’œuvre d’Erich Maria Remarque, la cruauté de la guerre est détaillée, ici aidée par le travail minutieux de Heike Merker. Le rendu est très réaliste et son maquillage traduit l’horreur de la guerre et le ressenti des personnages : le teint est terne, couvert de terre, de sang, on y lit l’épuisement, la faim, les dents sont jaunies… Il appuie les regards de détresse. Plusieurs fois, de longs plans s’arrêtent sur les yeux transperçant des hommes, sur un visage couvert de boue, où l’on perçoit l’horreur au travers de celui qui la vit, entre rage et détresse. La photographie dirigée par James Friend accentue ce contraste entre haine et lueurs d’espoir, insistant sur les regards et expressions des soldats, en jouant avec la lumière et le cadrage d’une manière parfaite. Les scènes sont sombres, dans des tons glacials, ce qui accentue le côté sinistre et glauque. Les couleurs suivent les saisons et respectent ici grandement les descriptions d’Erich Maria Remarque dans l’œuvre originale. L’abomination de la guerre est parfois montrée plus implicitement, simplement illuminée par les fusées éclairantes utilisées par les soldats et unique source de lumière dans la nuit noire. Parfois, l’horreur apparaît en fond, pas au premier plan, mais rappelle au spectateur que la mort est partout. De merveilleux plans donnent également une portée fantomatique aux combattants, où l’on ne distingue que leur silhouette, comme s’ils étaient déjà morts et privés d’identité.
Pervertie, la nature apparaît aussi inanimée. Sur le champ de bataille, plus de verdure, les flaques d’eau et de boue sont confondues avec le sang. La nature finit elle aussi par être un lieu de tuerie alors qu’on nous y montrait la vie au début.
Dans les tranchées, pas d’hygiène, les soldats étaient toujours sales, souvent trempés, vivaient aux côtés des rats et étaient bien souvent infestés de poux. De plus, ils portaient des uniformes et des armes beaucoup trop lourds. Peu de victuailles les attendaient, et pas toujours convenables, ils souffraient énormément de la faim mais aussi de dysenterie. Les quelques bons repas partagés, plus consistants que des bouts de pain, sont d’ailleurs de rares moments de joie, bien que de courte durée, comme dans ces scènes du long métrage où Kat (Albrecht Schuch) et Paul vont chercher une oie dans une ferme française puis partagent ensuite leur butin avec leurs camarades, heureux.
Les soldats se rattachent à ce qu’ils peuvent pour combler l’horreur de cette guerre, et la fraternité et la solidarité au sein du camp est une notion importante et mise en valeur, leur permettant de s’échapper un peu. Le temps de quelques instants, ils rient, débattent, rêvent… Des moments d’humanité face à la barbarie.
Les femmes ne sont pas absentes du film mais évidemment très peu montrées. On les aperçoit par moments à l’arrière du front, mais elles participent à l’effort de guerre et en souffrent aussi. Comme des robots, elles remettent à neuf les uniformes de soldats tombés au combat, elles attendent des nouvelles de leur époux, elles subissent leur absence et bien souvent leur décès. Elles représentent surtout pour ces hommes la vie d’avant, l’espérance d’une existence simple et heureuse, hors des tranchées. Les jeunes recrues fantasment et ces femmes sont un souffle pour eux, les entraînant un instant loin de l’horreur du front, symbolisée notamment dans le long-métrage par ce foulard, récupéré auprès du jeune française par Franz (Moritz Klaus) et présent jusqu’à la toute fin, ou encore ce bout d’affiche auquel s’adresse Albert (Aaron Hilmer) et qu’il emporte avec lui. Des moments précieux pour eux, car la guerre laisse peu de place à l’humain et change à tout jamais ces gens simples.
« Nous sommes devenus des animaux dangereux, nous ne combattons pas, nous nous défendons contre la destruction.”
Ici, on a à faire à une déshumanisation totale, les combattants ne sont plus que des machines de guerre, agissant de manière bestiale, avec un certain automatisme. Ce qui est frappant, c’est la rapidité avec laquelle on passe de l’effroi à la fureur, puis la joie, puis la tristesse, et ainsi de suite… Ils meurent en un claquement de doigts, de manière affreuse, puis on passe vite à autre chose. Pas le temps pour le sentimental sur le champ de bataille, ils s’apitoieront sur leur sort plus tard, s’ils en ont au moins l’occasion. La guerre est un piège qui se referme sur eux à grande vitesse, qui les écrasent parfois littéralement, comme lors de cette scène horrible où ils sont assaillis par les chars français. Malgré le point de vue du côté allemand, les soldats des deux camps se confondent parfois, ils sont mêlés, condamnés à la même peine.
Peu de compassion possible, seule compte la survie. La haine est présente dans les deux camps, mais elle se transforme souvent rapidement en regret et en dégoût de soi, lorsque l’un d’entre eux se rend compte de ses actes d’une rare violence. Scène clé du film et du livre, d’une intensité émotionnelle folle, on retient l’effroi et la pitié ressentie lorsque Paul se retrouve dans un cratère aux côtés d’un soldat français et qu’il le tue. À l’écran, le comédien Felix Kammerer, qui démontre son talent constamment pour son premier film, nous offre particulièrement une performance à couper le souffle dans cette séquence. Les gémissements de ce “camarade” français agonisant, la prise de conscience de Paul quant à l’absurdité de la guerre et sa culpabilité arrêtent le temps et donnent clairement des frissons. “Pardonne-moi, camarade : comment as-tu pu être mon ennemi? Si nous jetions ces armes et cet uniforme, tu pourrais être mon frère.”
Se battre pour la patrie, pas vraiment, plutôt pour ne pas mourir. Tuer pour ne pas être tué. Des témoignages d’anciens combattants, déchirants, attestent d’ailleurs du fait qu’ils défendaient surtout leur peau avant la patrie, qu’ils n’étaient pas là par choix et qu’ils ne savaient même pas exactement pourquoi ils se battaient. Et si l’un d’eux avait le malheur de vouloir déserter ou de désobéir, le sort réservé était tout aussi abominable. Une seule question revient alors sans cesse : pourquoi des millions de vies sacrifiées ?
“La notion d’une autorité, dont ils étaient les représentants, comportait, à nos yeux, une perspicacité plus grande et un savoir plus humain.”
La vie est ôtée à ces hommes au profit des autorités, d’un nationalisme révulsant, voilà ce qu’il en est. Les véritables responsables de cette boucherie ne sont évidemment pas ces pauvres soldats envoyés au front mais les institutions politiques, bien planquées à l’arrière, envoyant des hommes par milliers à l’abattoir. Edward Berger choisit dans son film d’étaler l’histoire de l’été 1917 jusqu’à l’heure de l’Armistice, le 11 novembre 1918 à 11h, tandis que l’œuvre d’Erich Maria Remarque se termine plus tôt, lorsque Paul meurt brusquement en octobre 1918, “par une journée qui fut si tranquille que le communiqué se borna à signaler qu’à l’ouest il n’y avait rien de nouveau”. Le réalisateur ajoute alors des personnages historiques à son œuvre. On peut voir Matthias Erzberger (Daniel Brühl) , homme politique envoyé par l’Allemagne afin de négocier un cessez-le-feu et qui signe l’Armistice avec le maréchal Foch (Thibault de Montalembert) dans un train en forêt de Compiègne, qui souhaite imposer ses conditions, refusant toute négociation. Les politiques allemands savent que la guerre est perdue, qu’il est temps d’en finir, pourtant ils souhaitent continuer à se battre. Erzberger tente de les raisonner en leur disant qu’il faut cesser le massacre et que trop de victimes ont été faites et ce sera encore le cas s’ils ne décident pas d’un cessez-le-feu. Plus que les autres, il a conscience de la monstruosité de cette guerre et se heurte aux institutions françaises qui ne plieront pas sans contrepartie et à la fierté des dirigeants allemands.
Edward Berger cherche à démontrer le contraste entre les classes dirigeantes et la vie des soldats dans les tranchées. Ces derniers vivent l’horreur absolue pendant que les premiers sont à l’abri, profitant de nourriture à foison, ne manquant de rien. Détail frappant, même le chien du général profite des mets goûteux bien au chaud alors qu’au front, des hommes souffrent de la faim et vivent dans des conditions terribles. Le but est bien de susciter l’indignation et d’inviter le spectateur à la prise de conscience : le vrai antagoniste de l’histoire, ce n’est pas le soldat ennemi, c’est une classe dirigeante, qu’elle soit allemande ou française, et des jeunes sont mis à mort pour l’intérêt de vieux imbéciles. Des jeunes soldats qui ont finalement un désintérêt absolu de la défaite mais une joie collective de la fin des combats, que ce soit enfin fini, ou presque. Alors qu’il reste peu de temps avant l’Armistice, le général renvoie les troupes au combat, afin de récupérer des terres françaises et qu’ils puissent repartir en héros. Cette dernière attaque est d’un intérêt totalement absurde et aboutit sur de nouvelles pertes qui auraient pu être évitées. Puis, alors que sonne l’Armistice, Paul tombe à son tour au combat.
Avec un pouvoir d’endoctrinement très fort, représentant de la sagesse et du savoir pour les jeunes étudiants, le professeur nationaliste qui convainc Paul et ses camarades de s’engager est tout aussi responsable. “Ils auraient dû être pour nos dix-huit ans des médiateurs et des guides nous conduisant à la maturité, nous ouvrant le monde du travail, du devoir, de la culture et du progrès – préparant l’avenir.” L’instituteur est pour eux un modèle, la voix de la raison, et lorsqu’il glorifie la guerre, qu’il leur fait comprendre qu’ils sont l’espoir de la nation, “la jeunesse de fer”, les garçons pensent naïvement qu’ils vont devenir des héros et c’est pour eux une excitation immense. Embrigadés par la propagande nationaliste, ces jeunes ne sont que de la chair à canon, envoyés se faire tuer au nom de la patrie. La mort du personnage de Kat, elle aussi différente du roman, n’est pas insignifiante. En allant de nouveau voler des vivres à la ferme française avec Paul, juste après l’annonce de l’Armistice prochaine, parlant de l’après, il se fait tirer dessus par un jeune garçon français. La haine est visible dans ses yeux, alors que ce n’est qu’un enfant, et il n’hésite pas à porter le coup qui sera fatal à Kat. La génération future est pervertie, et la vengeance consume l’homme.
Des millions n’en ressortiront pas vivants, et pour ceux qui s’en sortiront, cela ne se fera pas sans séquelles physiques et psychiques. Que leur restera-t-il ?
« La guerre a fait de nous des propres à rien. »
Il a raison, nous ne faisons plus partie de la jeunesse. Nous ne voulons plus prendre d’assaut l’univers. Nous sommes des fuyards. Nous avions dix-huit ans et nous commencions à aimer le monde et l’existence ; voilà qu’il nous a fallu faire feu là-dessus.
Finalement, vaut-il mieux mourir au combat ou s’en tirer ? C’est une question que les personnages d’À l’ouest rien de nouveau se pose régulièrement. En finir avec tout ça ou rentrer, mais pour devenir quoi ?
Un autre passage du livre absent dans le long métrage, pourtant très important dans le roman, est la permission de Paul, rentré chez lui quelques temps. Ce moment de l’histoire explique comment de retour chez eux, ces combattants ne se sentent plus à leur place, incompris, dans une société où ils ont l’impression d’être étranger. Les gens à l’arrière du front n’ont pas conscience de ce qu’est réellement la vie dans les tranchées, les combats, ils minimisent l’horreur de la guerre et pensent avant tout aux enjeux territoriaux et politiques. Les jeunes combattants n’ont plus de rêves, ils sont déprimés, fatigués, ne savent pas ce qu’ils deviendront. Ils ont perdu leur âme au combat, certains la vie, les autres rentreront avec des blessures de guerre, des traumatismes, des “gueules cassées”… Personne ne revient indemne. L’horreur est imprimée à vie sur le corps ou dans l’esprit. Le champ de bataille change tout à jamais ceux qui ont pu rentrer. Dans son film, Edward Berger choisit de ne pas évoquer ce passage de la permission, pourtant incontournable de l’œuvre originale, mais Paul et ses camarades discutent de l’après. Ils ont peur, sont perdus, n’ont jamais connu rien d’autre que la guerre et tuer, pensaient être des héros alors qu’ils ne sont finalement plus rien.
Pour les morts au combat, beaucoup de soldats ne seront jamais identifiés, une identité perdue au milieu des ruines du champ de bataille. Les médaillons qui permettent l’identification des soldats morts et le comptage des pertes sont récupérés par les camarades, on le voit d’ailleurs clairement dans le film, mais des milliers de soldats resteront anonymes et énormément sont encore ensevelis sous la terre aujourd’hui, encore retrouvés et parfois identifiés plus d’un siècle après. Pour les autres, ils resteront des “soldats inconnus”.
Edward Berger fait un choix très intéressant et significatif pour lui en terme de casting, en choisissant pour incarner ses jeunes héros des têtes inconnues au cinéma, des jeunes hommes que le spectateur n’identifie pas lorsqu’ils les découvrent. Il veut que l’on se dise en suivant leurs histoires que ces nouvelles recrues pourraient être notre frère, notre ami, nos étudiants… De jeunes gens comme vous et nous, des innocents embrigadés dans une abomination totale, une jeunesse sacrifiée. Des acteurs plus connus viennent compléter le casting, en personnages emblématiques et plus expérimentés, comme Matthias Erzberger et le maréchal Foch interprétés par Daniel Brühl et Thibault de Montalembert, que les français connaissent bien. Albrecht Schuch campe quant à lui l’un des personnages les plus importants de l’œuvre, Kat, un cordonnier illettré rusé et expérimenté, prenant sous son aile les jeunes recrues et notamment Paul. Il les aide à mieux vivre la guerre, à s’en sortir et fait preuve d’une camaraderie exemplaire. Personnage très touchant, il pousse Paul à poursuivre ses études après la guerre, ne souhaitant pas qu’il devienne simple cordonnier comme lui. Il aspire à une belle vie de famille à son retour. Malheureusement, aucun des deux n’en aura l’occasion. Paul perd ses camarades un à un, puis Kat, ce qui est très difficile pour lui. Il était pour lui l’espoir, un soutien vital dans l’enfer.
En faisant le lien entre cette jeunesse endoctrinée à qui l’on promet du rêve et de l’héroïsme et ces politiques à la fierté surdimensionnée, Edward Berger évoque clairement l’après Grande Guerre. Lorsque le général donne l’ordre de la bataille finale, pour finir sur une victoire, il accuse les sociaux-démocrates d’être responsables de la défaite, invoquant le fameux mythe du “coup de poignard dans le dos”. Légende reprise par Hitler, arrivé au pouvoir en 1933, et alimentant la propagande nazie. La suite, on la connaît tous…
À l’heure où le monde subit des relents de nationalisme à vomir, À l’ouest rien de nouveau résonne puissamment en nous. Film antimilitariste et en hommage à une jeunesse sacrifiée, il est la première adaptation par un réalisateur allemand, Edward Berger s’étonnant que cela n’ait jamais été fait par un de ses compatriotes et invoquant un devoir de mémoire, mais aussi un avertissement. Il faut cultiver la paix par la mémoire, ne jamais oublier pour ne pas répéter. Malheureusement, les Hommes ne semblent pas avoir tiré assez de leçons du passé. La guerre n’a pas d’origine, de couleur de peau, de religion, et peu importe le camp ou l’uniforme, l’Histoire reste la même et se répète sans arrêt. À l’heure où l’atrocité est de nouveau aux portes de nos frontières, cette nouvelle adaptation prend un nouveau sens et est importante.

À l’ouest rien de nouveau est disponible sur Netflix et le roman d’Erich Maria Remarque dans toutes les librairies.





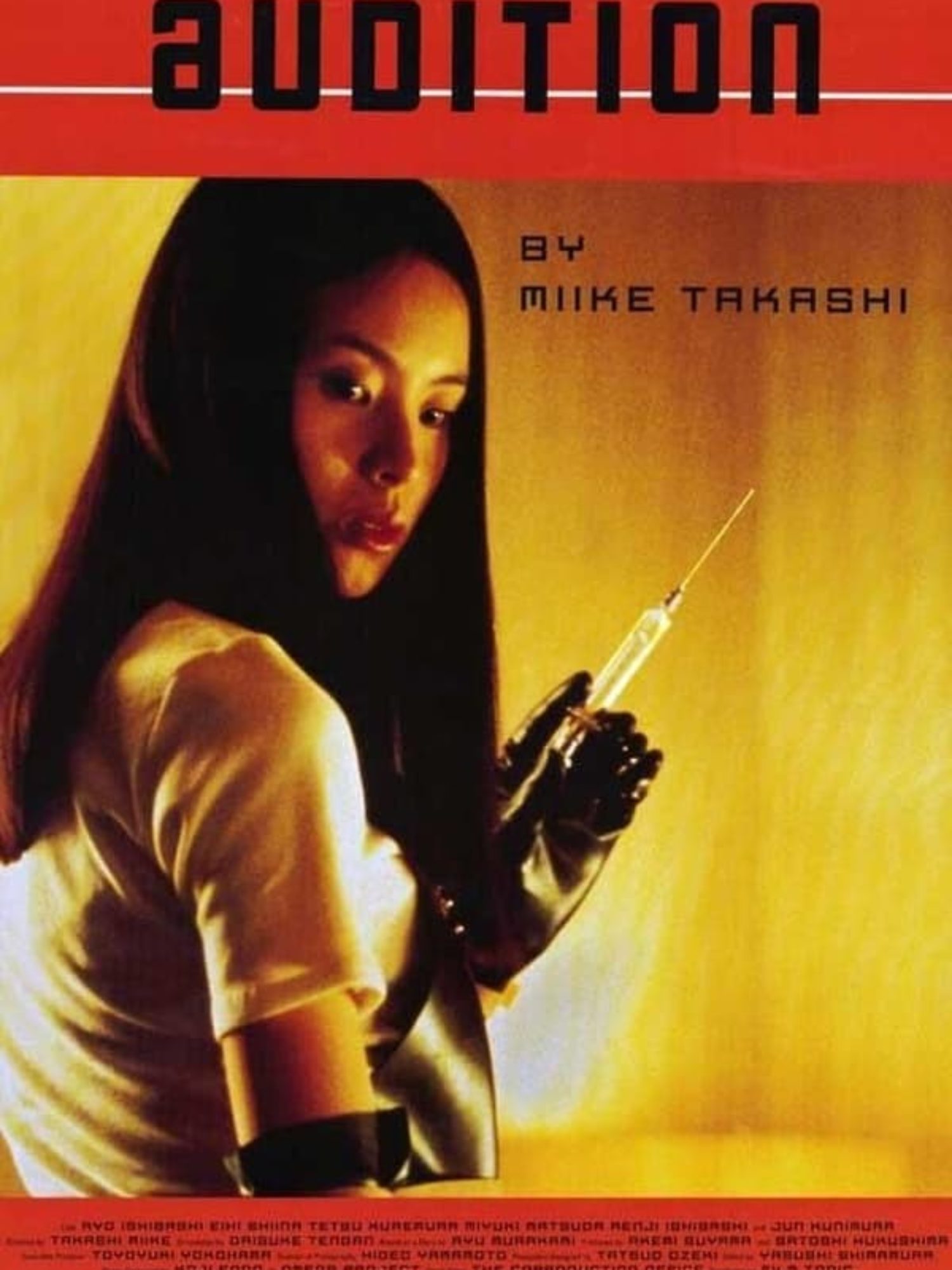
Ping : Les nominations aux Oscars 2023 - Les Réfracteurs