
(Living)
2022
Réalisé par : Oliver Hermanus
Avec : Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp
Film vu par nos propres moyens
En 1952, le réalisateur de génie Akira Kurosawa offrait au monde du cinéma un de ses plus grands films, aujourd’hui considéré comme un chef-d’œuvre du septième art japonais, le somptueux Ikiru. Très librement inspiré du roman La Mort d’Ivan Ilitch de Léon Tolstoï, le long métrage transcendait l’exercice de la simple adaptation d’une littérature russe que le metteur en scène admirait, pour s’en approprier les thèmes profonds et les transposer avec habilité à un Japon en pleine reconstruction. La précarité de toute un pays en toile de fond, l’immobilisme des institutions en fil rouge et un fonctionnaire malade conscient d’une mort prochaine en guise de héros, Ikiru capturait l’essence et les contradictions d’une époque charnière de l’Histoire nippone, pour inviter à un questionnement sur le futur, servi par la mise en image d’un maître de la caméra au sommet de son art. Davantage qu’un simple film, Ikiru est un monument qui s’appréhende avec humilité, respect et émotion.
Amoureux sincère du long métrage d’Akira Kurosawa, le scénariste Kazuo Ishiguro, japonais de naissance mais régulièrement dans les coulisses du cinéma anglais, envisage depuis longtemps de s’approprier l’œuvre originelle pour la propulser dans le Londres de l’après Seconde Guerre mondiale. Depuis maintenant dix ans, il rêve de porter ce remake à l’écran, un souhait désormais exaucé grâce à Vivre, sorti en 2022, et dont la réalisation est confiée au relatif inconnu Oliver Hermanus. Une rencontre fortuite accélère la concrétisation du projet, car Vivre tout comme Ikiru repose en grande partie sur les talents d’interprète de leurs acteurs principaux respectifs. Dans le secret d’un taxi partagé par le plus grand des hasards, Kazuo Ishiguro et le comédien Bill Nighy font connaissance, et leur amitié naissante conduira à faire de l’anglais le protagoniste du futur film. Malgré la bonne volonté de son équipe, Vivre se heurte à un problème majeur dans l’appréciation du long métrage. Ce remake est invariablement jugé à l’aune d’Ikiru, un sommet de la carrière prolifique de son réalisateur, une œuvre précieuse et subtile chère au cœur de millions de spectateurs. Malheureusement Oliver Hermanus n’a assurément pas le talent d’Akira Kurosawa, Bill Nighy n’a pas un soupçon de la maestria de Takashi Shimura et la simple volonté de transformer scénaristiquement un film contemporain à sa sortie en fresque historique apparaît parfaitement contradictoire avec le message social profond de l’oeuvre originelle.
Homme froid et impassible, Mr. Williams (Bill Nighy) est un employé de la mairie de Londres, désintéressé de sa tâche. Après une vie vécue discrètement derrière son bureau, il comprend enfin la fragilité de son existence lorsqu’un incurable cancer lui est diagnostiqué. La fatalité de la mort le force à remettre en cause ses certitudes. Dans une course contre la montre, il s’abandonne à une vie d’excès et de bonheur illusoire, avant de prendre conscience qu’il est encore temps de laisser un héritage pour les générations futures. Se liant d’amitié avec son jeune collègue idéaliste Peter (Alex Sharp) mais surtout avec une ancienne collaboratrice qui a quitté son poste, Margaret (Aimee Lou Wood), il tente de vivre ses derniers instants pleinement, en se sacrifiant notamment pour la construction d’un parc dans un quartier désoeuvré de la capitale anglaise.

Transposer le récit du Japon en ruines des années 1950 à l’Angleterre de l’après-guerre aurait dû permettre à Vivre de retrouver la détresse sociale propre à Ikiru, pourtant ce nouveau film semble constamment se réfugier derrière la façade mielleuse d’une vision idéalisée de la société de l’époque. La détresse des habitants précaires disparaît complètement du film au profit d’une reconstitution factice et étrangement scintillante d’une Grande-Bretagne de carte postale. Oliver Hermanus refuse la parole aux plus démunis, sans doute par crainte de voir son film effroyablement doucereux se transformer en photographie plus contrastée d’un pays divisé. Les mères de famille qui réclament la construction d’un parc étaient un élément essentiel de la narration d’Ikiru, leur incarnation est ici réduite à sa plus simple expression, trois simples femmes d’ailleurs incompréhensiblement fastueusement vêtues, qui n’interviennent que timidement dans le récit. Les disparités sont effacées sous la gomme magique de Kazuo Ishiguro, vraisemblablement aussi amoureux de l’oeuvre d’Akira Kurosawa qu’incapable de la comprendre. La mairie de Londres symbolise à elle seule l’absurdité de vouloir transformer une saillie sociétale en épopée ronflante. À l’empire dysfonctionnel de papier de Tokyo succède désormais la vision étrangement rutilante d’impeccables bureaux, et au comble de la bêtise scénaristique, certains organes du pouvoir semblent même parfaitement soucieux de leurs tâches. Mr. Williams n’est plus le Don Quichotte d’Ikiru qui a triomphé de l’administration, il est un fonctionnaire parfois profondément reconnaissant de ses pairs, jusqu’à la révérence explicite. Vivre a annihilé toute forme d’héroïsme au nom d’un amour enfantin constant pour l’être humain. Il ne subsiste que timidement le message galvanisant que l’individu doit être au service du collectif pour s’épanouir, qui évolue de concert avec la vision d’employés de mairie inconscients de la portée de leur mission et qui renient leur devoir. Néanmoins, même cet axe du récit est essoré par l’écriture candide de Kazuo Ishiguro, puisque la résignation sur le futur de Ikiru qui constituait une véritable mise en garde, est remplacée par l’espoir naïf d’un avenir radieux, incarné par Peter, pure invention du scénariste.
Le monde dépeint dans le long métrage d’Akira Kurosawa était gangréné par la maladie, et le génial Takashi Shimura, dans une performance d’acteur sublime, était une incarnation concrète de cette affliction. Le cancer qui le rongeait n’était pas que physique, il était aussi idéologique. Malheureusement, atteindre le degré de subtilité du comédien japonais dans l’évocation de la détresse est hors de portée d’un Bill Nighy relativement consternant dans Vivre, et pourtant incompréhensiblement nommé aux Oscars. L’acteur est tout simplement incapable de sortir du repli sur soi pour laisser transparaitre une fragilité derrière laquelle se devine le malheur et même totalement inapte à faire comprendre aux spectateurs qu’il agonise, condamnant dès lors Oliver Hermanus a avoir recours à des artifices de mise en scène grotesques pour rappeler l’affliction. Bill Nighy ne fait que singer Takashi Shimura, se faisant ainsi davantage imitateur consternant qu’interprète. À l’écran, une vie s’éteint, et pourtant brille d’une ultime lueur avant les ténèbres, mais une réalisation grossière symbolise cette image à travers un éclairage calamiteux. Constamment sur-accentuée, la lumière de Vivre aveugle et irrite le spectateur qui en viendrait presque à regretter de ne pas avoir enfiler des lunettes de soleil, avant que l’enterrement de Mr. Williams ne plonge dans une obscurité insondable tout aussi exacerbée.

Le scintillement de l’image agace, mais se révèle relativement à propos dans la première partie du film, lorsque le protagoniste s’abandonne à la frénésie de la vie nocturne et à ses mirages électriques. Akira Kurosawa faisait incontestablement mieux sans avoir le luxe de la couleur, mais après une vingtaine de minutes de film, le deuil du talent de Oliver Hermanus est de toute façon déjà acté, ironiquement davantage que celui prophétisé de son héros. Au bord de la mort, l’illusoire devient le premier refuge, les âmes en peines s’abandonnent aux sirènes des bars bondés et à leurs oiseaux de nuits solitaires. Le corps se meurt et dans un dernier élan, l’esprit veut s’exprimer, guidé par un artiste qui connaît parfaitement la vie d’excès. Vivre succombe alors à nouveau au mal le plus profond qui l’afflige, l’enjolivement de tout et de tous. Takashi Shimura laissait entendre sa voix timide, tremblotante, incertaine et précaire dans Ikiru, en entonnant une chanson de son passé révolu, ici au summum de l’absurdité, Bill Nighy chante comme un soprano parfaitement bien portant et épanoui, à tel point qu’on se demande ce que l’équipe créative de ce nouveau long métrage à bien pu retenir de l’oeuvre originale. Peut être Mr. Williams veut il seulement aimer et être aimer, non pas charnellement mais pour ce qu’il est au plus profond de lui, pour tout ce qu’il a intériorisé au cours d’une vie de désillusions, et son chant harmonieux est l’expression ridiculement facile de sa beauté caché, avant qu’elle ne se dévoile dans son amitié avec Margaret. Vivre remplace le chagrin par la douceur sans une once de mélancolie, mais dès lors il perd grandement en profondeur et en pertinence. Pourtant après le chant du cygne du protagoniste, la vie continuera, les trajets quotidiens en train de ses administrés ne cesseront pas, la modernité aura oublié ses ancêtres et renié son héritage.
Puisque le temps est compté et que l’existence est fragile, chaque action devient hautement significative. La vertu du sacrifice de soi, directement héritée d’Ikiru, devient un idéal qui sort Mr. Williams de sa torpeur pour le rappeler à une bonté de cœur jusqu’alors enfouie. Il reste peu de temps, mais il n’est pas trop tard pour laisser un héritage concret derrière soi et quelques jours suffisent à justifier l’importance de toute une vie. Les mirages de la nuit sont immatériels et Margaret l’aide à s’en extirper, son leg est lui concret et prend l’apparence d’un tout petit parc, au centre d’un quartier pauvre de la capitale. Le protagoniste n’a que peu de moyens mais il a la volonté de l’homme de bien, prêt à tout pour offrir un maigre réconfort à ses semblables. Inspirer ses collègues est compliqué, et au terme du film sera même impossible une fois Mr. Williams disparu, dès lors les bonnes actions se destinent aux plus démunis, aux enfants et aux femmes, à ceux dont la voix n’est pas entendue, et qu’ironiquement Vivre ne laisse pas vraiment entendre contrairement au premier long métrage. Même une fois décédé, le héros habite son leg, à travers la reconnaissance des résidents, ou lors d’un flashback qui reprend presque à l’identique le plan le plus célèbre d’Ikiru, lorsque le fonctionnaire s’assied sur la balançoire du parc. Mr. Williams a vaincu la mort en se détournant du confort et en luttant contre sa maladie dans un dernier élan de vie. En s’extirpant de sa condition, il a resplendi une dernière fois, peut-être la première en réalité. Ce spectre d’idées issues du travail d’Akira Kurosawa était totalement suffisant pour témoigner de la splendeur du geste du protagoniste et pour rendre grâce à son altruisme, mais Kazuo Ishiguro ne semble accorder aucune confiance à la capacité de réflexion de son public. Selon l’effroyable logique du film, tout doit être prémâché et prêt à la digestion sans une once de subtilité. Mr. Williams n’est pas vraiment mort puisqu’il vit encore dans l’âme de plusieurs personnages, mais le scénariste juge opportun de marteler ce message par l’intermédiaire d’une lettre venue d’outre-tombe, destinée à Peter, et qui ne sert qu’à expliquer lourdement ce que toute personne apte à un minimum de concentration sait déjà. Vivre ne se cache même pas de prendre partiellement les spectateurs pour des idiots, quitte à dénaturer l’essence d’Ikiru, faisant de l’hommage une injure.

Dès lors, finie l’identification forte au protagoniste qui était au coeur du film original, Vivre ne réclame pas de devenir Mr. Williams dans son déroulé, mais fait de Peter un être effroyablement lisse uniquement là pour servir de porte d’entrée dans le quotidien austère du héros et pour verbaliser à outrance tout ce que l’image ne parvient pas à communiquer. Comme un mal moderne, cette nouvelle adaptation cède à certains codes du cinéma grand public de notre époque pour faciliter la digestion davantage que l’intellectualisation d’un récit. Le comparatif entre les deux films impose un jugement sévère, Peter ne sert à rien, si ce n’est à apporter une note d’espoir naïf, hors de propos et inutile qui interdit de se questionner. Vivre n’invite pas, il impose. Oliver Hermanus est un boulet de démolition qui désintègre l’essence même d’Ikiru et métamorphose une œuvre fascinante d’ambiguïté en simple film débordant de bons sentiments étouffants et toujours d’un positivisme exécrable. Margaret partage ainsi un ensemble d’élément commun avec son alter-égo japonaise, que jouait Miki Odagiri, et est naturellement proche de Mr. Williams puisqu’elle est elle aussi un personnage éprouvé par les chaos de la vie. Le vieil homme et la jeune femme sont deux parias, l’un parce qu’il est condamné, l’autre parce qu’elle a cru à une ascension sociale factice. Une détresse les réunit dans le tourbillon de la vie, et faire dès lors de Margaret le seul personnage au courant de la maladie de Mr. Williams prend une signification particulière. À nouveau les affres moraux et physiques communiquent d’une même peine. Néanmoins, contrairement à Ikiru, Vivre démontre une fois encore que le message de Akira Kurosawa a été profondément perverti. Livrée à elle-même dans le long métrage des années 1950, la jeune fille a le droit à une résolution heureuse dans cette nouvelle adaptation, à travers une histoire d’amour avec Peter que Oliver Hermanus hurle à l’écran dès les toutes premières secondes. Vivre ne vous veut que du bien, les dilemmes profonds disparaissent dans la mièvrerie.
Même en considérant qu’un remake d’Ikiru a sa place dans le paysage actuel, pour peu qu’on s’en donne les moyens devant et derrière la caméra, l’ancrage historique de Vivre perturbe son message implicite. En 1952, Akira Kurosawa avertissait les citoyens de son pays sur l’état de la société contemporaine et mettait ouvertement en question les préjugés sur les relations entre hommes et femmes qu’une morale rétrograde condamnait. Cette nouvelle adaptation prenant place dans un passé lointain, elle s’estime à la lumière de l’Histoire. Le spectateur est conscient du futur de l’Angleterre et dès lors la mission intrinsèque du matériel originel s’évapore dans une grammaire aussi duveteuse qu’éculée. Vivre, décidément pas à un contresens prêt, ne peut même pas se vanter d’être une chronique exacte d’une époque, tant sa reconstitution affreuse empêche le voyage temporel, mais aussi tant le repli vers une bienveillance exaspérante perturbe jusqu’aux axes de lecture les plus clairs d’Ikiru. Dans le premier film, le désamour du fils du protagoniste accentue un regard critique sur les relations familiales et sur les rapports de forces. Une nouvelle génération tuait allégoriquement ses aïeux, inconscient de leur sacrifice. Kazuo Ishiguro refuse cette fronde à tel point que son long métrage devient totalement incohérent. Plus rien ne justifie le secret de la maladie de Mr. Williams et le refus d’en informer son enfant n’est pas pertinent, puisque de toute façon, selon l’écriture idiote du scénariste, personne n’est, ne serait ce qu’un peu, mauvais et certainement pas les enfants. Le père fragile apparaît presque cruel en privant son fils de ses derniers instants. L’édification du parc perd ainsi tout son sens. Les enfants désoeuvrés ne sont plus spirituellement ceux de Mr. Williams, puisque rien n’explique pourquoi il devrait transposer son amour ailleurs que dans sa famille. Vivre place une confiance exacerbée envers la nouvelle génération, et pourtant c’est l’amertume qui prime, celle de savoir que certains enfants d’aujourd’hui découvriront un récit bouleversant sous un jour médiocre, alors qu’Ikiru mérite toutes ses louanges.

Vivre n’a rien d’un hommage ou d’une transposition habile, c’est une trahison. Toute l’essence d’un récit perd sa consistance derrière une technique calamiteuse, des acteurs absolument désastreux et des modifications scénaristiques incohérentes.

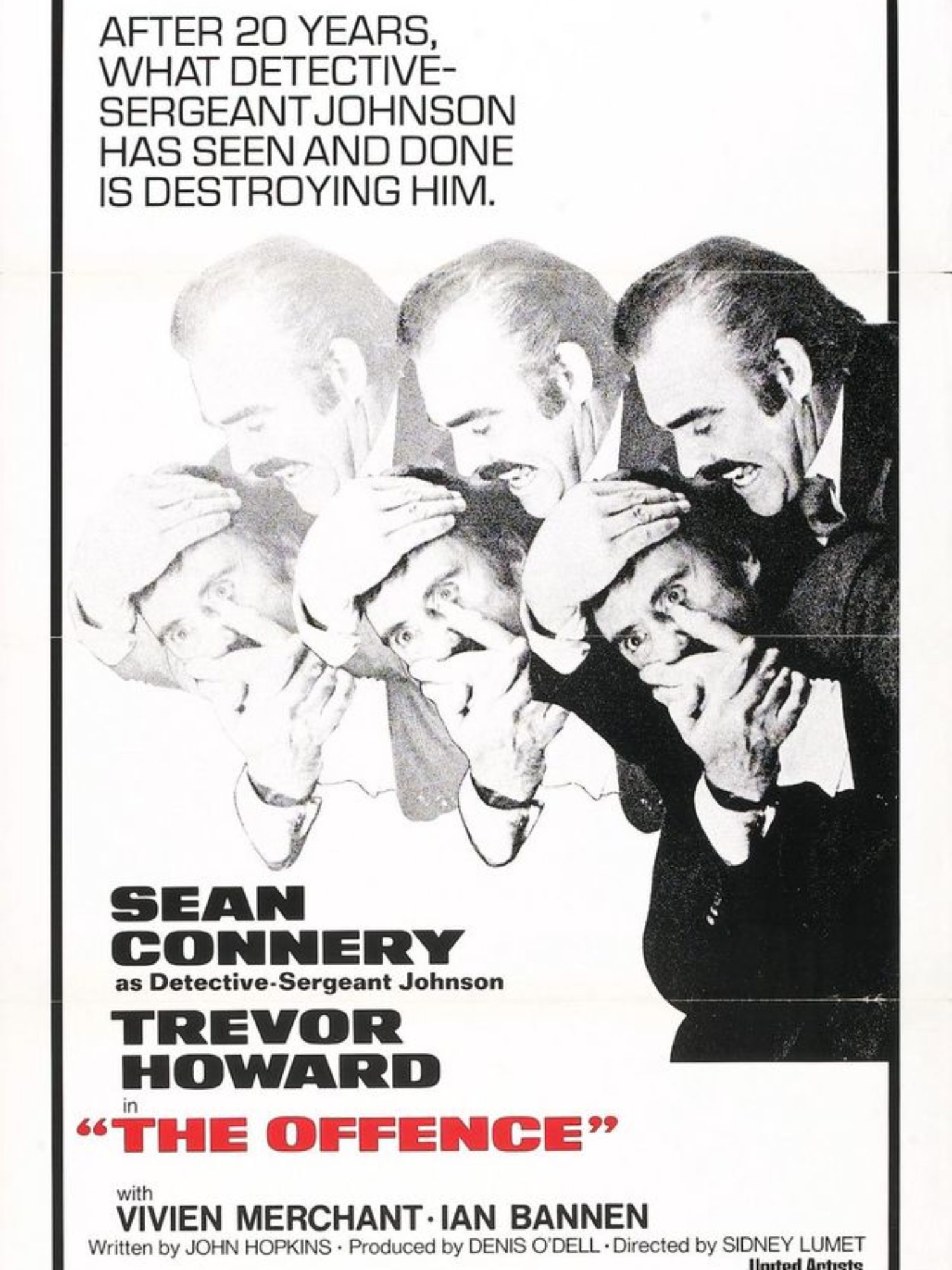

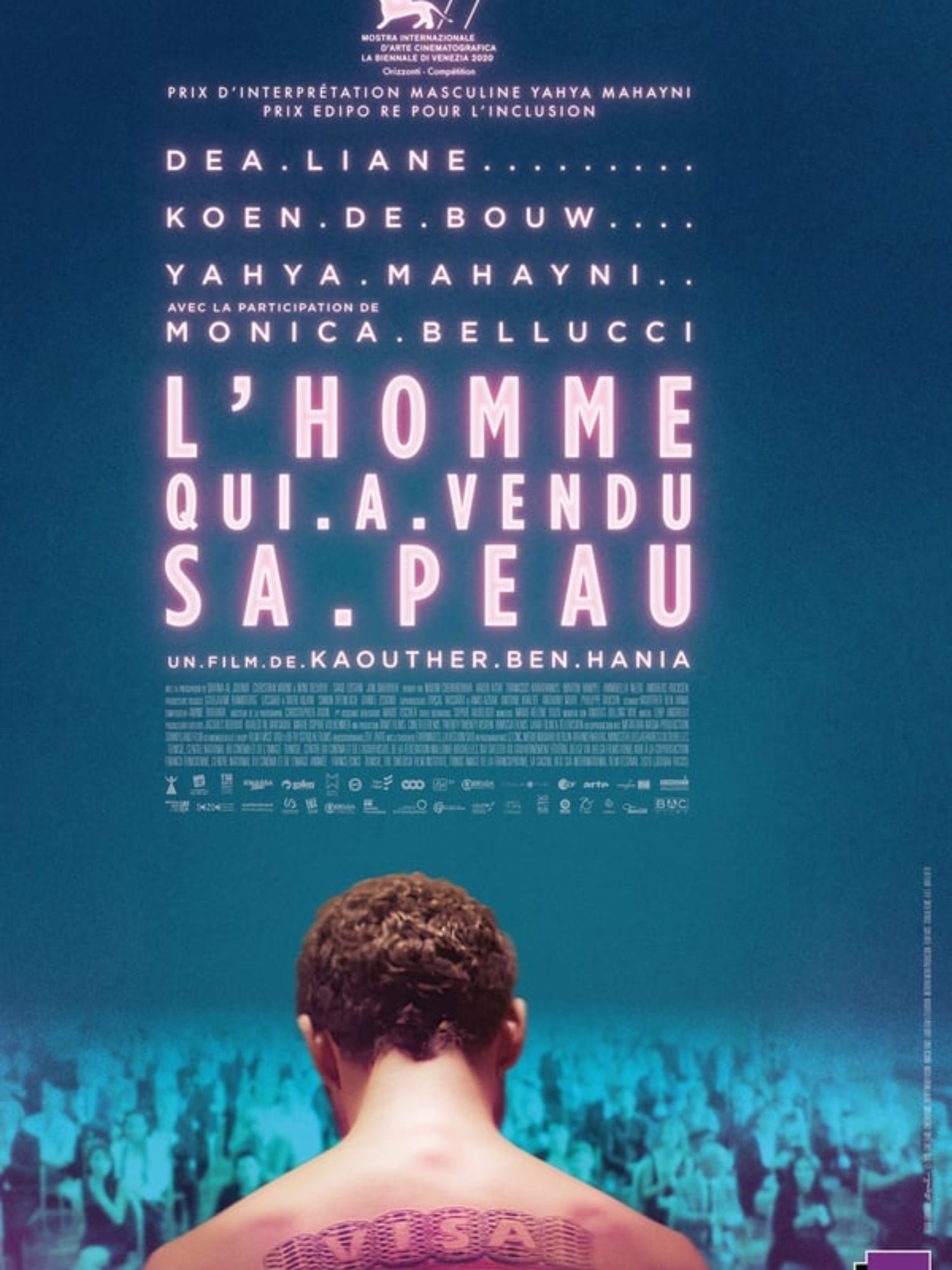


Ping : Les nominations aux Oscars 2023 - Les Réfracteurs