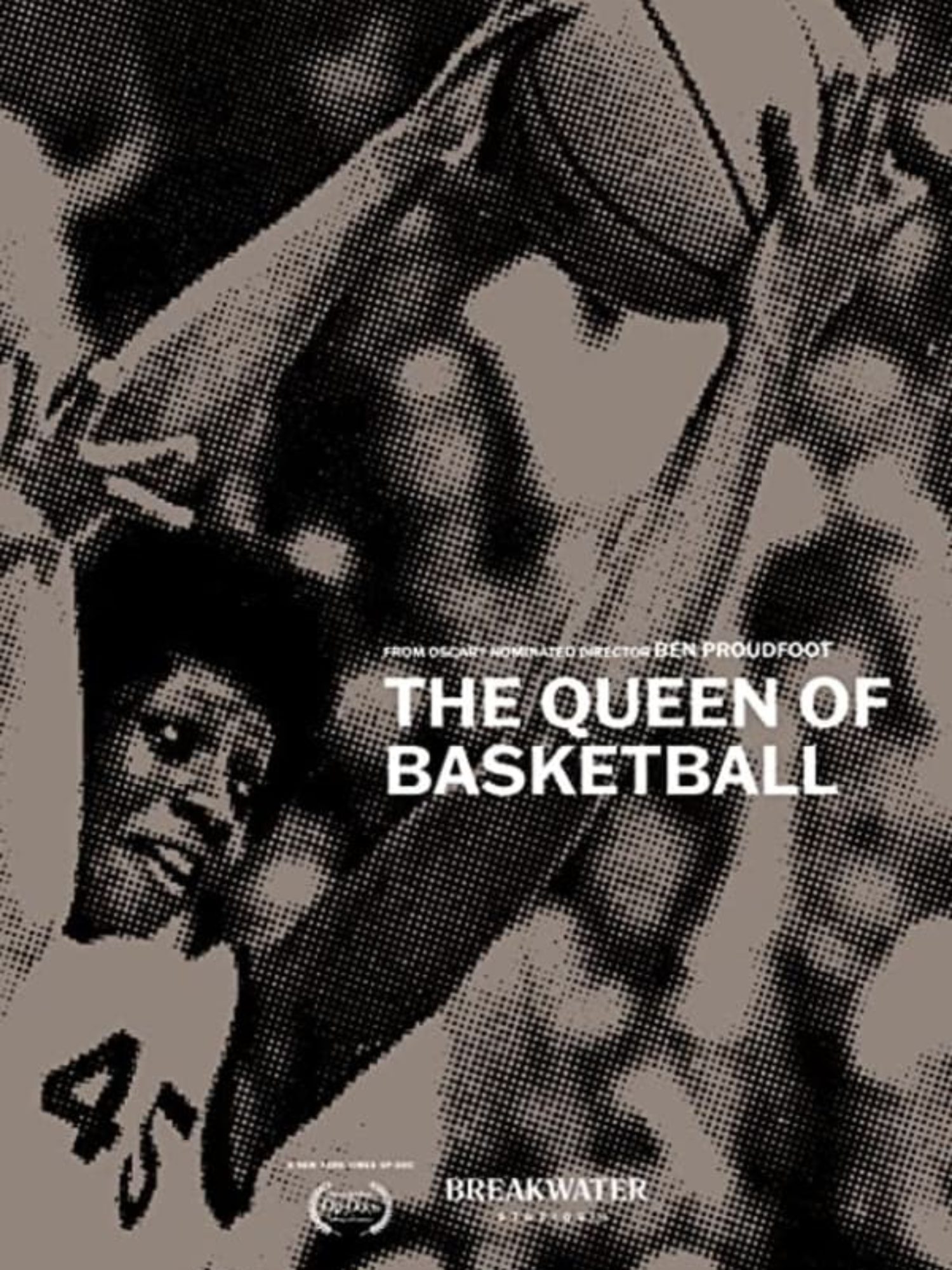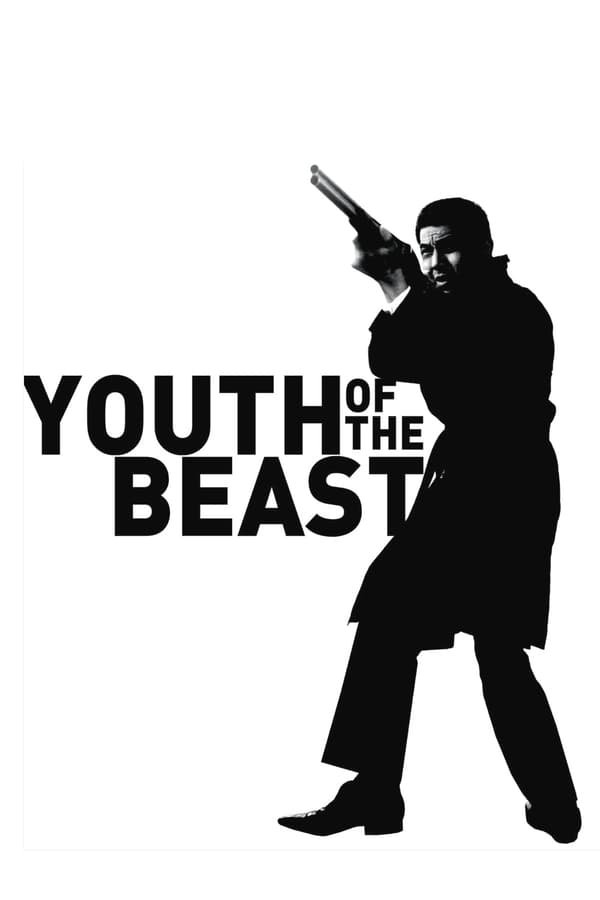
(野獣の青春)
1963
Réalisé par: Seijun Suzuki
Avec: Jō Shishido, Misako Watanabe, Tamio Kawachi
Film vu par nos propres moyens
Au début des années 1960, une révolution technique frappe le cinéma japonais. Progressivement, les écrans nippons se parent de milles couleurs, alors que le septième art abandonne petit à petit le noir et blanc. Une identité visuelle se forge du fait de la différence de pellicule utilisée entre orient et occident. Le rendu graphique diffère radicalement, imposant un dépaysement certain, identifiable au premier coup d’œil. Au cours de cette même période, un cinéaste tout particulier explose dans l’archipel et devient un des portes étendard de cette nouvelle dimension sensorielle: alors que le maître Akira Kurosawa continue d’imposer ses chefs-d’œuvre en monochrome, l’enfant terrible du polar Seijun Suzuki épouse la palette désormais disponible. Certes, Yasujirō Ozu est le plus fier représentant de cette avancée, et en 1963, son Bonjour pastel a déjà 4 ans, mais la fougue de Seijun Suzuki, notamment dans ses élans de violence, marque à jamais le public de son pays. Le réalisateur est d’ailleurs pleinement conscient de la période clé dans laquelle il se trouve: son œuvre La jeunesse de la bête s’ouvre sur une courte séquence macabre en noir et blanc, qu’un élément clé en rouge carmin vient griffer, avant que le reste du film n’adopte pleinement la couleur. Un geste de réalisation que Seijun Suzuki reproduira quelques années plus tard avec Le Vagabond de Tokyo. L’auteur met à mort le cinéma d’avant, place à sa poésie sanglante.

Seijun Suzuki ne rompt cependant pas entièrement avec le passé, et pour la deuxième fois en moins d’un an, il adapte une nouvelle de Haruhiko Oyabu. Après Detective bureau 2-3 : Crevez vermines, La jeunesse de la bête s’ancre lui aussi dans le monde de la criminalité secrète japonaise. Alors que les corps sans vie d’un inspecteur de police et d’une prostitué sont découverts, dans ce qui semble être un double suicide, les gangsters nippons sont en plein tourment. La guerre d’influence entre deux bandes rivales secoue la ville où se déroule l’intrigue, et l’apparition d’un étrange personnage, le violent Jo (Jō Shishido) jette de l’huile sur le feu. Jouant sur les deux tableaux pour semer le trouble, ce voyou déterminé monte chacun des camps les uns contre les autres.
Pour principale mission, La jeunesse de la bête entend plonger le spectateur dans le monde parallèle de la criminalité, une société secrète que le grand public ignore et qui se dérobe à son regard. Le long métrage ne communique que très peu avec les quidams qui peuplent le Japon et reste presque entièrement inscrit dans cet univers tabou de malfrats. La police fait bien acte de présence, mais ses apparitions ne font que souligner la farce de leur impuissance. Pour faire voler en éclat les organisations néfastes, Jo doit s’immerger totalement dans leur tanière. Seul l’un des leurs peut les vaincre. Caméra en main, Seijun Suzuki alimente l’idée qu’un microcosme invisible se cache au-delà des décors. Régulièrement, les repères des gangsters se trouvent derrière des vitres sans teint de différents commerces, ou plus criant de vérité encore, derrière l’écran d’une salle de cinéma. La sinistre épopée se déroule au-delà du mur des images, si proche et pourtant si loin du spectateur. Lorsque Jo, malmené, se retrouve le visage écrasé contre le cadre, on jurerait que cet empire du vice est prêt à nous jaillir dessus.

Criminalité rime également avec organisation chaotique pour La jeunesse de la bête. Le film multiplie les personnages, alors qu’il n’en personnifie pleinement qu’une poignée restreinte. Les têtes tournent devant ce dédale de protagonistes, au point de rendre le long métrage parfois difficile à digérer. Rapidement, le spectateur fait le deuil d’une compréhension pleine au premier visionnage, et se rabat sur ce qui forme le trait d’union entre tous ces êtres patibulaires: la grammaire violente de Seijun Suzuki, faite de trahisons multiples. Dans des explosions d’agressivité, les antagonistes du film font toujours usage des poings avant de discuter. Pourtant, le sang n’est que peu présent à l’écran, il reste le plus souvent suggéré, et lorsqu’il surgit enfin, c’est des mains de Jo qu’il coule, le point d’attache du récit.
Si la violence est la constante de La jeunesse de la bête, alors l’armement dont se pare les personnages devient une extension naturelle de leur psyché, un élément presque organique. Jo est d’un caractère explosif, Seijun Suzuki l’agrémente donc de gros calibres menaçants. L’un des chefs de bande est lui fourbe et insidieux, le scénario souligne dès lors son désamours des pistolets pour le munir de dagues. L’instrument qui donne la mort est une composante essentielle de la construction de chaque protagoniste, bien au-delà du simple accessoire. Ainsi, lorsque Jo offre un fusil à un jeune fou de la gâchette, le long métrage tisse un lien spécial entre eux, pour mieux jouer de cette nouvelle connivence dans son acte final.

L’alpha et l’oméga de La jeunesse de la bête reste pourtant perpétuellement Jo, dont Seijun Suzuki ne s’écarte que rarement. Les autres intervenants sont presque interchangeables, mais lui demeure inflexible, une tempête froide, déterminée et macabre, lancée à vive allure contre des obstacles qu’il pulvérise. Son inflexibilité sera mise à mal, de plus en plus vivement, mais il reste la seule constante de l’œuvre. Il apparaît même comme l’unique pourvoyeur d’un soupçon de vertu, dans un monde où la trahison est monnaie courante. Si le titre l’assimile à un animal, le film ne renie pas ses qualités de cœur et une forme de droiture morale volontairement anachronique dans le déroulé. C’est davantage parce qu’il reste sûr de son but qu’il est bestial, parce qu’il est prêt à se jeter sur sa proie et à la mordre à pleins crocs, une fois qu’il l’a débusquée. Dans l’enfer des hommes, Jo est le prédateur que tous redoute.
L’écriture de La jeunesse de la bête joue d’ailleurs d’une opposition nette entre les personnages masculins et féminins. Alors que les malfrats semblent répondre aux mêmes codes, les dames du récit marquent une forme d’évolution singulière au fil de l’œuvre. Initialement, Seijun Suzuki accentue une certaine fragilité qui leur est propre: la première qu’on aperçoit n’est qu’un cadavre, la deuxième une junkie en plein manque. Ce n’est qu’ensuite que le cinéaste les assimile à des vecteurs de compassion, presque porteuses d’élans maternels. Pourtant, Seijun Suzuki pose un regard sans concession sur l’humanité dans son entièreté. Il n’existe rien d’incorruptible dans sa logique, si ce n’est Jo. En plus de la prostitution au centre de l’intrigue, le héroïnes du film finissent par elles aussi incarner une forme de pouvoir pernicieux, et de convoitise du bien d’autrui qui n’est pas réservée au hommes. Tout est friable dans La jeunesse de la bête et le vice s’immisce dans les plus petites fêlures de l’âme.

Seijun Suzuki impose sa poésie macabre et son regard nihiliste sur l’homme dans La jeunesse de la bête, tout en y ajoutant sa fougue visuelle inimitable.
La jeunesse de la bête est disponible en Blu-ray chez Elephant Films.