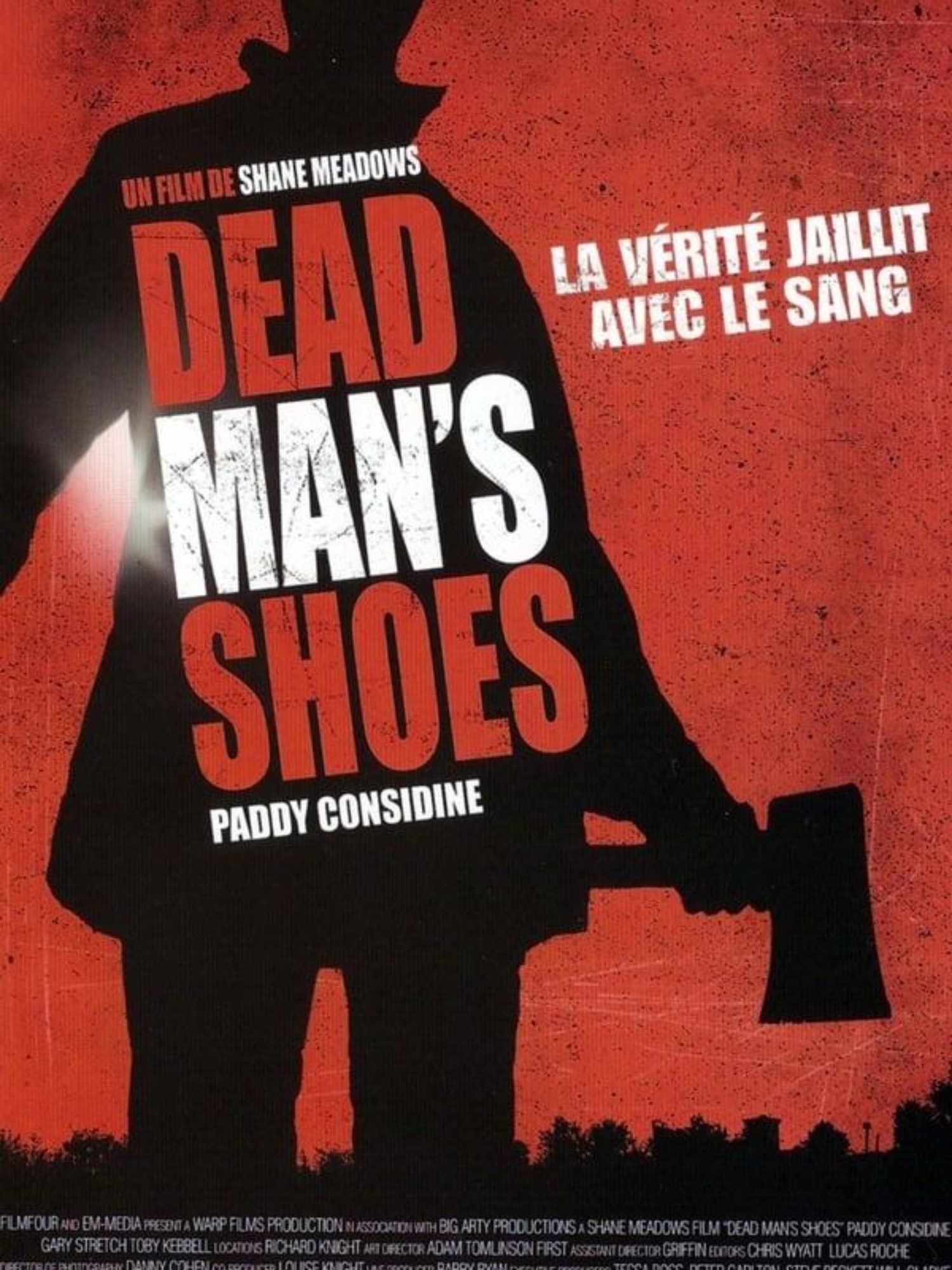2020
de: Gavin O’Connor
avec: Ben Affleck, Al Madrigal, Janina Gavankar
En journalisme, on appelle ça un “marronnier”: cette tendance à recycler chaque année le même sujet d’actualité pour meubler l’antenne. Ce concept, on peut facilement l’étendre au cinéma: le Disney de Noël par exemple, ou encore les blockbusters de l’été. Parmi cette famille des films récurrents, il y a une tradition séculaire aux USA: le film sportif. Tous les ans on a le droit à notre petite dose de sueur devant des long-métrages mettant en scène les sports typiques de la terre des libres et de la maison des braves. Récurrents certes, mais pas nécessairement ratés, quelques films ayant même traversé les frontières à la faveur d’un casting alléchant (pensons à “L’enfer du dimanche” par exemple). Mais par honnêteté on est quand même obligé de signaler que la plupart du temps, c’est du cinéma micro-ondable: vite réchauffé et jamais bien cuit. Alors quand en plus l’oncle Sam s’attaque au basket, le sport de prédilection des Réfracteurs, on devient tatillons.
Dès l’entame, on comprend où on a mis les pieds: Ben Affleck est un homme à la dérive qui descend les packs de bières comme du petit lait, et qui se lamente sur son mariage raté. Jusqu’au moment où il reçoit un coup de fil de son ancien lycée qui lui propose de coacher son équipe de bras cassés du basket. Un postulat de départ qu’on retrouve environ une année sur deux, en alternant les sports, c’est déjà moyen.
Cette formule recyclée, on ne la jette pas totalement aux ordures, elle garde sa part d’efficacité. On se fait même facilement avoir quand on partage certaines accointances avec le sport exposé. Toutefois, le concept montre en général rapidement ses limites. On a beau adorer le basket, quand un film accumule autant de clichés en si peu de temps, même notre amour de la balle orange ne peut le sauver de la perdition.
Et attention, c’est parti pour le listing (même pas exhaustif) de tous ces personnages, vus et revus. D’abord ce coach, alcoolique en puissance qui trouve la rédemption grâce à son nouveau poste, mais surtout les membres de l’équipe essorés jusqu’à la moelle par le 7ème art : le timide, le rebelle, le beau gosse, le guignol… Vous pouvez cocher toutes les cases du genre. Quand en plus on donne l’impression que le film affirme que le destin se joue sur un parquet de basket, on s’indigne un peu. Pour faire de bons adultes, il faut davantage de pédagogie. Le sport collectif porte des valeurs intéressantes pour nos enfants, mais loin d’être suffisante à une éducation.

« Ok les nullos, ce qu’il nous faut c’est un bon vieux montage »
Niveau réalisation, ce n’est pas vraiment mieux. Déjà parce qu’il n’y a pas grand chose de neuf proposé. On a même le droit au montage bien lourdingue qui transforme une équipe de loosers en puissance en Dream Team, le tout en 3 minutes auxquelles on ajoute quelques discours de motivation qui sonnent effroyablement creux. Mais en plus, on a jamais eu le sentiment que le basket était correctement mis en scène. Un bon film sportif doit affirmer son identité: ici c’est du vite fait, mal fait. Peu de tension dramatique pour notre sport favori, c’est impardonnable. Dernier point sur la réal qui semble imperceptible pour la plupart mais impossible à ignorer une fois mis en évidence: régulièrement, et sans raisons apparentes, on a l’impression que l’image tremble, comme si Gavin O’Connor, le réalisateur, n’arrivait pas à maintenir sa caméra parfaitement droite. Perturbant.
Heureusement, “The Way Back” va éviter quelques embûches, mais pas toujours de manière subtile. Par exemple, quand on a découvert que le lycée que Ben Affleck coach était un établissement catholique, on a immédiatement redouté un sous-texte religieux: de ce côté, on peut saluer le fait que Gavin O’Connor ne soit pas tombé dans le piège comme tant d’autres avant lui. Le cinéaste va aussi éviter un happy-end total, mais d’une manière complètement absurde. Essayons toutefois de ne pas trahir le film en évoquant simplement qu’il faut attendre le dernier tiers du film pour que le personnage de Ben Affleck gagne en profondeur, alors qu’il est déjà trop tard. Seulement le souci, c’est que le scénario le fait avec une forme de misérabilisme facile, sorti de nulle part, et qui confine à la prise d’otage émotionnelle. Mais surtout, cette ultime partie s’écarte totalement de son sujet de base, à tel point qu’elle ne s’assemble pas du tout avec le basketball. Quitter un peu les parquets, dans l’absolu pourquoi pas, mais le faire d’une manière aussi tranchée laisse un goût amer en bouche.
En outre, on va se permettre de vous confier notre expérience personnelle d’adeptes du basket: être fan de sports américains, et à plus forte raison de NBA où les matchs sont quotidiens, demande une part de sacrifice social. Ce sont des nuits blanches entières et régulières, jusqu’à épuisement total que s’imposent les fans comme nous, au détriment de leur santé ou de leur vie de couple. Demandez donc à Oracle si elle apprécie le visage cerné de votre rédacteur du jour: non, elle l’accepte simplement par amour et parce qu’elle sait que le basket est comme une religion pour moi. Cela demande tout de même des compromis au quotidien. Enfin, le sport possède sa propre grammaire, et son lot de légendes qui se suffisent à elles-mêmes. On évoque ici l’un des seuls sports où une équipe peut gagner après le buzzer final: niveau tension dramatique, on fait rarement mieux que le Buzzer Beater de Damian Lillard contre Oklahoma City en 2019. Pour rendre hommage à notre sport de prédilection, il faut montrer davantage de talent d’écriture et de réalisation que ce que propose timidement “The Way Back”.

“The Way Back” est comme un match des Harlem Globetrotters: factice, écrit d’avance, et tous les ans pareil. Et pourtant, chaque année on tombe dans le panneau, fanatiques écervelés que nous sommes.