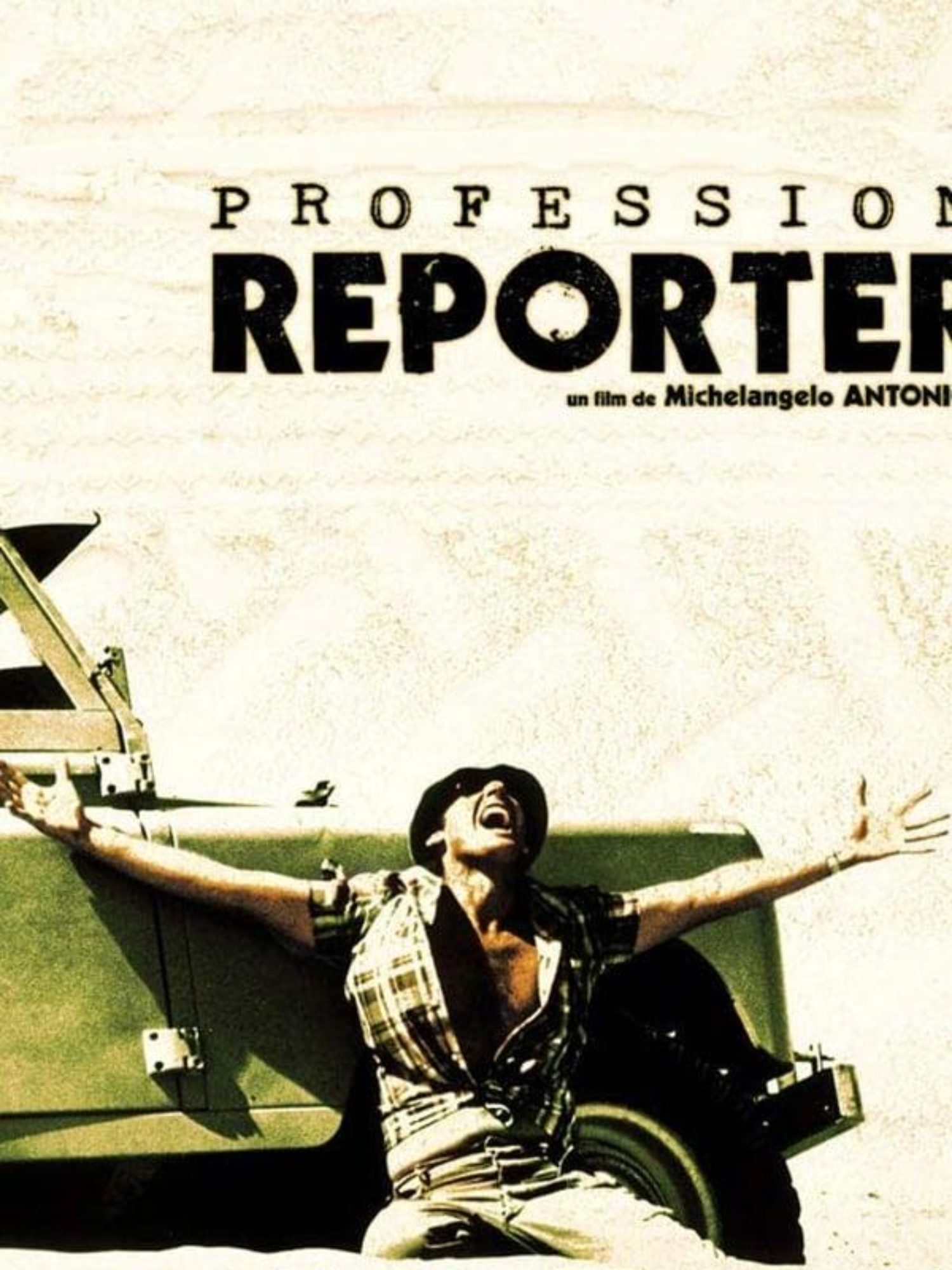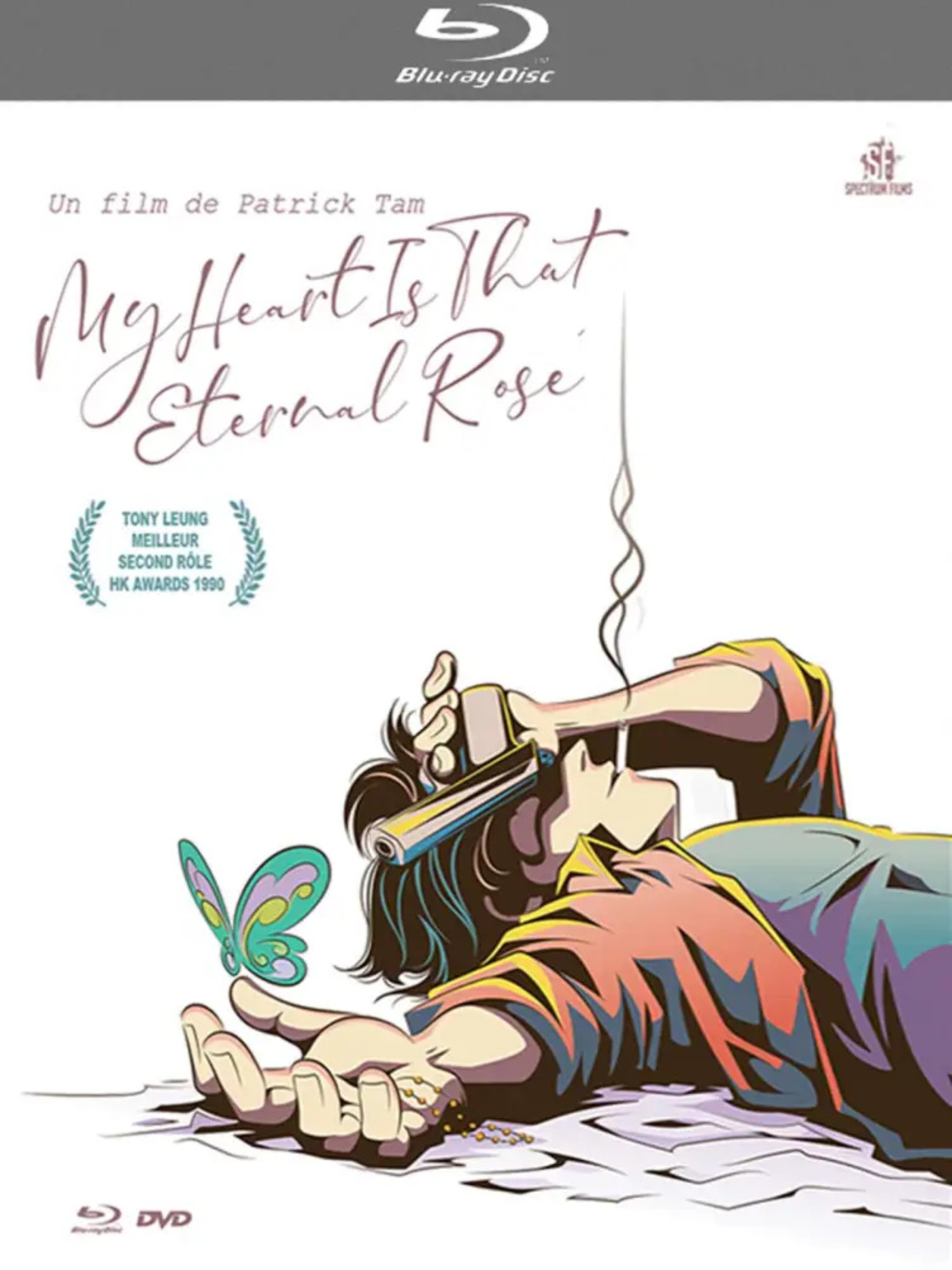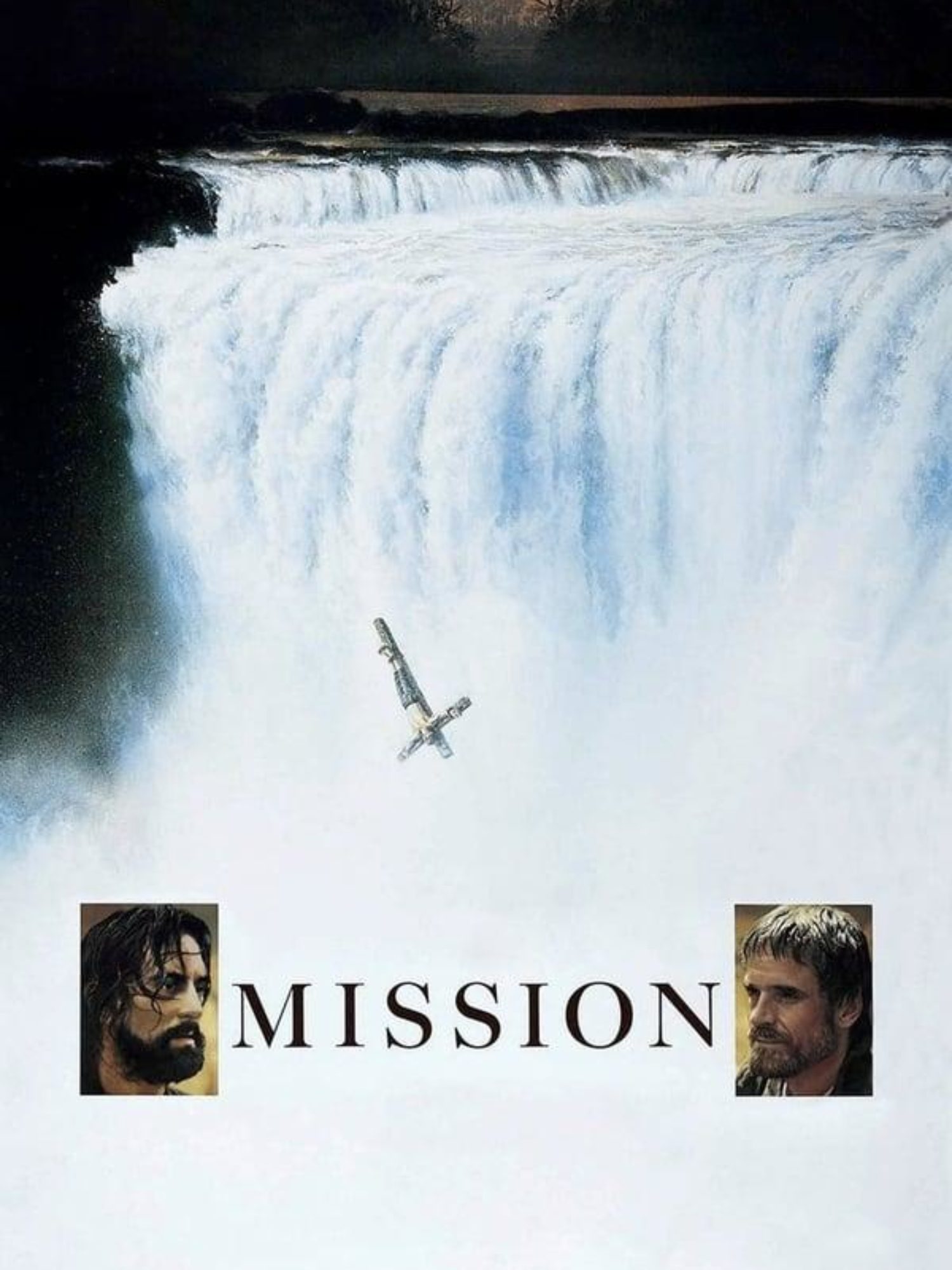(羅生門)
1950
De: Akira Kurosawa
Avec: Toshirō Mifune, Machiko Kyō, Takashi Shimura
Sans être fatalement le film le plus communément cité lorsqu’on se penche sur la fantastique carrière de Akira Kurosawa, “Rashômon” est peut-être bien son œuvre la plus étudiée. Souvent réduite à sa structure au cours de l’analyse, la pellicule n’en cache pas moins une richesse insoupçonnée qui s’y mélange dans un ballet macabre. On a coutume de dire que “Rashômon” emprunte énormément au “Citizen Kane” de Orson Welles, du fait de sa narration en flashback et bien que le maître japonais n’ai pas vu l’œuvre de son homologue avant de nombreuses années. Mais la comparaison ne rend pas réellement grâce aux deux long-métrage: “Citizen Kane” réfléchissait bien la perception de l’homme, mais au fil de sa destiné dans son entièreté; “Rashômon” propose de revenir inlassablement sur un seul et unique événement tragique, mais raconté par une multitude de points de vue différents, définissant ce que le souvenir humain peut avoir de subjectif.
Ce point de convergence qui va unir les personnages ne saurait être plus funeste: alors qu’il se promène en forêt, un bûcheron (Takashi Shimura, un habitué de l’écurie Kurosawa) découvre le corps sans vie d’un homme, perdu dans les bois. Rapidement, c’est sur Tajomaru (Toshiro Mifune, indissociable lui aussi du réalisateur), un brigand local que vont se jeter les suspicions. Mais au cours du procès, sa version des faits va se confronter et contredire celle de l’épouse du défunt, prétendument violée, et plus mystiquement celle du mort. Assis sous l’une des portes, la fameuse Rashômon, menant à Kyoto, le bûcheron, un bonze, et un vagabond débattent de la teneur des témoignages, du verdict et tentent faire émerger la vérité.
On oppose donc deux trios dans “Rashômon”, celui des acteurs du crime qu’il conviendra de mettre en perspective, mais aussi celui de ces trois hommes assis à l’abri de la pluie. D’une part, on reconnaît là une marque de fabrique de Kurosawa: sa narration par les conditions climatiques. Une pluie diluvienne s’abat sur cette triste bande, le monde semble en plein chaos, en proie à la déliquescence progressive, écho parfait au déchirement moral de ces témoins. D’autre part, Kurosawa s’appuie pleinement sur le travail de l’écrivain à l’origine du scénario, Ryunosuke Akutagawa, pour proposer trois personnages totalement complémentaires. Le coupeur de bois est un homme du peuple aux aspirations très concrètes, le moine est en plein effondrement philosophique, tandis que le troisième larron vient apporter une touche de cynisme. C’est grâce à cette habile mise en place que le délit prend autant de résonance. Kurosawa nous prévient d’entrée: impossible de trouver une logique aux cours des évènements, “Rashômon” est le récit d’un désastre judiciaire.

« Confessions intimes. »
Car en face de ses hommes perdus dans une quête de sens, Kurosawa nous propose en parallèle une autre triplette, celle de ceux qui sont les artisans du meurtre. Des personnages volontairement décrits d’une manière un peu caricaturale pour leur donner une stature, que Toshiro Mifune va d’ailleurs personnellement incarner à merveille. On y voit le spectre de l’instinct animal, de l’esprit bestial qui sommeille en chacun de nous, alors qu’en face s’oppose femme et mari, l’une se voyant comme esclave des hommes, l’autre indigne de son rang. La force de Kurosawa, et de l’histoire en elle-même, c’est de faire de ces trois protagonistes des coupables à part entière. Tour à tour, il revendiquent la paternité du crime.
Que comprendre dès lors d’un récit qui ne donne pas de solution, mais préfère soulever des questions? Plus problématique encore, comment admettre la responsabilité chez ceux qui sont avant tout, et quoi qu’ils en disent, victimes. En premier lieu, et c’est l’intention avoué de Kurosawa dans son autobiographie, “Rashômon” est une dissertation sur la vérité, et sa perception. Il n’existe de réalité universelle que dans l’instant présent, évoquer les souvenirs se fait forcément par le prisme de la subjectivité. A plus forte raison, reconstituer la vie réelle, comme le fait un cinéaste, est fatalement un acte personnel.
En second lieu, c’est la culpabilité non pas de l’individu, mais davantage de la société qui est mise en lumière. Pour bien comprendre l’intégralité de “Rashômon”, il faut saisir ce que décrit Kurosawa: pas un simple meurtre, mais un terreau fertile à la dérive morbide, un monde pas si lointain où l’envie, la convoitise, mais aussi l’insouciance de ceux qui exposent leur richesse sont mises en accusation. “Rashômon” s’appuie sur des bases de thriller judiciaire pour clamer haut et fort que notre planète n’est pas peuplée d’innocents, mais de coupables en devenir. Le maître photographie l’âme humaine.
Avec autant de complexité, on pourrait craindre que le long métrage soit obscur, voire complexe à déchiffrer: il n’en est rien. Kurosawa est d’une fluidité totale, plus visuel que verbeux. Sa mise en scène semble encore très marquée par l’époque du cinéma muet, proposant de nombreuses séquences sans dialogue d’une certaine longueur, sans jamais perdre le fil. Pour peu, on pourrait même imaginer vivre une bonne partie de “Rashômon” le son coupé, et en saisir de nombreuses strates tout de même. Le signe incontestable d’un film qui sait à la fois puiser dans ce qui a été fait, et proposer une narration novatrice.

Sans conteste un des sommets de la prolifique carrière de Kurosawa, “Rashômon” marie parfaitement le concret et l’abstrait, tout comme la narration et le fond.