
2022
Réalisé par : Andrew Dominik
Avec : Ana de Armas, Adrien Brody, Bobby Cannavale, Julianne Nicholson
Il y a parfois des films qui, dès les premières minutes, sont étouffés, brisés voire « tués » par les attentes, les fantasmes, les espoirs qu’ils ont générés en amont. Que ce soit par leur pitch, leur réalisateur, leur casting, leur ambition ou même leur bande-annonce, ces œuvres accueillent des spectateurs convaincus d’être au seuil d’un chef-d’œuvre absolu. Et là, c’est le drame…
Blonde, du réalisateur néo-zélandais Andrew Dominik (Chopper, l’Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, Cogan : killing them softly), est rentré dans cette funeste catégorie… en essayant, paradoxalement, de plonger le spectateur dans les affres intérieures d’une femme qui semble avoir été étouffée, brisée et tuée par les attentes, les fantasmes et les espoirs qu’elle a engendrés : Norma Jean Mortenson alias Marilyn MONROE (interprétée ici par Ana de ARMAS).
Produit par Plan B entertainment (la boîte de Brad Pitt) et distribué via Netflix, le film a été éreinté par de nombreux critiques et spectateurs, perdant rapidement ses espoirs de devenir une œuvre culte, saluée et même oscarisable. Ces reproches ne sont d’ailleurs pas injustifiés à de nombreux égards mais on peut se demander si, au final, l’œuvre n’est pas comme son personnage principal : une apparence savamment calculée mais trompeuse, forcément déceptive, mais dont l’intérêt se situe véritablement derrière de nombreuses façades qui nécessitent d’être dépassées.
Une fausse biographie pour une vraie fiction ?
La première apparence trompeuse de ce film est qu’il n’est pas la biographie définitive et moderne de l’une des icônes cinématographiques les plus connues. Les auteurs ont pris des libertés incroyables avec la réalité (quitte à réécrire des faits avérés) et passent ainsi sous silence de nombreux aspects de la vie courte et tourmentée de la jeune femme.
Oubliez alors ses bras de fer avec les studios, ses tournages chaotiques, ses addictions, ses problèmes de santé majeurs, ses troubles mentaux ou encore ses relations compliqués avec ses partenaires de jeu, ses réalisateurs, ses amis ou même les Kennedy (le président John F. mais aussi son frère Bobby.).
Ne comptez pas non plus trouver un portrait exhaustif de cette femme complexe, qui était décrite comme plus intelligente qu’il n’y paraissait, ambitieuse, drôle, mais aussi angoissée, capricieuse, exigeante et insécure. Si le film laisse entrevoir plusieurs facettes de Norma Jean au détour de quelques scènes et phrases de dialogue, l’accent est exclusivement mis sur sa fragilité, résultat de sa quête identitaire initiée par la recherche et l’attente de ce père mystérieux et inconnu.
Cette approche est peut-être crédible compte tenu du parcours de l’actrice mais elle est forcément limitative. Elle est aussi mise à mal par l’insistance régulière sur les nombreux abus que Norma Jean a subis (de sa mère, de producteurs, des fans, de l’opinion, de ses amants, de ses maris, etc…). Le portrait de la jeune femme se réduit alors à celui d’une victime permanente, petit oiseau plein d’espoir mais naïf, éprouvé jusqu’à la rupture par la vie qui lui a été lui imposée.

Et ce n’est pas la structure narrative faussement chronologique du film qui apporte un semblant de cohérence, alors que des dates ponctuent le film comme autant de chapitres improbables. Le découpage donne plus des allures de puzzle mémoriel et sensoriel, dans lequel le spectateur est emporté (ou pas), abandonnant rapidement tout espoir de trouver une quelconque logique documentaire à l’ensemble.
Racontée ainsi, Blonde apparaît donc au final comme le résumé dilué, partisan, presque racoleur, et totalement biaisé de la vie et d’une personne en réalité plus riche et complexe. Difficile de se dire qu’on en sait plus sur le parcours de Marilyn Monroe, la frontière entre fiction et réalité ayant été brouillée au point de disparaître plus d’une fois. On peut même se demander s’il n’aurait pas été plus judicieux de changer les noms des personnages comme l’a fait Valérie Lemercier pour sa vraie/fausse biographie de Céline Dion, Aline (dont le titre original semblait être « dis-moi Céline »).
Mais peut-on vraiment faire le reproche au film de s’être autant éloigné des faits ? Pas si sûr.
Car Blonde s’est toujours présenté comme un « portrait imaginaire » non pas de Marilyn Monroe, création fictive basée sur les fantasmes et archétypes de l’époque, mais de celle qui a endossé cette identité, cet avatar : Norma Jean Mortenson.
Un cauchemar inspiré de faits réels
Le (très) long-métrage (2h47) a, dès le départ, affiché son statut d’adaptation du roman éponyme de Joyce Carol Oates, un pavé de plus de 700 pages paru en 2000. L’ouvrage se présentait déjà comme une biographie fictive de l’actrice, très marquée par la volonté de l’autrice de présenter Marilyn comme une victime régulièrement éprouvée. Quoi qu’on puisse penser de cet étrange parti pris littéraire, entre exercice de style original et exploitation facile et partiale d’une vie réelle, le film Blonde suit la même logique.
Sa bande-annonce avait immédiatement donné le ton. Avec ses images pleines d’un glamour noir et blanc, ponctuellement interrompues par de fugaces plans cauchemardesques, le trailer craquelait petit à petit le vernis de l’icône pour laisser entrevoir l’aversion de Norma Jean pour son identité d’actrice. Le déraillement progressif de la chanson « Diamonds are a Girl’s Best Friend » dans la bande-son accentuait encore plus cette impression que le film se dirigerait vers un escamotage en règle des apparences pour plonger dans l’aliénation de cette starification hors de contrôle.
D’ailleurs, les premières minutes du long-métrage nous mettent rapidement dans le bain, en nous plongeant dans le quotidien angoissant subi par la petite Norma Jean (Lilly Fisher) sous le joug de Gladys, sa mère instable (formidable prestation de Julianne Nicholson). Dans un accès de folie, cette dernière entraîne sa fille en voiture aux portes d’un incendie dantesque, prétextant aller y retrouver ce père que Norma Jean n’a jamais connu. De la mise en scène d’Andrew Dominik à la photographie de Chayse Irvin, tout s’accorde à installer une ambiance cauchemardesque qui ne quittera plus le film.
Au bout du premier quart d’heure, il devient alors évident que le film ne suivra pas les traces des biopics classiques mais plutôt celles des fugues mentales de David Lynch (Lost Highway et Mulholland drive reviennent souvent en tête). Mais Blonde peut aussi curieusement faire penser à l’échelle de JACOB, le chef-d’œuvre d’Adrian Lyne.
Sorti en 1990, le film retraçait la descente aux enfers de Jacob, un ancien soldat traumatisé par la guerre du Vietnam. Assailli par des visions de plus en plus dérangeantes et horrifiques, qui ont servi d’inspiration au jeu Silent Hill, le vétéran s’enfonce dans une réalité qui semble basculer inexorablement vers le cauchemar, au point de ne plus savoir si l’histoire racontée est bien celle que vit Jacob.
Plusieurs séquences de Blonde puisent dans cette source visuelle électrisante. Comme par exemple, une montée des marches, sous les feux de flash aveuglants des photographes, qui épouse le point de vue de Marilyn pour nous montrer les visages déformés et monstrueux des hommes qui s’amassent pour la voir, la toucher. Il y a aussi ce moment fugace où la jeune femme déboussolée ne reconnaît pas son mari « le dramaturge » (l’acteur Adrien Brody, tout en émotion contenue et en distance inquiétante) dont le visage apparaît littéralement effacé. Il y a enfin cette scène digne de Paranormal Activity dans laquelle une Norma Jean presque spectrale, avec des yeux très noirs et une peau diaphane qui laisse entrevoir des veines toutes aussi sombres, arpente, dans l’obscurité, les couloirs de sa petite hacienda, pressentant une présence… que l’on découvre furtivement tapie dans un coin, grâce à la vision nocturne de la caméra.

Ces séquences ne sont que quelques exemples illustrant ces allers-retours permanents du film entre l’imagerie artificielle « glamour » associée au cinéma et celle plus dérangeante et effrayante qui traduit la perception par Marilyn de la réalité. À mesure que le long-métrage avance, ces ruptures de ton se font de plus en plus fréquentes, comme dans ces rêves qui commencent sur des légères touches d’anormalité avant de basculer dans une terreur pure et surréaliste.
Pour illustrer, lourdement, diront certains, l’effondrement mental de son héroïne, Andrew Dominik écarte les dialogues et les explications pour privilégier une narration très sensorielle avec son lot d’interprétations. Cette constante impression de descente aux enfers est renforcée par la partition écrasante, funeste mais envoûtante signée Nick Cave et Warren Ellis. Si elle sait soutenir légèrement les rares moments de bonheur de Marilyn par des accords qui vous évoqueront sans doute les envolées finales dont Elliot Goldenthal dans Heat, la bande originale épouse totalement la folie grandissante de l’actrice et sublime l’ambiance flottante, enveloppante et oppressante de nombreux passages.
Ainsi, à mesure que Norma Jean voit ses rêves et ambitions se craqueler sous le poids d’un destin qui lui échappe, l’apparente autobiographie s’effrite, elle aussi, pour laisser paraître sa véritable identité : un cauchemar luxueux illustrant l’affrontement permanent entre trois identités qui vont finir par se détruire mutuellement.
Trois identités, une même destruction ?
Blonde se termine assez logiquement sur le trépas solitaire de Marilyn dans son lit. Là encore, on peut regretter que le cinéaste et ses auteurs ne se soient pas essayé à une quelconque tentative d’investigation, les circonstances de la mort de l’actrice ayant fait l’objet de nombreuses spéculations.
Mais ce qui fascine c’est le dernier plan, qui peut tout à la fois sonner comme un ultime choix de mauvais goût ou une brillante illustration de la thématique du film. Le corps de Norma Jean repose alors sur ses draps, le téléphone près d’une main, dans une posture presque lascive. À cette image macabre, souvent décrite dans les documentaires, Andrew Dominik superpose alors une version fantomatique de son héroïne qui semble sortir de son cadavre pour prendre une dernière pose souriante face aux spectateurs, telle une pin-up d’outre-tombe.
Le cinéaste paraît alors utiliser cette technique pour symboliser la survie du mythe, de l’icône, et même de la marque « Marilyn » qui continue et continuera à rapporter des centaines de milliers de dollars chaque année.
Mais ce plan n’est-il pas aussi une façon de rappeler que derrière cette « créature fictionnelle », se cachent aussi deux autres femmes : la Norma Jean comédienne dont l’entourage l’aidait à se transformer en Marilyn Monroe (représentée par le corps sans vie qui contribue à sa légende) mais aussi la Norma Jean enfant brisée et abandonnée, qui n’a finalement jamais pu exister et dont il n’existe à l’image aucune trace dans le plan car c’est elle qui a vraiment disparu à jamais.
C’est cette dimension de « poupée russe » identitaire qui rend ce film fascinant. En suivant dès le départ la jeune Norma Jean, on assiste à l’ajout successif des « masques » qu’elle va devoir porter, jusqu’à l’étouffement complet de qui elle est. Le film est ainsi très clair sur tout ce qui va contribuer à la charger, en permanence, de nouvelles identités : cela va de sa transformation physique, symbolisée justement par sa couleur de cheveux blonde, aux rôles imposés par les studios, en passant même par les « fonctions » de mère et de femme au foyer que semble attendre d’elle la famille de son second mari (« l’ex-athlète » italo-américain, incarné par Bobby Cannavale).
Le film traque donc l’émergence des « bugs » que ces reprogrammations permanentes vont créer dans la psychologie de la jeune femme. Le jeu d’Ana de Armas est en cela intéressant car elle parvient souvent à créer cette double lecture où on distingue la jeune et fragile Norma Jean, essayant d’être Norma Jean la femme adulte… qui elle-même vit dans l’ombre de la puissante et indétrônable Marilyn Monroe.
Blonde place donc au cœur de son récit l’aversion grandissante de la comédienne pour son alter ego de cinéma, mais ce n’est pas pour autant une approche binaire de lutte entre le « masque » et celle qui le porte. Car la quête déchirante par Norma Jean de son mystérieux père (de son amour, de sa reconnaissance) est tout aussi importante et révélatrice de l’incapacité de la jeune femme à grandir et à s’épanouir. Les années passent, le succès arrive, les amants se succèdent, et pourtant, sa fragilité intérieure reste visible, que ce soit à travers sa naïveté confondante, sa vulnérabilité face aux multiples agressions physiques, sexuelles ou psychologiques qu’elle subit ou encore sa persistance à appeler ses maris « daddy », comme pour souligner un complexe d’Electre déjà bien évident.
Le rapport au corps de Marilyn devient alors une façon intéressante d’illustrer ce combat. On suit une Norma Jean, encore un peu enfantine, entrer dans un monde « d’adulte » sous les atours d’une femme vite désirée, convoitée et qui lui ouvrent simultanément les portes de la gloire et celles de l’enfer. La scène du viol qu’elle subit au début du film dans le bureau du producteur « Mr Z » est d’ailleurs représentative de cette fracture : Norma Jean entre comme une enfant naïve et vulnérable dans l’antre d’un prédateur (les animaux empaillés aux murs en trahissent la nature) et se voit immédiatement abusée, avant de repartir en larmes.

Ce n’est pas la seule scène qui exploite, dans tous les sens du terme, cette instrumentalisation sexuelle de la jeune femme par des hommes puissants, dominateurs ou possessifs et c’est un reproche qu’on pourrait faire au film, tant il semble dénier à Marilyn tout contrôle sur sa vie sexuelle, un nouvel écart avec la réalité.
Ana de Armas apporte en plus à cela un trouble supplémentaire par sa présence physique. Si sa ressemblance avec Marilyn est réelle, même si parfois discutable, son petit gabarit doté de courbes généreuses crée un sentiment dérangeant, dû au mélange de sensualité et de vulnérabilité juvénile qu’elle dégage. La scène où son mari « l’ex-athlète » la frappe, par jalousie, alors qu’elle se reposait nue, dans sa chambre, représente toute l’ambiguïté malsaine sous-jacente à ce portrait d’une femme-enfant censée être un objet de fantasmes absolus. Et le jeu de Bobby Cannavale, entre paternalisme réprobateur et amoureux frustré, renforce encore, s’il en était besoin, cette désagréable sensation de relation presque incestueuse.
Ce parti pris, encore une fois, paraît clairement relevé de l’approche « fiction » des auteurs du film et il repose aussi sur un portrait trop approximatif ou réducteur de Marilyn Monroe. Pour autant, la façon intéressante dont la mise en scène illustre cette cohabitation dangereuse des identités de Norma Jean qui se complètent tout en se détruisant.
L’enfant devient actrice pour être aimée, l’actrice accepte de devenir une icône pour réussir, mais cette dernière n’apporte jamais, ni à l’actrice ni à l’enfant, ce dont elles ont besoin pour s’épanouir. Et les traumatismes de l’enfant empêchent l’actrice de devenir la femme qui lui permettrait de reprendre le contrôle de sa vie, au lieu de la laisser aux mains de son alter ego starifié.
Les scènes qui montrent ce choc frontal entre ces trois identités qui se parasitent sont ainsi les plus réussies du film. Comme celle où Norma Jean pète littéralement un câble sur un tournage et va jusqu’à « prendre en otage » Marilyn la (se) mutilant, en se griffant le visage pour obliger l’équipe à lui octroyer une pause… pour un raccord maquillage indispensable.
Un pur exercice de style vain ?
Alors oui, ce n’est pas la leçon de psychologie la plus fine qui soit et ce n’est sûrement pas la réalisation et la mise en scène ultrapensées d’Andrew Dominik qui apportent un peu de subtilité. Mais peut-on reprocher à un réalisateur d’essayer de donner du sens à travers le spectacle ?
Et une fois acceptées les entorses (triple fracture ouverte, diront certains !) à la réalité et oublié le « masque » de biopic, le film s’apprécie, lui aussi, pour ses deux autres identités cachées : celle d’un film faussement glamour sur la destruction du réel par les simulacres du cinéma et celle d’une réflexion en creux sur les crises identitaires qui peuvent frapper celles et ceux pris entre ce qu’ils sont, ce qu’ils pensent qu’ils doivent être et ce qu’ils sont devenus pour survivre.

Blonde refuse au final de livrer un biopic de Marilyn Monroe et choisit de s’attarder sur sa crise identitaire, en entraînant le spectateur dans un cauchemar stylisé, chaotique où la réalité est souvent dévorée par la fiction… comme son héroïne.
Blonde est disponible sur Netflix.




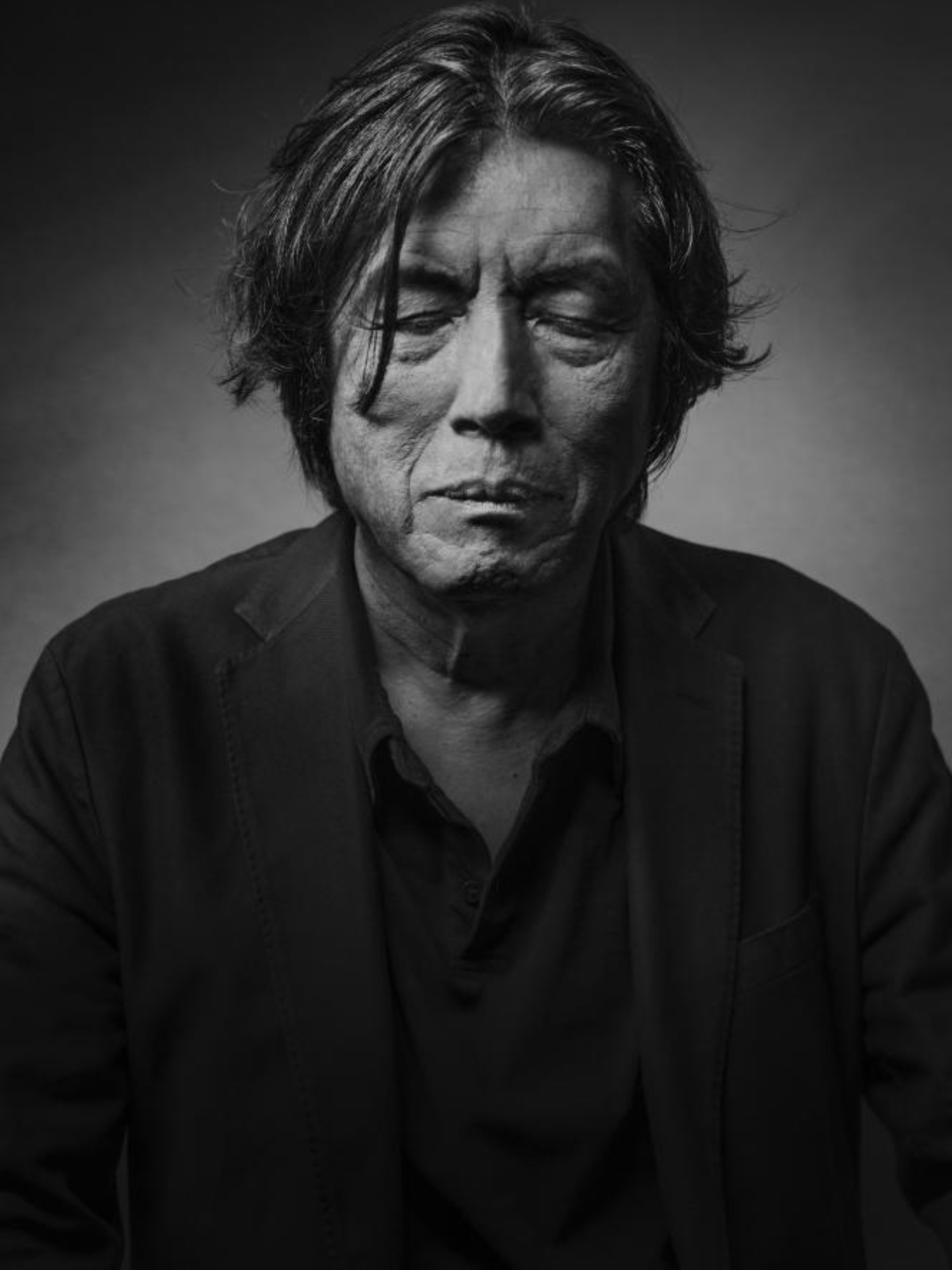

Ping : Les nominations aux Oscars 2023 - Les Réfracteurs