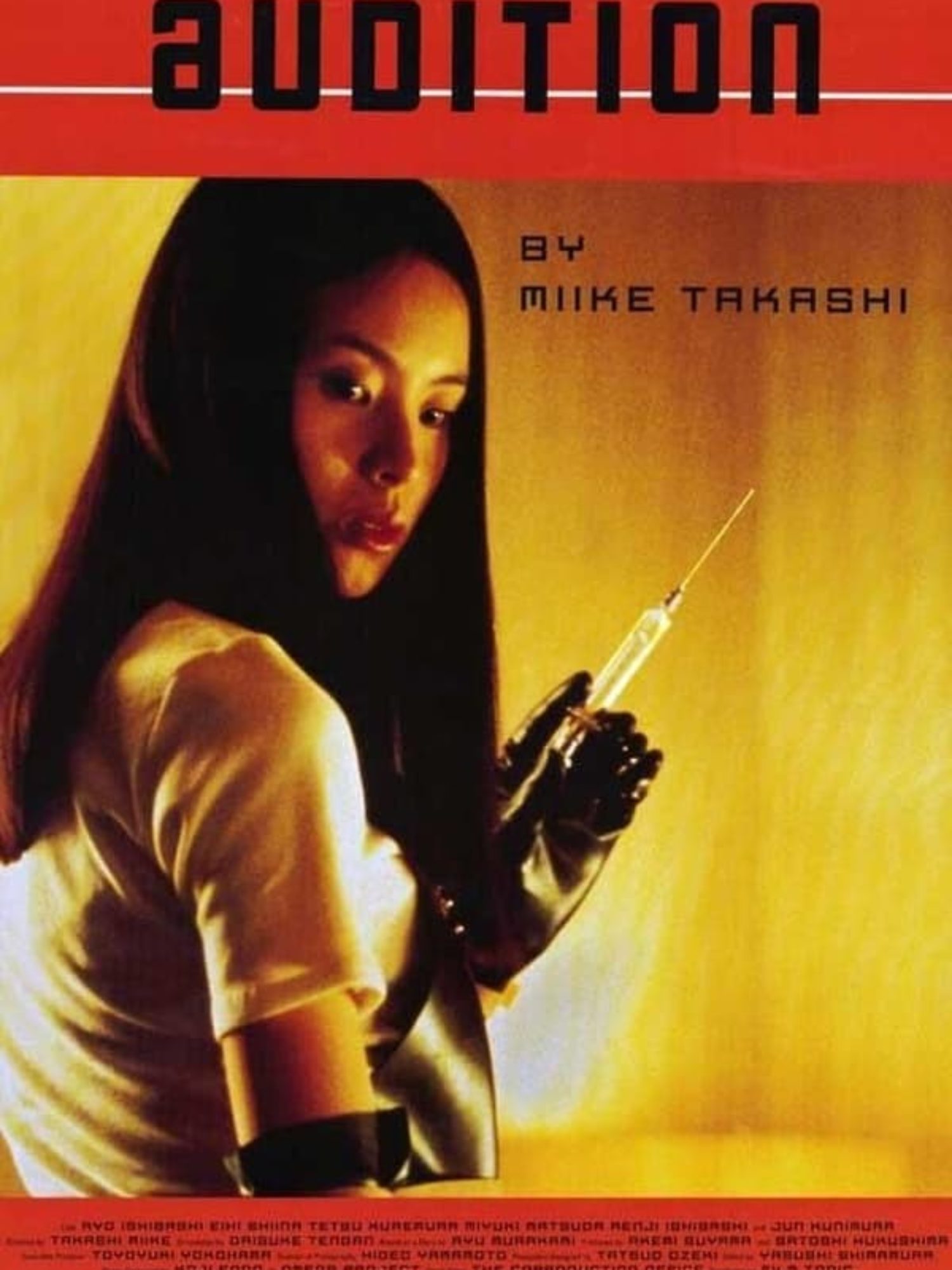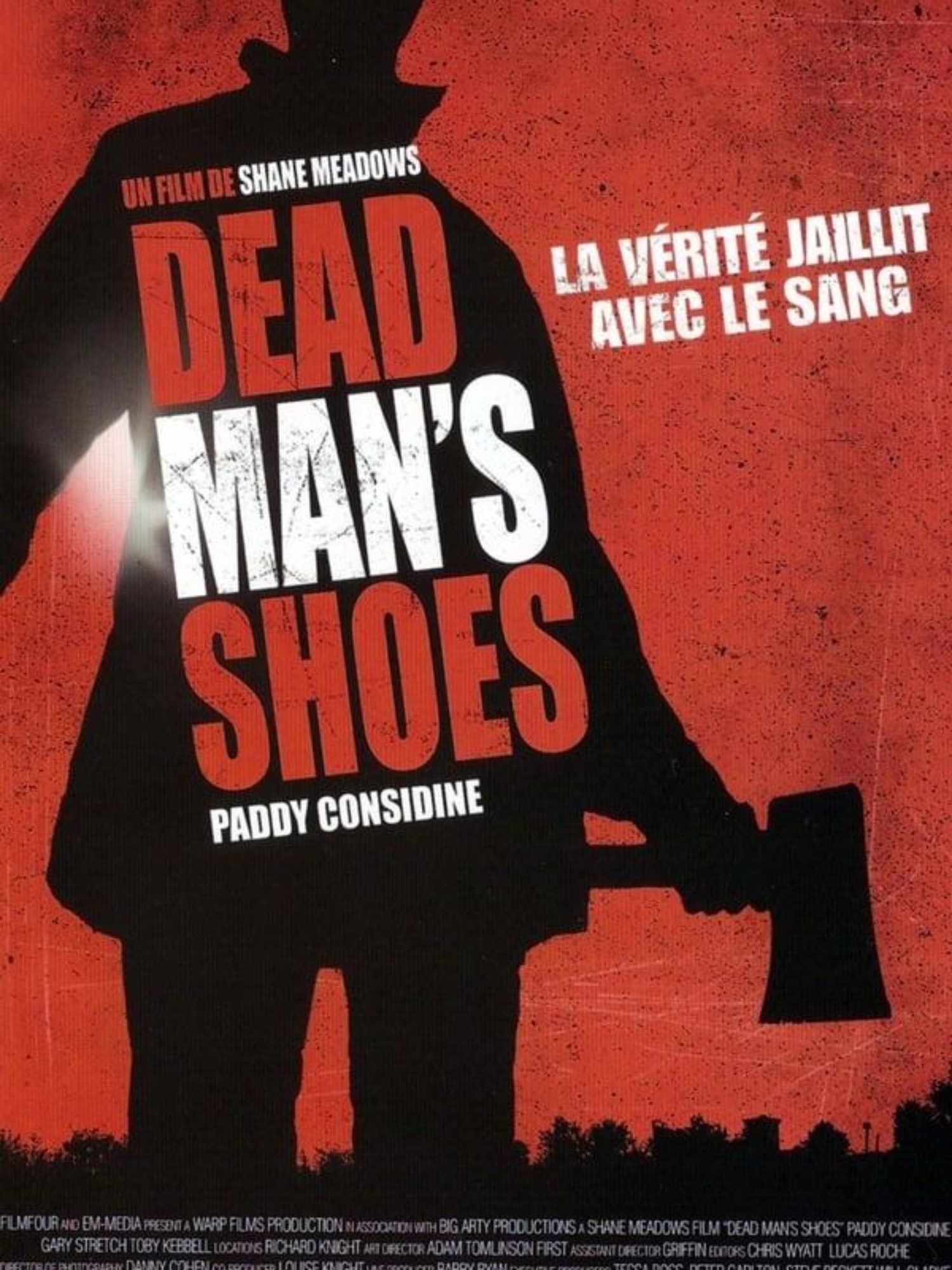(The Sailor Who Fell From Grace with the Sea)
1976
Réalisé par : Lewis John Carlino
Avec : Jonathan Kahn, Kris Kristofferson, Sarah Miles
Film fourni par Carlotta Films
Au delà de l’horizon
Artiste polymorphe par nature, homme de convictions aussi inébranlables qu’insaisissables, Yukio Mishima a marqué de son empreinte la littérature du XXème siècle. De ses mots savants, l’auteur souffle au gré de ses romans son obsession profonde pour la rigueur morale, la fascination des forces primaires de la nature et un goût du vice qui fait de chaque lecture une épreuve de force émotionnelle. Durant les années 1960, le japonais est au sommet de sa popularité, bien qu’il se fasse plus énigmatique que jamais. Il enchaîne alors les essais salués de par le monde, s’essaye aux métiers d’acteur et de metteur en scène et manifeste sa monomanie pour l’érotisme à travers une série de photographies dans lesquelles il se montre pratiquement nu, lui qui voue un culte insensé à la perfection du corps et de l’âme. Cette décennie faste marque aussi une profonde radicalisation politique pour Yukio Mishima qui entend restaurer la gloire de l’empereur japonais et son droit divin, en tentant un coup d’État rapidement annihilé, par le biais de sa propre milice. Ses écrits ont façonné l’esprit d’une jeunesse, jusqu’au sacrifice de sang ultime. Point final macabre au terme d’une trajectoire sinistrement atypique, il se donne la mort par seppuku, le suicide rituel nippon, en 1970, à seulement 45 ans. La vie de l’agitateur de conscience fascine ses contemporains, jusqu’au cinéaste Paul Schrader qui lui consacre un biopic onirique en 1985, sobrement intitulé Mishima. S’il est permis de douter des valeurs de l’homme, son travail d’auteur force l’admiration et forme un corpus cohérent qui tente de déconstruire la psyché d’une génération marquée par les luttes sociales, pour tendre vers une recherche de la vérité profonde inscrite dans la chair. Marguerite Yourcenar s’essaye elle-même à une analyse désespérée de l’œuvre du romancier dans Mishima ou La vision du vide, publié en 1980, en quête d’une pensée claire derrière l’énigme des mots.
Tenter de poser des qualificatifs concrets sur les réflexions philosophiques d’un homme habité par son art et sa fureur confine à l’entreprise vouée à l’échec, mais pour toute une descendance mishimiesque, les livres survivent, immortels à l’épreuve du temps et s’affranchissent des frontières. Publié en 1963, Le Marin rejeté par la mer vogue comme les bateaux dont il est fait mention dans l’ouvrage, sa verve intrépide voyage et s’échoue sur les côtes anglaises, au bénéfice d’une adaptation cinématographique, Le Marin qui abandonna la mer, sortie en 1976. Cri de révolte adressé à une jeunesse nippone sans grande figure de guide paternaliste, le roman trouve un nouveau reflet en étant transposé à l’écran à une enfance britannique en proie aux mêmes maux. Alors scénariste reconnu pour sa capacité à adapter les grands auteurs de son époque, les DH Lawrence, Pat Conroy et autres Joanne Greenberg, Lewis John Carlino s’essaye pour la première fois à la réalisation avec ce long métrage, témoignage initial de sa science de l’image et de son regard contrasté sur un monde qui a perdu ses repères. Il épouse la dimension romantique du livre, mais il se joue avec un brin de malice des attentes d’un public peu averti des élans sanguinaires hérités de Yukio Mishima. Lewis John Carlino fait ainsi appel à Kris Kristofferson pour incarner le marin modèle de virilité nécessaire à son film, conscient de l’aura sensuelle exotique que revêt le chanteur et acteur américain auprès des spectateurs européens, mais il déconstruit totalement cette figure à l’écran pour domestiquer l’indomptable. Le metteur en scène ne peut pas non plus ignorer qu’en employant la comédienne Sarah Miles, icône du Swinging London, et en lui faisant arpenter les littoraux britanniques, il convoque le souvenir empli d’émotion de la pépite romanesque La Fille de Ryan, et pourtant c’est une toute autre facette de la jeune femme qu’il montre à l’écran, celle héritée de l’obsessionnel Blow-Up de Michelangelo Antonioni. Le Marin qui abandonna la mer est un jeu de dupe avec le spectateur, un faux film d’amour perçu du regard incompréhensif d’enfants exclus du monde des adultes, livrés à leurs propres appétits morbides.

Le héros du film n’est ainsi pas le sublime matelot au long court, mais bien Jonathan, un adolescent joué par Jonathan Kahn, qui vit seul avec sa mère veuve Anne, incarnée par Sarah Miles, et la domestique qui les accompagne. Membre d’un groupe d’amis déviants mené par un autoritaire despote qui ne répond qu’au dénominatif de “chef” et qui ne cesse de prêcher la légitimité des plus sombres pulsions humaines, Jonathan se conforme à ce joug oppressif comme seule boussole. Lorsqu’un navire jette l’ancre dans la baie du village, le sublime marin Jim, campé par Kris Kristofferson, éveille chez le jeune protagoniste toute la frénésie de ses rêves maritimes, lui qui nourrit le souhait de devenir matelot. Néanmoins, la relation amoureuse qui se tisse entre le vice-capitaine et la mère de Jonathan bouleverse l’adolescent, qui assimile cette union à une trahison de l’absolue pureté de l’idéal aventureux. À travers un trou dans le mur des chambres voisines, il observe celle qui lui a donné le monde dans sa plus stricte intimité et contemple avec dégoût ses ébats charnels avec Jim.
La mauvaise éducation
Dans l’espace étriqué des récurrentes formes rondes qui émaillent le long métrage, les êtres à quai et pourtant à la dérive ne perçoivent qu’une portion restreinte de la réalité. Ils s’éveillent au bénéfice de leur curiosité mais restent entravés par les limites de leur champ de vision. Avide de percer à jour les secrets du monde adulte, une nouvelle génération se construit seule, animée par un appétit déraisonné pour le voyeurisme et pour l’observation méticuleuse de la mécanique des corps. Privé de figure paternelle, esclave d’une mère qui communique difficilement avec lui au-delà de l’autorité nécessaire, Jonathan est à la marge du monde, un prisonnier de son propre placard et de sa soif dévorante pour la contemplation sans pudeur de l’intimité taboue. En nourrissant ses appétits indiscrets, le protagoniste du Marin qui abandonna la mer s’éduque par lui-même selon un cheminement pernicieux, qui se décrit essentiellement par une absence totale de conscience de la dimension affective essentielle qui unit Anne et Jim. Jonathan n’intellectualise pas sainement la communion des âmes au-delà du ballet charnel, il y décèle même une forme de péril instinctif et de domestication perverse de l’homme aventurier. Alors qu’il n’a même pas conscience du corps, comme en témoigne une séquence où il espionne sa mère en pleine masturbation mélancolique devant un portrait du père disparu, l’adolescent ne décrit la scène dans son journal intime que comme “la plus étrange des choses”. Sans éducation émotionnelle, il ne conceptualise le monde adulte qu’au travers de ses pulsions infantiles, martyr d’une bonne société anglaise de la pudibonderie.

Le Marin qui abandonna la mer force alors le public à constamment épouser le regard malsain de Jonathan, car le pari même du film est de comprendre sa logique. Les scènes d’ébats sont ainsi le plus souvent filmées au travers du trou de la chambre, fusionnant le cercle de la pupille de l’œil de l’enfant et celui qui perce le mur. L’image est entourée d’un halo flou, réduisant son cadre, comme les œillères d’un cheval. Réunie sous une étrange construction de pierre semblable à une haute cheminée, la bande d’écoliers est elle aussi esclave du rond parfait que forme le haut monticule et que Lewis John Carlino montre à plusieurs reprises, spectateur omniscient de la déchéance des enfants. Même la perception d’Anne est faussée au cours d’une très brève séquence où elle joue du reflet d’une cuillère sur le corps nu de Jim, nouvelle occurrence sphérique qui laisse à penser que cette femme enfant ne distingue chez le marin que le fantasme qu’elle projette. Sexe et mort s’affronte alors, selon l’opposition mythologique entre Eros et Thanatos : le corps alangui de désir de la mère semble frappé par la souffrance, la musique qui s’installe est désaccordée, disconnante, mais plus que tout, la mise en images faite de fondu enchaînés trouve un écho formel explicit au cours d’une scène difficilement soutenable de dissection d’un chat. Sans éducation au sentiment amoureux, Jonathan assimile vie et mort dans un même élan de décomposition charnel.
Jonathan est un personnage de pulsions primaires, pourtant inscrit dans un cadre social marqué par un rapport de domination injuste et strict, celui de son club d’amis. Ici, les enfants abandonnent leur personnalité jusqu’à leur propre nom, ne se désignant que par des numéros et reproduisant ainsi une forme de hiérarchie archaïque, héritée de l’émulation du monde adulte. Sans s’en rendre compte, ils réitèrent malgré eux l’injustice des disparités économiques alors que le pervers chef issu d’un milieu aisé semble détenteur d’un pouvoir divin, assujettit ses semblables, mais plus que tout se présente à eux comme unique gardien de la vérité et du savoir. Il est le père de substitution à tous ces ascendants absents du récit, une créature ténébreuse éducatrice du vice et de l’inconscience de la vie, allant jusqu’à mettre à mort son propre animal pour s’extasier des muscles et viscères. Abandonnés comme des naufragés en pleine mer, les adolescents construisent leur propre malheur d’inégalité et la pensée de Yukio Mishima faite de grandes figures tutélaires iconiques mais friables se confond avec un semblant de Sa Majesté des mouches de William Golding. Puisque les enfants du Marin qui abandonna la mer sont délaissés, alors les seules règles morales auxquelles ils sont tenus de répondre sont celles bestiales qu’ils ont eux-même édictées. Si le film peut se concevoir comme un miroir juvénile de la société, alors le long métrage s’apparente à une vive dénonciation de la décrépitude des relations humaines et de l’émergence de nouveaux codes de conduite nuisibles. Des règles propices au reniement du bonheur personnel, au profit d’un collectif malfaisant.
“La morale n’est rien d’autre qu’un ensemble de règles que les adultes ont inventées pour se protéger. Un ensemble de règles pour les faibles. Si l’on est fort, on n’a pas besoin de protection. On ne craint pas un monde où la seule réalité est la vie du faible nourrissant la vie du fort.”
Le chef
Au conformisme des enfants, rendus analogues par leurs uniformes d’écoliers, Le Marin qui abandonna la mer répond par la fureur des adultes, êtres de passions féroces dont ils se réservent l’expérience. Presque démissionnaire, la mère de Jonathan délaisse son enfant au profit de sa nouvelle idylle, créant dans la tête de son fils un lien tenace entre cette romance et son malheur. Les personnages d’âge mûr du film sont les garants d’un savoir ancestral, illustré par le métier d’antiquaire d’Anne ou par la connaissance de la mer propre à Jim. Pourtant, de ces enseignements, ils ne prodiguent le plus souvent rien à l’adolescent, ou de manière très sporadique, inconscients de sa maturité qui se façonne à l’ombre du mal. Jonathan souffre avant tout de cette solitude qui le force à recomposer le puzzle d’une dimension inconnue. Les motivations du marin et de la veuve sont claires pour le spectateur, mais tout ce cheminement émotionnel est refusé à l’enfant, qui voit dès lors une promesse de mariage comme le sacrifice d’une vie dont il rêve. Il ne souhaite pas la compassion de Jim, il la refuse même à la fin, la vivant comme une injure impardonnable, il veut plus que tout que le matelot reste le modèle héroïque de virilité que son imaginaire nébuleux a construit. Il pense toujours à son propre père et se refuse à le remplacer, mais davantage que ce personnage absent, qui propulse Le Marin qui abandonna la mer dans une dimension œdipienne lors des premières scènes de voyeurisme, Jonathan désire que son nouveau modèle de bravoure s’interdise une vie sans extase du péril. Dans la souillure du quotidien, les figures modèles s’abîment contre le récif de la banalité.

Jonathan, décrit à plusieurs reprises comme un romantique par son tyrannique chef, semble ainsi davantage à la recherche d’un cap que d’un port d’attache. Dans ses songes adolescents, sa soif de comprendre le monde n’est pas néfaste, elle est une impulsion naturelle propre à tous les hommes sur le seuil de l’âge adulte. Avant l’heure cinglante d’un dénouement nihiliste, le protagoniste se démarque de ses pairs par ses élans rêveurs. Il veut connaître le monde, et s’entoure à ce titre de cartes du monde sur les murs de sa chambre, de maquettes de bateaux dont il connaît parfaitement le fonctionnement, de visions oniriques d’un exotisme lointain, aux antipodes de la monotonie de son village. Son voyeurisme n’est jamais compris comme un acte répréhensible par Jonathan, qui ne pense qu’à enrichir ses connaissances. Le trou dans le mur de sa chambre n’est qu’un œilleton de plus sur un monde inconnu, comme le sont les représentations des tropiques, où plus cyniquement le dessin d’une arme à feu. Ses ambitions maritimes répondent avant tout à une soif d’aventure, pour celui qui se refuse à un futur banal et ancré. Ses fantasmes d’ailleurs sont l’exaltateur de sa rébellion envers son chef, lors de la lecture d’un courrier de Jim, mais la perte de ses illusions est synonyme de mort. À terme, il faut bien démanteler ses passions comme il a disséqué le chat, pour en comprendre le fonctionnement chaotique. Il faut mettre à mort le mythe et affronter la réalité sous son jour le plus cru, pourfendre la bête domestiquée pour mieux renier son mode de vie. Le public espère longuement que cette quête d’une direction sera comblée par Jim, notamment lorsque Lewis John Carlino montre le marin et l’enfant au maniement d’un sextant, pourtant au terme de la route, l’obscur Jonathan doit déconstruire le navigateur comme il a décharné le félin, pour comprendre dans le vice primordial pourquoi l’incarnation de ses enthousiasmes s’est résolue à une vie que l’enfant pense médiocre.
Le grand ordre naturel
Épousant l’héritage de Yukio Mishima, Le Marin qui abandonna la mer place les forces primordiales de la nature au cœur du récit, selon ce qui est décrit dans le film comme “l’ordre pur et parfait du monde”. Si dans Le Sabre, autre adaptation de l’auteur signée cette fois Kenji Misumi, le soleil devenait l’élément de sublimation et d’émerveillement d’une quête martiale, c’est ici la mer qui envahit l’écran, comme une force imperturbable, calme sur les littoraux, omniprésente à l’image. Dans chaque recoin, l’eau s’invite, elle offre un point d’horizon éternel et un champ des possibles infini en parfaite inadéquation avec le village du long métrage, sorte de prison qui renferme en son sein les destins avortés d’hommes et de femmes englués sur les récifs. À l’immaculée puissance des flots s’oppose les teintes moroses de maison décrépies, d’un établissement scolaire impersonnel, ou de la boutique d’antiquaire qui n’est qu’un fatras de breloques et de meubles ressuscités de temps anciens. La cité est un départ pour Jonathan, son avenir est au-delà du lointain, dans l’inconnu loin du point de fuite, dans le royaume où la chasteté rigoureuse de son âme trouve écho.
“J’imagine parfois mon cœur comme une ancre en acier qui s’enfonce dans la vase de l’estuaire, dans le verre brisé, les conserves et les canettes. Pur, brillant, jamais rouillé.”
Jonathan
La faim vorace du protagoniste pour l’ailleurs est néanmoins nourrie par une fascination addictive aux évocations récurrentes de la colère des flots. Créant une disparité entre l’image et le verbe, Le Marin qui abandonna la mer relate à plusieurs reprises la furie aquatique des tempêtes qu’essuie le navire de Jim, et le récit devient parole d’évangile pour les aventuriers des abîmes, qu’ils soient aguerris comme le matelot ou simple aspirant comme Jonathan. L’un a découvert le bout du monde, l’autre le désire à chaque rêverie, mais tous deux sont réunis dans la poursuite de cet idéal élémentaire. Les aventures de l’intrépide Jim sont son héritage, l’instrument de la fascination qu’il exerce sur les plus innocents, la seule chose qui peut briser l’unité du groupe d’amis pervers, et en définitive, ses ultimes paroles comme une élégie funèbre. S’opposent en réalité deux âges de la vie d’un homme, celui de l’euphorie incarné par l’adolescent et celui de la résignation synthétisée par le renoncement à la vie maritime du vice-capitaine. Jim a conquis l’infini et au terme de son odyssée, il a trouvé un nouveau port d’Ithaque sur les littoraux anglais, destination finale de sa fougue lointaine.
La fusion scénaristique entre l’homme et l’enfant est exacerbée par la verbalisation d’une même glorification de l’insondable magnificence de la mer et de sa capacité presque ésotérique à attirer à elle les jeunes esprits hypnotisés par les beautés de son calme et de ses colères. Si le rêve de Jim est révolu et si celui de Jonathan ne fait que débuter, leur passion est la même, caractérisée par le besoin de partir loin de leur port d’attache, de s’évader vers un monde où personne ne les connaît mais surtout où ils sont confrontés à leur nature profonde. L’adolescent est élève d’une leçon que Jim a appris durant de longues années, leur périple est analogue, l’un débutant, l’autre vétéran des océans. Jonathan connaît tout des bateaux, de leur fonctionnement, de leur langage, de leurs légendes, mais il lui reste à apprendre de la mer la vérité la plus singulière, celle qui confronte les hommes à leur instinct de survie en plein typhon. Le marin a fait l’expérience de cette aventure, il a atteint le bout de sa destination intime, mais nostalgique, il se rappelle sur la plage des racines de sa vocation, comme un écho sonar d’un passé semblable au présent de l’enfant.
“Pour moi, la mer, c’était l’inconnu, comme l’espace profond. Si vous travaillez la terre, on accepte ses limites, ses frontières. On est enterré là où l’on est né. Quoi qu’il en soit, un jour, j’ai compris cela. J’ai su qu’il était temps de partir. C’était bien pendant un temps. […] La terre qui jamais ne change et la mer qui jamais n’est la même… Après avoir beaucoup navigué, on finit par sentir que l’on n’appartient à aucun endroit. J’ai senti cela pendant 16 ans.”
Jim
Le Marin qui abandonna la mer en appelle même aux mythes marins les plus abstraits, aux héritages de la grande littérature. Jim a son propre Moby Dick, sous l’évocation d’un requin qui l’obsède et qu’il poursuit à chaque voyage. Pourtant, l’animal n’est pas ici synonyme de péril, mais plutôt d’une expérience de la splendeur de la mer et de ses mystères, de son élégance et de son charme ensorcelant, obsédant, entêtant, inaltérable d’apparence et pourtant renié par le marin qui décide de rester à quai.

La parenté spirituelle entre les deux hommes au centre du récit permet dès lors de mieux accepter la naïveté candide de Jim et le détachement précoce de Jonathan. Le père de cœur devient lui-même adolescent à la recherche d’un amour de chair, tandis que l’enfant grandit trop vite, sans connaissance des valeurs qui font le socle d’une existence saine. Le sentimentalisme affirmé du Marin qui abandonna la mer est un instrument de mise en exergue de la déviance du protagoniste, car à deux personnages initialement nourris d’un même rêve, le film confronte l’impossibilité de l’enfant à concevoir le simple sentiment amoureux sous son jour le plus pur. Pour celui qui entend explorer dans le sang les mécanismes de la vie, l’affection n’est pas innée, elle est une grande inconnue, comme l’océan, mais qui l’invite à la peur plutôt qu’à la curiosité. La chaleur humaine ne fait pas partie intégrante de la vie de Jonathan, à tel point qu’il ignore l’intimité qui l’accompagne, elle est à l’inverse une férule sous laquelle plie son modèle. D’une inconvenance contenue, Jim se sédentarise par volonté de construire, là où son élève de cœur ne cesse de tendre vers une vie de nomade, quittant sans cesse le foyer familial. Le protagoniste n’est pas entièrement coupable de ses actes, même les plus sordides, puisque par les défaillances de sa mère, presque désinvolte, il a été rendu incapable d’aimer. À l’être privé de sentiments, il ne reste plus que le pragmatisme trivial et le rêve abstrait.
Pourtant, ce sont bien ces espoirs de jeunesse que mettent à mort Jonathan et ses amis dans les ultimes secondes du film, sous les coups de couteau d’un nouveau rituel sacrificiel, cette fois destiné à mettre davantage à nu les rouages de l’esprit que ceux du corps. Cérémonie macabre d’une jeunesse perdue, sinistre symphonie d’un océan qui divise l’écran, rejetant au bas l’image l’immondice et l’horreur la plus cruelle. Un homme agonise, mais sous ses traits, c’est tout un âge d’insouciance qui s’évanouit sur l’autel du sang. Juge et bourreau, une nouvelle génération met à mort l’ancienne pour lui faire payer le prix de son renoncement, et peut-être aussi pour la rendre comptable d’avoir accompli la pire des trahisons, se montrer douce quand Jonathan espérait voir un virilisme total. Le mâle alpha est mort, s’est transformé en animal de compagnie, sa fin est inéluctable et Le Marin qui abandonna la mer devient alors une douloureuse leçon écrite dans la rage, une offrande au dieu abyssal qui contemple dans le calme la fureur des hommes.

En bref :
La fougue de Yukio Mishima trouve un formidable écho formel dans Le Marin qui abandonna la mer, sordide poème marin sur une jeunesse négligée et cruelle.
Le Marin qui abandonna la mer est disponible en Blu-ray chez Carlotta Films, avec en bonus :
- Une bande annonce
- Un entretien de 25 minutes avec Stéphane du Mesnildot, essayiste et spécialiste du cinéma asiatique