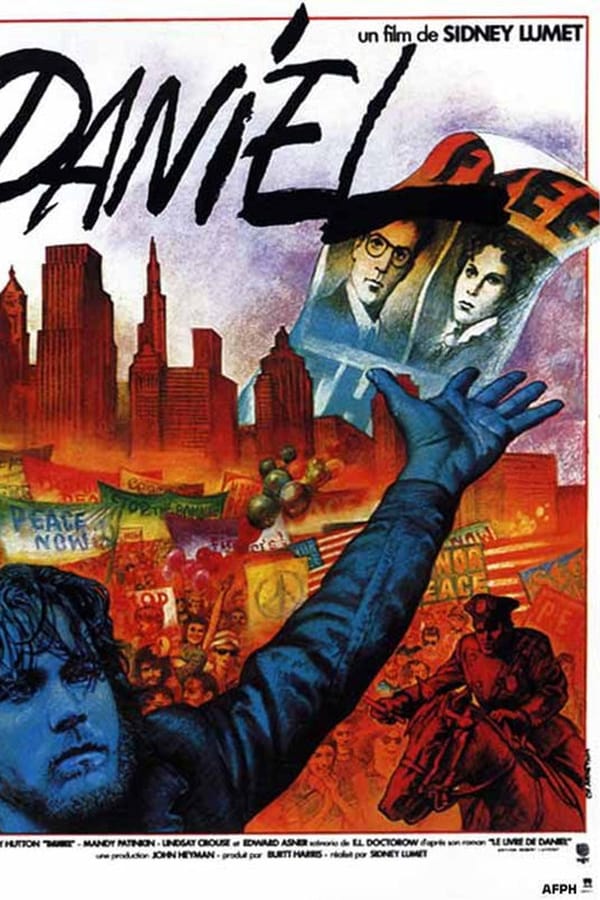
1983
Réalisé par: Sidney Lumet
Avec: Timothy Hutton, Mandy Patinkin, Lindsay Crouse
En 1950, le monde est en plein tourment alors que les USA et l’URSS se déchirent sur la scène internationale et scindent le globe en deux. La longue et mortifère Guerre Froide n’en est qu’à ses débuts, et pourtant, la défiance est déjà à son maximum. Sous l’impulsion du sénateur américain Joseph McCarthy, la traque des sympathisants communistes fait rage et de nombreux citoyens de son pays perdent leurs emplois pour des accointances hypothétiques. Il suffit parfois de simples présomptions pour que les vies basculent. La paranoïa ne s’arrête pas là et une obscure affaire d’espionnage marque les esprits la même année. Ethel et Julius Rosenberg, deux humbles résidents de New York, de confession juive, se voient accusés d’avoir fourni à l’URSS des informations essentielles ayant permis au bloc sovietique de développer sa propre arme atomique. Devant le peu d’éléments concrets étayant cette hypothèse, l’émoi international est vif, et la condamnation à mort des deux époux pour trahison révolte de nombreuses consciences. Si depuis, certains témoignages semblent valider la thèse des tribunaux américains, bien que dans une très maigre mesure, “L’affaire Rosenberg” reste un symbole de ces années de psychose.
Deux vies fauchées qui en ont entraîné d’autres dans leur chute, à commencer par celle de leurs deux enfants. C’est à eux que l’écrivain E.L. Doctorow consacre son ouvrage Le Livre de Daniel en 1971. Dans ce roman, l’auteur transforme la réalité et réécrit la petite et la grande Histoire. Les Rosenberg deviennent les Isaacson, et l’intrigue de son livre s’attarde davantage sur la trajectoire de Daniel, le fils des deux accusés. Devenu adulte, ce personnage se remémore ses souvenirs d’enfance, ponctués par les luttes de ses parents mais aussi par la tragédie qui les a frappés, tout en composant au présent du récit avec sa sœur Phyllis, plongée dans la folie par le traumatisme de son enfance.

Ce livre originel, dont est tiré le long métrage éponyme de Sidney Lumet, résonne indubitablement dans l’âme du cinéaste. Comme nous l’exposait Grey Pigeon dans sa courte pastille audio retraçant les jeunes années du réalisateur, la défense des opprimés du maccarthysme et la religion juive sont deux axes fondateurs de ce qui fera la substance de son cinéma. À plus forte raison, en 1950, Sidney Lumet a déjà 26 ans, habite New York, et l’affaire Rosenberg est fatalement un souvenir marquant de sa vie de jeune adulte. Pourtant, le metteur en scène fait preuve d’un respect total pour l’œuvre de E.L. Doctorow au moment de la transposer à l’écran. Le scénario du film est signé de la main même de l’écrivain et le montage final se fait sous sa supervision pour ne pas altérer l’histoire qu’il a voulu livrer, bien que Sidney Lumet possède le Final Cut du long métrage. Il en résulte un film bouleversant, incroyablement dense, et l’une des plus grande fierté du cinéaste.
Daniel se décompose en deux parties bien distinctes, qui ne se rejoignent, tant narrativement que visuellement ou idéologiquement, qu’en fin de film. D’un côté, les souvenirs de Daniel, de l’autre sa vie d’adulte, incarné par un convaincant Timothy Hutton. D’habitude plus investi par le fond que par la forme, ou tout du moins pas de manière outrancière, Sidney Lumet fait ici voler en éclats ce dogme en stylisant son film. Le passé prend des teintes sépias, tandis que le présent est dans une approche beaucoup plus réaliste. Une cassure initiale qui invite à se demander comment les événements de l’enfance ont pu affecter le présent, si différent dans sa représentation. Toute la logique de ce jeu de couleurs prend sens au fil de l’exploration de l’âme de Daniel, alors que le long métrage esquisse progressivement un effroyable trait d’union entre les deux couches du récit, jusqu’à les confondre. L’être humain se plaît à croire que le passé est une idée lointaine, floue et partiellement oubliée, qu’elle n’a plus d’emprise sur le quotidien qui est le nôtre, alors qu’un horrifiant cercle vicieux nous condamne à répéter les mêmes erreurs et à en subir les conséquences.

Pour naviguer dans cette grande fresque aux ramifications politiques complexes, le choix de E.L. Doctorow de nous proposer un enfant comme personnage principal apparaît judicieux. À l’instar de Daniel, le spectateur est ramené à la condition d’être apeuré par la folie des adultes et de leurs jeux de pouvoirs. Peu importe si certains élans historiques du film nous échappent, l’identification se fait par le biais d’un héros tout aussi perdu que nous le sommes et la volonté de Sidney Lumet est de nous faire éprouver une forme d’incompréhension volontaire. Pourtant Daniel est loin d’être idiot, les préceptes de ses parents l’habitent, mais rien ne saurait expliquer la violence institutionalisée. Ce qui se vit au passé se ressent au présent: le petit garçon est devenu un homme d’apparence froide, mécanique, dépourvu de flamme, avant de retrouver ses idéaux dans sa quête de vérité. Un chemin que Daniel ne saurait présenter comme universel: si le personnage central est vaillant et plein d’abnégation, sa sœur que joue Amanda Plummer est, elle, brisée à jamais, en proie à une démence palpable dès l’entame. Élévation et plongée aux enfers paraissent tout aussi probable pour ceux pris dans la tourmente, presque logiques.
La dissonance entre les leçons des adultes, et les événements qui les frappent, explique en grande partie cette dualité du film. L’éducation inculquée par les parents est remise en question: comment séparer leçons de vie, amour, et diatribes politiques, d’autant plus lorsque notre vie est consacrée aux combats de société ? Où placer la frontière entre épanouissement de l’enfant et transmission d’une idéologie ? La confusion règne dans Daniel alors que chaque moment d’affection revêt une signification sous-jacente perturbante. Dans une séquence où le jeune héros dialogue avec son père, Sidney Lumet joue d’une distance focale spécifique qui rend la scène un brin irréelle, comme un tendre souvenir. La position des acteurs, extrêmement proches, conforte ce sentiment. Pourtant dans le dialogue, le père se lance dans une longue litanie sur le mensonge de la publicité. De la même manière, la mère est interrogée: lors d’un autre moment de communion entre parent et enfant, le cinéaste surcadre les deux protagonistes, pour donner de la stature à son image, et propose même une étreinte. Pourtant Daniel accroche un bracelet au bras de sa mère, quelques secondes avant qu’elle ne soit menottée. Au-delà du cercle familial, les figures d’autorité usuelles se voient aussi étrangement floues, voire mouvantes. Les alliés d’hier sont les ennemis d’aujourd’hui, alors que le père de Daniel se félicite de l’union avec l’URSS durant la Seconde Guerre mondiale, avant que l’on n’en fasse des némésis de la démocratie. Pas plus de réconfort dans le domaine religieux, que les Isaacson renient presque totalement.

Encore plus loin dans l’analyse, Sidney Lumet nous confronte à l’image de martyrs de l’Histoire, et au bien fondé de leur mission. Le sacrifice, ultime en l’occurrence, a-t-il une raison d’être ? L’annihilation de la cellule familiale se justifie-t-elle si le bien commun en ressort vainqueur ? Deux enfants qui souffrent valent-ils le bien être de centaines d’hommes ? La réponse est impossible à trouver, nous plonge dans les tréfonds les plus obscurs de l’âme, et Daniel fait le judicieux choix de ne pas trancher ouvertement. Le résultat de cette terrible équation se niche dans une forme de folie: celle de la sœur de Daniel, de sa grand-mère, ou d’un ami des Isaacson. Tous en ressortent brisés: mourir pour une idée semble noble, mais cela en vaut-il la peine ? Plus loin encore, la fin justifie-t-elle les moyens ? Lorsque le long métrage dénonce l’instrumentalisation des enfants dans une scène iconique, alors qu’ils sont littéralement portés à bout de bras par la foule pour les exposer sur une scène, on éprouve un frisson primaire. Aucune cause n’est totalement juste, et Daniel s’ouvre et se ferme d’ailleurs sur un monologue du personnage principal qui tisse un parallèle glaçant entre USA et URSS.
La mort plane d’ailleurs en permanence sur le film: on connait le destin tragique des Rosenberg, on devine en conséquence celui des Isaacson, et le film le confirme explicitement dès ses premières secondes. Au delà du plaidoyer anti-peine de mort assez vif que nous propose Sidney Lumet, c’est sa réflexion sur le système judiciaire qui interpelé. Juste après Le Verdict et sa vision désabusée du système, le cinéaste semble vouloir enfoncer le clou. Les tribunaux sont corrompus, jugent d’après des précédents sans cohérence avec l’affaire traitée, condamnent pour des idées, sans preuve, et les avocats de la défense sont impuissants. Il apparaît clair que le Sidney Lumet des années 80 n’est plus celui de 12 hommes en colère, ses illusions ont presque totalement disparu. Si la note finale de Daniel convoque un peu d’optimisme quant à la vertue d’une vie de lutte, la scène clé du film est davantage au milieu de l’œuvre. Alors que Daniel rend visite à ses parents en prison, l’image d’un pénitencier où les détenus sont au bout de leur vie saute aux yeux, avec même une vague impression de camps de concentration lorsqu’on découvre la mère du héros, les cheveux rasés et amaigrie. Sidney Lumet le démontre par l’image: c’est à ce moment-là que les teintes sépias des flash back disparaissent. Daniel n’est plus un enfant, cette confrontation l’a transformé, a fait de lui un homme, certes, mais à jamais marqué par son passé.

Densité, gravité, précision… Sidney Lumet signe un film d’une richesse démente avec Daniel, entre petite et grande Histoire.
Daniel est désormais disponible en édition Blu-ray/DVD chez Spectrum Films



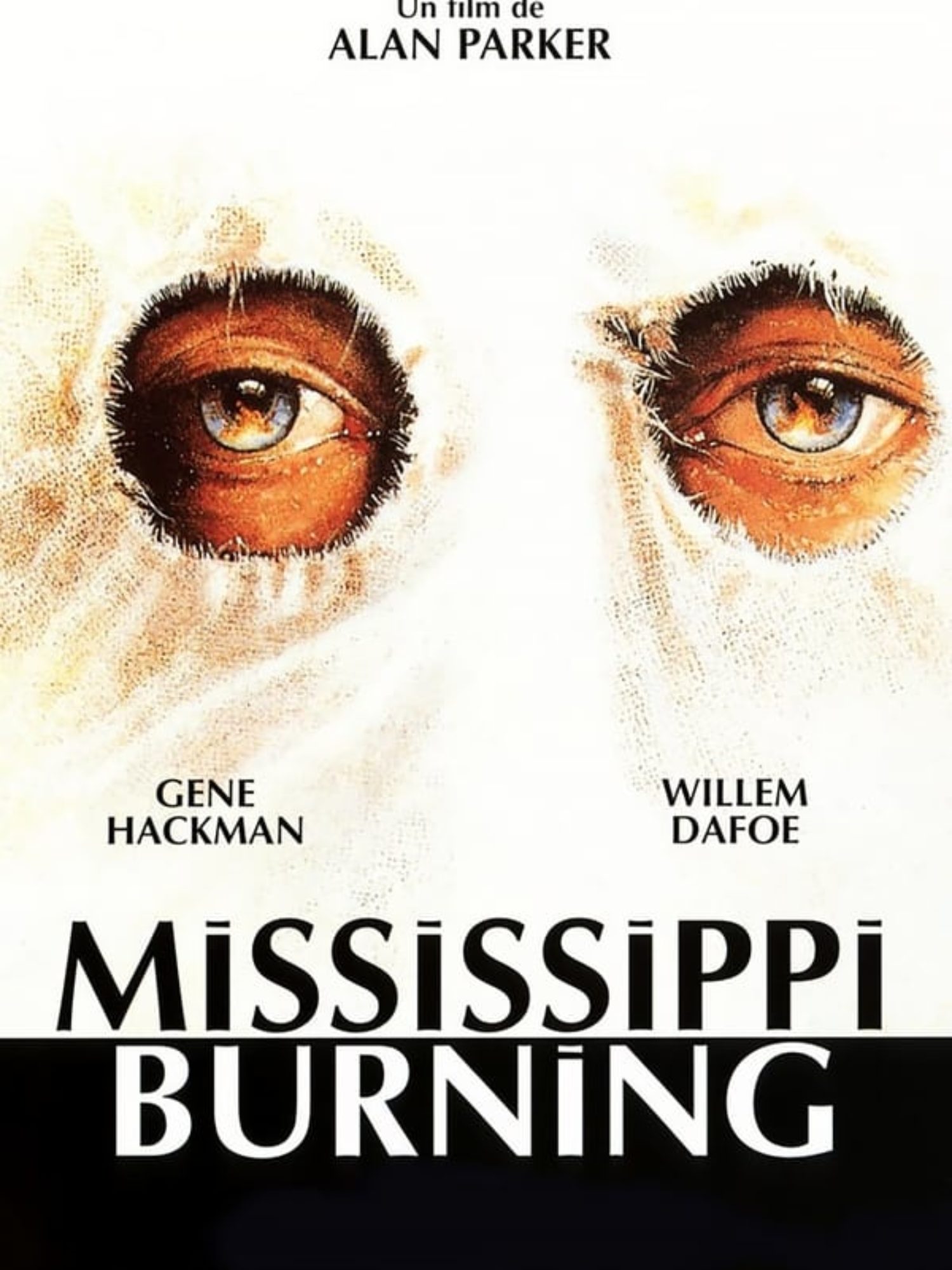


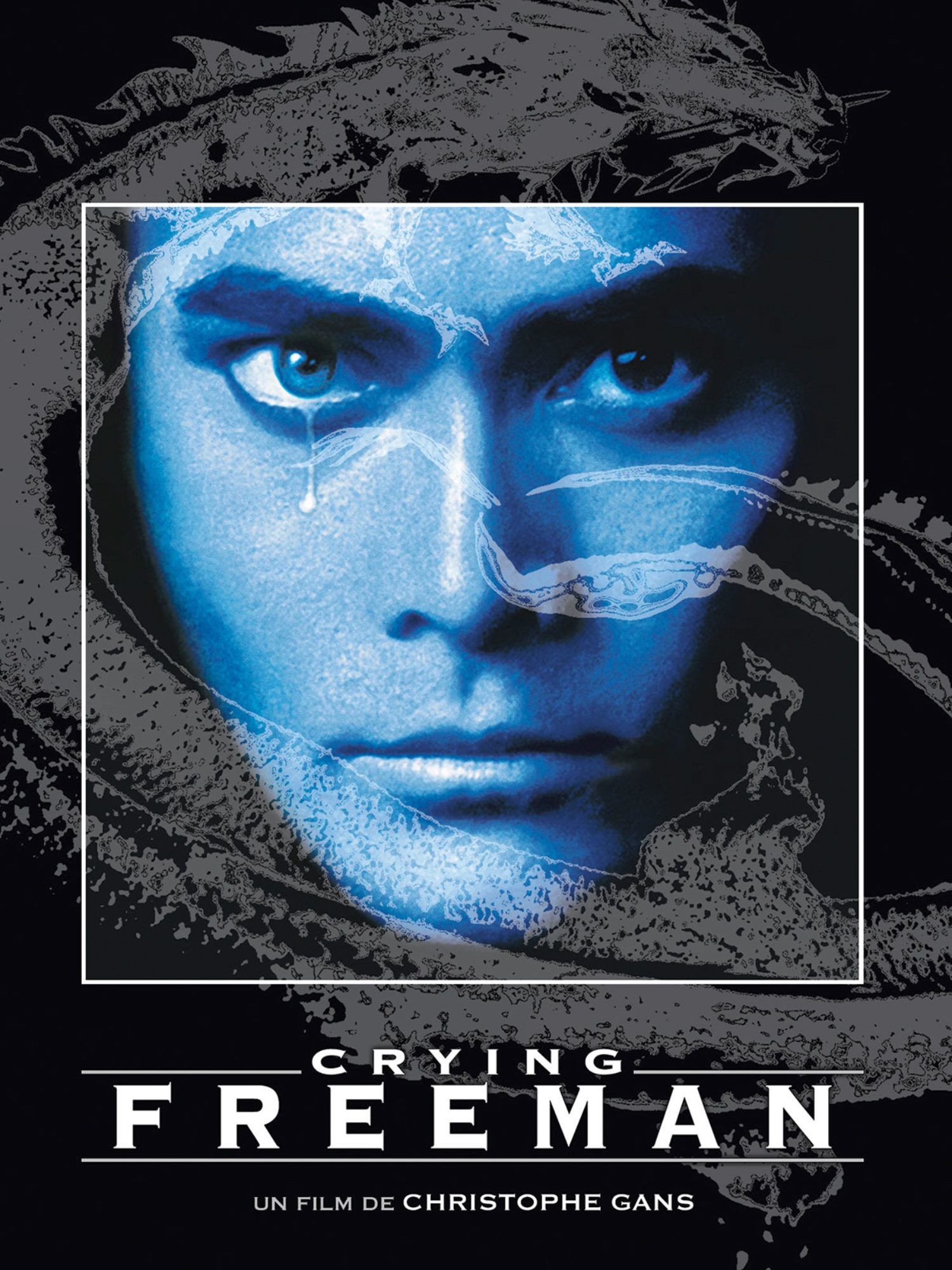
Ping : Family Business - Les Réfracteurs