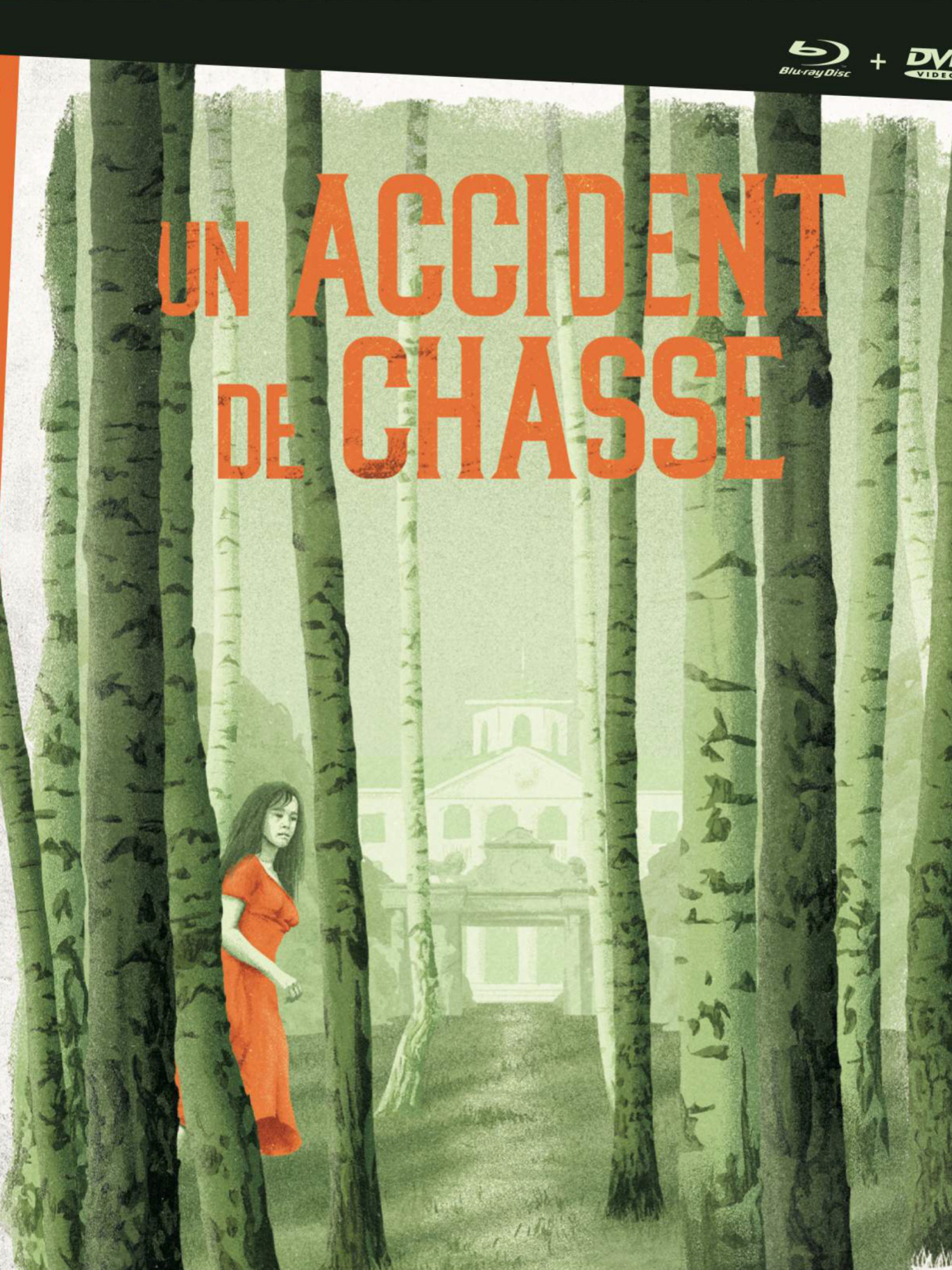(An American in Paris)
1951
réalisé par: Vincente Minnelli
avec: Gene Kelly, Leslie Caron, Oscar Levant
La comédie musicale a cela de particulier qu’elle fait la synthèse de trois langages artistiques différents: le talent d’acteur, la musique et la danse. C’est un équilibre presque savant qu’il faut savoir trouver pour ne pas tomber dans la facilité ou dans la mièvrerie. Heureusement, il y a quelques phares dans la nuit pour guider les jeunes cinéastes. Cocorico, évoquons par exemple Jacques Demy, avec “Les demoiselles de Rochefort” ou “Les parapluies de Cherbourg” dans un coin de notre tête. Mais qui mieux que Gene Kelly a su chorégraphier et interpréter autant d’oeuvres différentes, conjuguant à chaque opportunité comédie orale et langage corporel avec brio? Probablement personne et on prend pour exemple aujourd’hui “Un américain à Paris”.
L’histoire de Jerry Mulligan (Gene Kelly donc), un peintre sans le sou vivant dans les quartiers abordables de Paris, tout proche de son ami pianiste Adam Cook (Oscar Levant). Au détour d’une rencontre, une riche femme divorcée, Milo Roberts (Nina Foch), va lui proposer d’acheter ses toiles et de l’entretenir en espérant s’attirer ses faveurs. Mais le hasard va placer sur la route de Jerry une jeune vendeuse de parfum, Lise Bouvier (Leslie Caron), et un amour d’une intensité éblouissante mais complexe va naître entre les deux jeunes gens.
Dans une émulation artistique totale, le film va convoquer autour de lui des savoir-faires parfois cousins mais différent avec un certain talent: Gene Kelly et Leslie Caron envoûtent par leurs pas de danse ensorcelants, Oscar Levant impose sa maestria de pianiste prodige, Georges Guétary propose une technique vocale parfaite dans les chansons qu’il interprète avec toujours beaucoup d’entrain. Même l’art pictural trouve écho à la fois dans les toiles de Jerry Mulligan mais également dans les décors de studio soigneusement travaillés et dans les scènes d’un onirisme visuel pur. “Un américain à Paris”, c’est une explosion de talent, un feu d’artifice où chaque nouvel élan créatif émerveille un peu plus un spectateur redevenu enfant dans son plaisir de cinéphile.
Le film offre une vision très fantasmée de notre capitale, où Montmartre n’est qu’à un pas de la place de la Concorde. Une reconstitution de studio ostensiblement factice mais qui séduit pourtant. L’art du coup de pinceau et de l’agencement de toiles de fond conjugués à une science de l’éclairage et au rendu des couleurs de l’époque (dans sa version colorisé tout du moins) donne un aspect magique au film, presque comme si nous étions propulsés dans les tableaux de Jerry Mulligan. Il existe dans le long-métrage une symbiose rare entre le scénario et les décors qui suffit à admettre ce qui nous semble incohérent: on oublie et on vit ce moment de cinéma dans tout ce qu’il propose d’enchanteur, même pour les plus parisiens d’entre nous. On se rappelle même tout d’un coup ce qui nous fait aimer notre métropole comme au premier jour d’une idylle éternelle.

« Bon, ça va la frime là! »
Des claquettes jusqu’au bout des doigts, Gene Kelly transcende son art. Virtuose virevoltant, funambule infatigable, magicien du déhanché, il transforme un personnage légèrement irascible dans la comédie en véritable être émouvant, ouvrant une fenêtre sur son coeur à chaque passage dansé. Parlez de leçon impliquerait que l’acteur peut être imité alors qu’à l’évidence, il n’y aura jamais deux Gene Kelly et c’est ce qui rend le comédien si attachant. Son sens du rythme se retrouve même dans son jeu d’acteur pur et dur, dans ses mimiques si expressives sans jamais paraître incongrues.
Pour répondre aux ondulations de Jerry Mulligan, la caméra se fait fluide, pleine de mouvements dans des plans allongés où le cadre glisse en même temps que le danseur. Il y a dans le montage d’“Un américain à Paris” la volonté indéniable de minimiser au possible les coupures. Une réalisation au service de la danse qui ne la contrarie jamais, se faisant simplement témoin privilégié des chorégraphies somptueuses de Gene Kelly. Un procédé qui trouve sa quintessence lorsque le cadre s’élève pour capturer l’ensemble des figurants ponctuant des ballets réglés comme du papier à musique.
Car Gene Kelly et Leslie Caron ne sont pas les seuls protagonistes sujets aux chorégraphies. À mesure que le film avance, le cinéaste Vincente Minnelli va impliquer de plus en plus de personnages. D’abord simples figurants, puis joyeux fêtards et finalement véritables danseurs, cette foule massive et opaque est de plus en plus présente dans la mise en scène, occupant de manière très onirique sa place dans un final typique de l’époque mais qui n’a rien perdu de sa superbe. La conclusion d’“Un américain à Paris” est un modèle, une forme de finalité ultime vers laquelle tendent encore aujourd’hui les comédies musicales, “La La Land” en tête qui s’inspire de cette exaltation artistique.
Toutefois, la place de la femme interpelle. Le personnage de Leslie Caron souffrirait-il du syndrome de la pauvre princesse attendant son preux chevalier? Aucun doute dans certaines scènes qui rappelleraient presque Cendrillon. “Un américain à Paris” est un témoignage d’une époque heureusement révolue qui permet de remettre en perspective les progrès accomplis depuis et ceux qu’il reste à faire pour parvenir à une plus grande parité. Toutefois, artistiquement la danseuse n’a rien à envier à Gene Kelly: sa formation plus classique offre une facette supplémentaire au film, ne se contentant pas d’imiter le chorégraphe mais apportant plutôt une autre dimension au film dès l’introduction du personnage.
« Un américain à Paris » n’est pas dépourvu de message pour autant. Le scénariste Alan Jay Lerner offre un fond de réflexion assez prenant autour du mécénat et de la place de l’argent dans le domaine artistique. Jerry Mulligan est presque esclave du bon vouloir de Milo Roberts qui finance ses travaux. Une relation faite de devoir plus que d’affect. En achetant les œuvres du peintre, cette femme bien plus affirmée pense capturer un morceau de son cœur alors que chaque toile vendue est en faite une partie de l’âme de Jerry qui s’évapore. Le film va l’énoncer assez clairement dès les premières minutes: “Un écrivain ou un compositeur peut acheter une copie de son travail alors qu’un peintre dit adieu à jamais à ses tableaux”. Un dilemme qui servira également de moteur à l’intrigue amoureuse du film.

Classique intemporel, “Un américain à Paris” semble parfois se bonifier avec l’âge malgré quelques outrages incontournables du temps. Une explosion artistique pluridisciplinaire qui enchante à chaque instant grâce à sa conjugaison de talents.