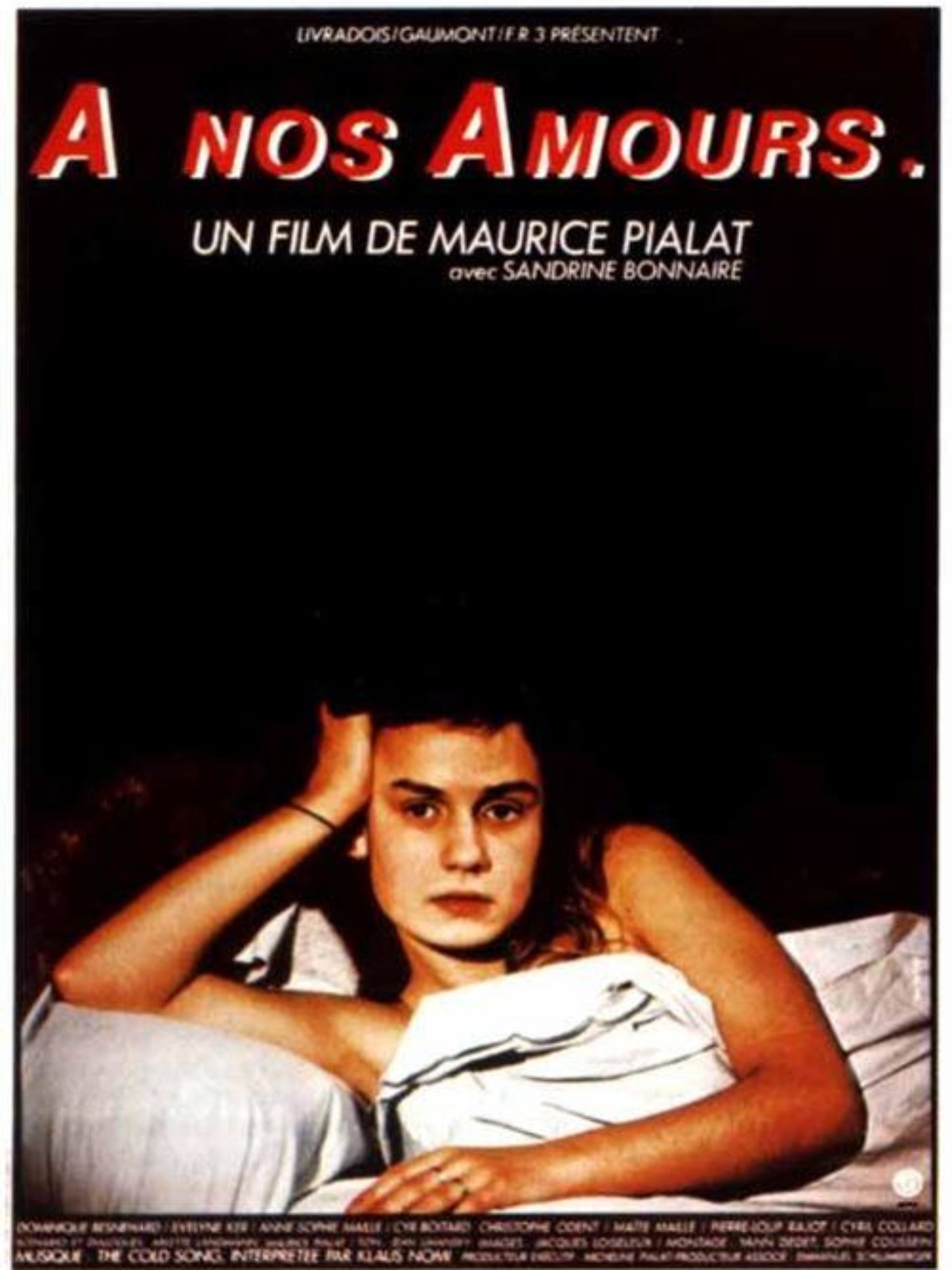(東京フィスト)
1995
Réalisé par : Shinya Tsukamoto
Avec : Shinya Tsukamoto, Kaori Fujii, Kôji Tsukamoto
Film fourni par Carlotta Films et présent dans le coffret Shinya Tsukamoto en 10 films
Après l’âge de métal, place à l’ère de la chair pour le réalisateur Shinya Tsukamoto, qui se réinvente à l’occasion de son quatrième long métrage, Tokyo Fist. Jusqu’alors érigé en chantre de la science-fiction et de la contre-culture japonaise après le succès de Tetsuo, et trois ans après en avoir offert une version plus accessible et adoucie avec Tetsuo II : Body Hammer, l’auteur bouleverse sa grammaire cinématographique pour s’affranchir de l’acier et épouser la détresse de corps en quête de souffrance. Observateur soucieux de la déshumanisation des citadins nippons soumis à des cadences infernales et privés de leur épanouissement personnel, le metteur en scène prolonge son étude acerbe des maux qui frappent les tokyoïtes et du désespoir latent qui s’empare de la capitale. Noyé dans le flot incessant des artères grouillantes de monde, l’être perd son individualité et sa spiritualité, entre les tours de béton qui obstruent le ciel. Les premiers films de Shinya Tsukamoto forment ainsi un corpus disparate autour de la ville sans repos et de ses habitants aliénés par les codes rigoureux d’une société austère. Avec Tokyo Fist, le cinéaste offre une nouvelle variation sanglante et violente autour de ce thème fondateur de son œuvre, faisant paradoxalement de la douleur un idéal pour des personnages en perdition. Les hématomes deviennent une preuve improbable de leur existence, les coups portés et reçus construisent leur psyché autant qu’il la détruise.
Tokyo Fist marque le retour à un cadre créatif plus intime pour Shinya Tsukamoto. Après avoir tenté de fédérer une large équipe autour de ses deux projets précédents, l’artiste renoue avec le confort qu’il affectionne du travail en nombre restreint. Sur tous les fronts, l’auteur griffe la pellicule de son empreinte et affirme un contrôle absolu sur son œuvre en épousant les rôles de réalisateur, acteur principal, monteur et producteur. Chaque film de Shinya Tsukamoto est l’expression déjantée d’une part profonde de ses angoisses et de ses obsessions. Néanmoins, Tokyo Fist apparaît comme l’apogée de cette démarche. En jouant le rôle d’un banal employé, esclave de sa tâche, le metteur en scène convoque le souvenir douloureux de son propre passé d’homme d’affaire, lorsque durant quelques mois il avait réprimé son expression artistique pour se fondre dans le moule sociétal japonais. Selon l’artiste, Tokyo est une ville à la frénésie glaciale, qui accueille dans ses trains les âmes en peine sur le chemin de l’abandon de soi. Le monde de la boxe qui sert de toile à la fresque sanglante est également un univers familier du cinéaste. Son frère cadet est depuis longtemps adepte du noble art et il enfile les gants pour camper l’antagoniste du récit, donnant ainsi corps à une sauvagerie irrépressible qui charme insidieusement le héros du film et son épouse. La séduction de la bestialité s’empare lentement des esprits égarés.

Salarié d’une compagnie d’assurance, Tsuda (Shinya Tsukamoto) mène une existence convenue et sans passion, articulée autour de son travail ingrat et de sa vie de couple routinière. Lorsqu’il croise la route de Kojima (Kôji Tsukamoto), un ancien ami devenu boxeur, un jeu pervers et violent s’instaure entre les deux hommes. Kojima jette immédiatement son dévolu sur Hizuru (Kaori Fujii), l’épouse de Tsuda, et subjugue la jeune femme de sa férocité. Pour reconquérir sa fiancé, le timide employé s’inscrit dans le club de boxe de son adversaire dans l’espoir de le terrasser sur son propre terrain, découvrant par la même occasion sa fureur réprimée jusqu’alors. Pris dans la spirale de la haine, Tsuda et Kojima se livrent une guerre vicieuse, virile et sanglante, sur le ring et en dehors. Spectatrice impuissante des conflits, Hizuru violente son corps pour partager l’expérience des hommes qui gravitent autour d’elle et qui se prouvent qu’ils existent par la souffrance.
Pris dans l’étau bleu acier d’un Tokyo privé de toute identité, les hommes errent sans but dans la ville de tous les supplices. La cité a dévoré l’individu, dicte le quotidien selon l’effroyable rythme des métros qui sillonnent les veines de la métropole et que Tokyo Fist représente régulièrement à l’écran. Reprenant une habitude visuelle récurrente dans le cinéma de Shinya Tsukamoto, les protagonistes apparaissent souvent immobiles au milieu du flot incessant des foules, ils ont interrompu leur marche robotique pour contempler leur propre déchéance, seuls au milieu d’un collectif lancé dans une course ininterrompue et sans but. Selon les mots du réalisateur, Tokyo est devenue une “ville virtuelle” où s’est perdu le contact humain. Le ring de boxe est l’unique lieu de réunion des êtres assoiffés de dialogue, les crochets et les uppercuts forment leur nouveau langage de sang et de sueur, filmé à l’aide d’une seule caméra et à travers des mouvements sauvages et frénétiques. Le Japon hurle sa rage de vivre, il s’autodétruit pour se prouver qu’il est encore vivant. En excursion dans les rues désertées de la ville, les personnages de Tokyo Fist explorent l’envers du décor tokyoïte au fil de leur odyssée intime aux confins de la folie, à mesure qu’ils se découvrent. Ils se sont affranchis de l’archétype sociétal rigoriste, et tels de nouveaux Orphée, ils plongent dans les profondeurs de la capitale, ils quittent les hauts immeubles pour investir les ruelles sales, les quartiers dépeuplés, puis finalement les souterrains et les égouts, à la recherche éperdue d’un idéal abstrait. Les forçats du Japon moderne ont pris conscience de leurs chaînes et s’efforcent de s’en défaire.

La pulsion physique brutale est un échappatoire à l’extrême glaciation des rapports affectifs qui marque l’entame du récit. Esclave d’un travail absurde qu’il accomplit symboliquement sous une chaleur accablante, tyran implicite d’une romance de circonstance, Tsuda tente initialement de prouver sa virilité en imposant son joug moral à Hizuru. Le patriarcat ancestral comme héritage, l’homme chétif contraint la femme en quête d’émancipation, lui interdit l’expression timide de sa sensualité, exposée à travers une photographie pourtant innocente de l’épouse en maillot de bain mais qui devient prétexte à la discorde. Première victime du récit, Hizuru ne possède même pas sa liberté de corps, et la robe blanche qui lui a été offerte par Tsuda apparaît comme son uniforme de prisonnière sociale, le symbole de son aliénation de femme au foyer dont elle pense se défaire en succombant aux charmes féroces de Kojima, mais qui est voué à ressurgir lorsque son amant lui impose les mêmes rêgles détestables que son époux. Face à une retransmission du Metropolis de Fritz Lang, les êtres devenus robots de Tokyo Fist font face à l’entité synthétique éprise d’humanité du cinéaste allemand, créant ainsi une étrange symétrie à l’intérieur du film, avant qu’ils ne se réapproprient la chair pour revendiquer leur individualité. Tsuda et Kojima sont opposés sur le ring, et semblent de prime abord être deux pôles parfaitement opposés d’un Tokyo aux multiples visages. L’un résident des beaux quartiers, l’autre habitant des lotissements vétustes étrangement attenants. Pourtant le film ne cesse jamais de les confondre, pour en faire deux faces d’une même pièce. En parfaite contradiction volontaire avec leur affrontement farouche pour le coeur d’Hizuru, les adversaires tendent à se réunir idéologiquement. L’employé médiocre découvre la séduction de la violence, tandis que l’antagoniste du film domestique progressivement la bête qui sommeille en lui pour s’ériger en nouvel oppresseur sentimental de son foyer décadent. Entre fureur et conformité, Tsuda et Kojima sont finalement unis par l’évocation d’un passé commun et ils apparaissent à tour de rôle seuls face à un miroir, dans deux scènes rigoureusement analogues qui achèvent de les confondre.
Rappelés à la fureur, les protagonistes s’abandonnent à leur instinct animal. Ils quittent progressivement le cadre déshumanisé de la société nipponne pour faire de leur rage une expression désespérée de leur personnalité. Dans une succession de plans exposant les corps en transe et les muscles bandés à l’extrême, Tokyo Fist incendie la pellicule. En reproduisant un effet de volutes de flammes autour des ses personnages, le film devient incandescent et explosif. Pris dans la chaleur de l’image qui tranche subrepticement avec la froideur de Tokyo, Kojima n’est plus que pulsion de mort et de souffrance, il devient un nouvel être pernicieux, fait de chair en sueur qui fait d’Hizuru sa première disciple avant de convertir Tsuda à ses préceptes sanglants. Jusque là condamnée à vivre dans l’apparat et à se plier aux diktats sociétaux, la jeune femme cède face à l’ermegence du nouvel homme, dont chaque mot est un râle bestial, tandis que son époux est démoli et reconstruit par ses coups. Le monde convenu s’effondre face à la tentation prédatrice de la destruction et l’embrasement esthétique du film s’empare à terme irrémédiablement d’Hizuru et de Tsuda. Le virus de la sauvagerie venu des bas-fonds de la capitale infiltre le Japon des parvenus, pour poser les bases d’une nouvelle humanité, revenue à un stade primaire de son évolution. Tokyo Fist se différencie ainsi ostensiblement du diptyque Tetsuo, en renonçant cette fois à la mécanisation pour poser les bases d’un futur où prime l’animalité. Pourtant le film s’inscrit dans la continuité du travail de Shinya Tsukamoto, qui se fait à nouveau le témoin de l’écroulement d’une société dépourvue de spiritualité, cette fois dans un cadre beaucoup plus intime, pour contempler le lent avènement d’un monde métamorphosé. La martialité des pensionnaires du club de boxe de Kojima, montrés portant des coups dans le vide sur une musique métallique, rappelle à ce titre les bodybuilders désincarnés de Tetsuo II : Body Hammer, qui révéraient le nouveau dieu de métal. Les pugilistes forment un seul corps, mus par un même appétit enragé. Tokyo Fist désacralise également le noble art, en le privant de son prestige pour ériger le club de gym et les salles de combat en véritables arènes romaines ressuscitées, des espaces perdus dans la société nipponne codifiée, où l’expression violente de la haine et l’exacerbation de la colère sont permises. Défini par son sport, Kojima est ainsi incité par son entraîneur particulier à en trahir les règles, en glissant des coups de coudes discrets à son adversaire. Invité à combattre lors d’un match supposé sans contact, Tsuda laisse quant à lui exploser sa fureur en agressant sauvagement son adversaire. Le ring est le lieu où culminent les tensions du récit, là où les faibles sont éradiqués et où les fauves triomphent, l’espace où se découvre l’impulsion meurtrière. Davantage qu’un sport, la boxe est la grammaire d’un dialogue humain tempétueux, transmise sans le vouloir à Hizuru, novice du langage brutal de Kojima qui roue de coup de poing son fiancé lors de leur réunion.

Néanmoins, les protagonistes de Tokyo Fist se prouvent qu’ils sont encore vivants à travers le culte de la douleur. Si au terme des affrontements attendus, un vainqueur et un vaincu doivent être proclamés, les pugilistes sont avant tout définis par les efforts consentis pour parvenir à transformer le corps en arme, mais surtout par la glorification de la souffrance ressentie au cours des entraînements. Face à un monde anesthésié par la routine, les hématomes de Tsuda et Kojima attestent de leur existence. Encore capables d’être mis à terre, il en sont dès lors vivants, aptes à ressentir les blessures alors que toute autre forme d’émotion les a quittés. Exclue du monde de la boxe de par son sexe qui lui interdit la pratique de ce sport à l’époque de la sortie du film, Hizuru s’automutile pour faire elle aussi l’expérience de cette douce affliction qui lui permet de se démontrer à elle-même qu’elle n’est pas une simple entité sans âme noyée dans le grand collectif tokyoïte, mais bien une individualité légitime. Sans conteste le personnage féminin le plus fouillé de la carrière de Shinya Tsukamoto jusqu’alors, au point de devenir lentement personnage principal du film, elle est à la base de la pyramide de l’oppression sociétale, et dès lors celle qui a besoin de dégrader son corps le plus intensément pour renouer avec le frisson de la vie. Chacune de ses scarifications est une nouvelle pulsion primaire propre à une ostracisé à qui on renie le droit à l’expression, et qui parvient ainsi à s’émanciper. Brièvement, elle abandonne ses gestes mortifères pour se plier au désidérata de Kojima qui tente de la domestiquer, mais attirée par les sirènes du vice primordial, elle sacrifie son corps à la noirceur de la douleur. Tokyo Fist conjugue cette insurrection charnelle avec la représentation froide d’un Tokyo où la mort n’est plus synonyme de souffrance. Dans la chambre froide de son hôpital, le père de Tsuda dépérit lentement, rendu amorphe sous les perfusions d’antidouleurs qui font de sa mort l’ultime étape d’une vie aseptisée. Pourtant dans les ruelles de la capitale se cache encore la chair en décomposition, perçue rapidement à travers l’apparition du cadavre pourrissant d’un chat rongé par les vers, qui révulse Tsuda avant que la dépouille ne disparaisse mystérieusement lorsque le protagoniste de Tokyo Fist souhaite la contempler à nouveau. Le Japon avale et digère le supplice, mais un monde endormi se réveille et fait trembler l’image dans de très brèves séquences où la rage sismique de Shinya Tsukamoto fait tressaillir la cité. Sous le maquillage de béton et de métal, la colère réprimée gronde. Dans le maelstrom émotionnel d’une humanité qui éprouve “le besoin de se retrouver”, selon les mots du cinéaste, les instincts primaires sont confondus, et la lubricité évolue de concert avec la déliquescence des corps. Amour et mise à l’épreuve de l’enveloppe charnelle fusionnent dans un ballet sordide et vicieux. Hizuru ne peut pas s’ébattre avec Kojima sans que celui ci n’offre un préambule au sexe en tirant sur l’un de ses piercings pour la faire souffrir, et la jeune femme ne peut pas retrouver la candeur de son union précédente avec Tsuda sans que les deux anciens époux ne se molestent sauvagement, avant d’illustrer leur connivence retrouvée en confrontant deux tatouages analogues, synonymes de désacralisation du corps par le passé. Le trio improbable est cimenté à parts égales par l’affection déviante et la mise au supplice de leur être. Au terme de l’aventure, tous seront sacrifiés, les insurgés de chair deviendront infirme de corps ou d’esprit. Face à des spectateurs venus se repaître de la vue du sang, Kojima sacrifie son visage jusqu’alors immaculé. Absorbée par les ténèbres de la nuit, Hizuru disparaît dans une explosion de sang qui ressuscite le souvenir traumatique de l’innocence perdue de ses deux amants, sur le même lieu. Devenu borgne comme son entraîneur, Tsuda devient le dernier dépositaire de l’esprit de la boxe, une sorte d’Odin réinventé après le Ragnarok des âmes en perdition.

Fresque fascinante sur la déshumanisation moderne et l’abandon du corps, Tokyo Fist est une œuvre vertigineuse de densité et de fougue formelle. Un immanquable du coffret Shinya Tsukamoto en 10 films.
Tokyo Fist est disponible en Blu-ray chez Carlotta Films, dans le coffret Shinya Tsukamoto en 10 films, contenant :
- Les Aventures de Denchu Kozo
- Tetsuo
- Tetsuo II : Body Hammer
- Tokyo Fist
- Bullet Ballet
- A Snake Of June
- Vital
- Haze
- Kotoko
- Killing
Et avec en bonus :
- un livret de 80 pages signé Julien Sévéon, journaliste spécialiste du cinéma d’Extrême-Orient
- 4 présentations de films par Jean-Pierre Dionnet : Tetsuo – Tetsuo II : Body Hammer – Tokyo Fist – Bullet Ballet
- « Une agression des sens » : Une analyse du style Tsukamoto par Jasper Sharp, spécialiste du cinéma japonais (16 mn – HD)
- 10 entretiens d’archives avec Shinya Tsukamoto, dont un dirigé par Jean-Pierre Dionnet
- 5 documentaires / Making-of sur le tournag des films : Tetsuo II : Body Hammer – A Snake of June – Vital – Haze
- “Le grand provocateur du cinéma japonais : Shinya Tsukamoto” (48 mn – HD)
- 10 Bandes-annonces originales