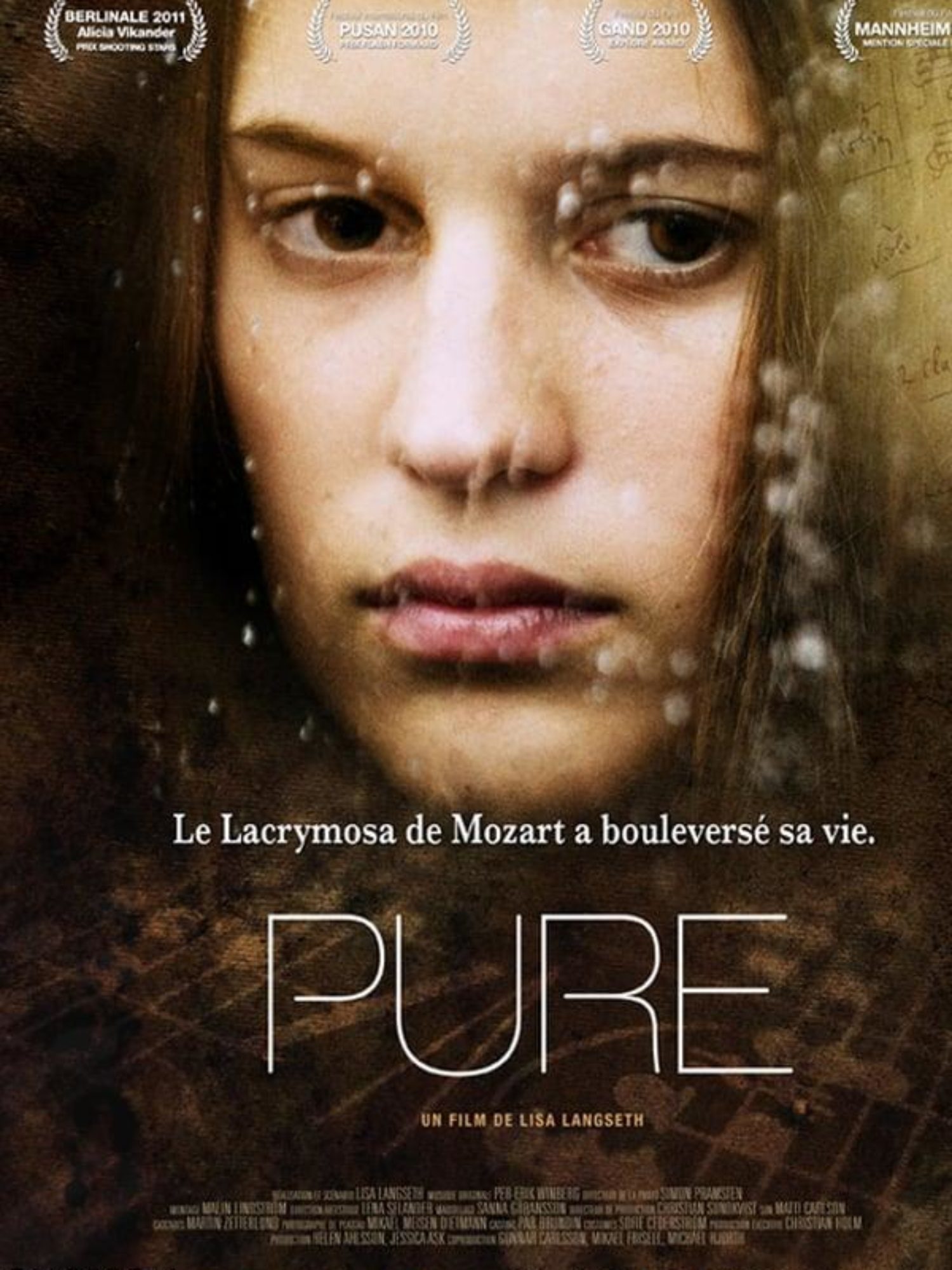(Hell Drivers)
1957
Réalisé par: Cy Endfield
Avec: Stanley Baker, Patrick McGoohan, Peggy Cummins
Tôt ou tard, toutes les formes d’art finissent par mettre en perspective les inégalités de notre monde. Il existe un lien fort entre l’artiste et les opprimés, comme si la création servait de voix à ceux qu’on musèle au quotidien. Bien sûr, on ne peut pas coller cette étiquette à toutes les œuvres, certaines préférant jouer la carte du divertissement léger avec parfois du talent, mais offrir une image de notre société dans ce qu’elle a de plus inhumain est une mission essentielle pour tendre vers le progrès. Le cinéma ne déroge pas à cette règle et semble même épouser ce besoin d’évolution intensément: tout au long du 20ème siècle et encore aujourd’hui, le 7ème art a tenté de saisir le désarroi des plus démunis et a contraint ceux qui détournent usuellement le regard à faire face aux réalités les plus immondes. Cinéma politique diront certains et on ne peut pas totalement le nier, mais le qualificatif “humaniste” nous semble personnellement plus adéquat. Une noble lignée dans laquelle va s’inscrire parfaitement “Train d’enfer” de Cy Endfield, véritable portrait au vitriol de son époque.
Dans sa proposition filmique, le réalisateur, également coscénariste en compagnie de John Kruse, nous propose de suivre le quotidien de routiers contraints d’effectuer inlassablement le même trajet, parfois au péril de leur vie, pour transporter du ballast à une cadence infernale imposée vicieusement par le patronat en échange d’un salaire de misère. Dans l’entreprise, l’ordre est solidement établi et le chef de file de ces camionneurs, Red (Patrick McGoohan) règne en véritable despote des routes. Ce statu quo va toutefois être bouleversé par l’arrivée d’un nouveau conducteur, Tom (Stanley Baker), qui entend ne pas se laisser faire par cette déviante hégémonie.
C’est donc la trajectoire d’une sorte de héros de la classe ouvrière qui défile à l’écran, mais sur un rythme subtil. “Train d’enfer” ne matraque pas son message, il laisse le spectateur cheminer librement vers des conclusions presque naturelles. Pour y parvenir, Cy Endfield choisit de ne pas clairement délimiter son personnage principal dans la partie initiale du récit. Tom serait presque une page blanche, comme si le cinéaste voulait favoriser l’identification du spectateur à ce protagoniste. Le mystère l’entoure: ses origines? Inconnues de prime abord. Son passé? Probablement un mensonge. Son ambition? Simplement celle de gagner sa vie comme chacun d’entre nous. C’est seulement une fois ce lien créé avec le public que l’auteur va creuser un peu plus le parcours de Tom, lui offrir une dimension dramatique supplémentaire et des motivations autres. Cy Endfield à besoin de proposer son héros comme l’un des seuls hommes droits de son récit avant de construire dessus, comme pour révéler un ordre moral défaillant.

« Interdit de Pepsi. »
On lui oppose d’abord l’image d’un patron retranché derrière son bureau, loin du quotidien des travailleurs. Un homme froid, distant, exigeant et malhonnête, un tyran qui impose des cadences de travail proches de l’esclavagisme. Un personnage presque cloisonné dans le scénario, qui délègue le plus possible à sa secrétaire servant presque de sas de sécurité pour ne pas affronter les revendications sociales. Cet unique rôle féminin, c’est Peggy Cumminns qui va le camper, proposant une image presque de pin-up en chemise à carreau et en Blue Jeans. Une sorte de fantasme pour tous ces travailleurs au sein desquels on aperçoit un Sean Connery débutant.
C’est une véritable meute que forment les routiers sous la houlette de Red, grand orchestrateur de la cruauté. On se surprend à avoir en tête l’image de bandits de grands chemins du temps du Far West, menés par un leader horriblement patibulaire et despotique. Les chevaux sont devenus des camions, les chemins de terre sont désormais goudronnés mais il existe dans cette esprit de bande un brin hostile une véritable parenté avec le western. Red s’impose comme le mâle alpha d’un groupe qui répond à la froideur du métal des camions par la chaleur humaine imposée par leur promiscuité mais toujours avec une hostilité débordante pour Tom. Ils marginalisent ce nouveau venu, le bizutent et seul un unique personnage, Gino, va faire preuve de bienveillance. Une gentillesse presque erronée dans ce contexte étouffant.
Ces hommes ne se rendent même pas compte de la machination dans laquelle ils sont plongés. C’est au bâton et à la carotte qu’ils sont menés, souffrant d’un côté de l’autorité de Red, aspirant d’un autre côté à mettre la main sur un étui en or massif promis à celui qui accomplira le plus de trajets en une journée de travail. Un prix solidement acquis au cruel leader qui encourage la prise de risque déraisonnée de ses pairs. Cette image on peut aisément la transposer à notre époque: a-t-on réellement évolué ou les opprimés sont ils toujours gouvernés par la peur et l’appât du gain? La réponse semble terriblement évidente.
“Train d’enfer” pourrait presque s’apparenter à la recette d’un désastre annoncé. On sait pertinemment que tout cela finira mal, seul le “comment” reste à définir. Dans chaque scène où les camions défaillants déboulent à pleine allure sur les routes sinueuses, le spectre de la mort plane. Des séquences qui ont étonnement plutôt bien vieilli: la réalisation de Cy Endfield est d’apparence classique mais elle traverse les âges efficacement. Le cinéaste va également disposer quelques symboles efficaces dans sa construction, comme le chiffre 13 du camion de Tom ou la piété religieuse de Gino. Le film propose la superstition comme dernier refuge de ceux qui n’ont plus rien à perdre

Il est presque glaçant de constater que “Train d’enfer” reste totalement pertinent dans sa proposition. Ce brulot social intelligemment construit sait jouer de la tension pour emmener avec naturel le spectateur vers une réflexion sociétale poussée.