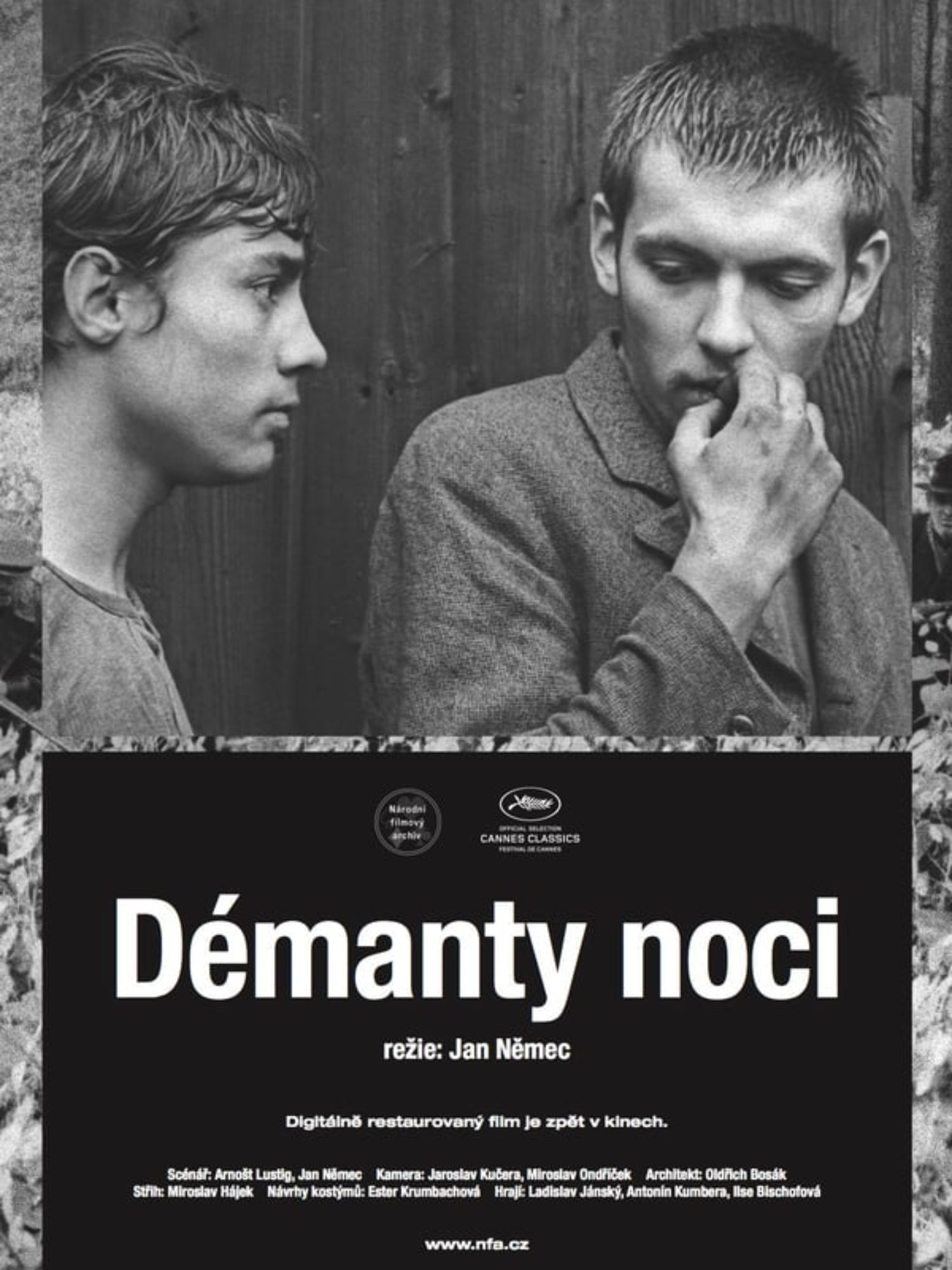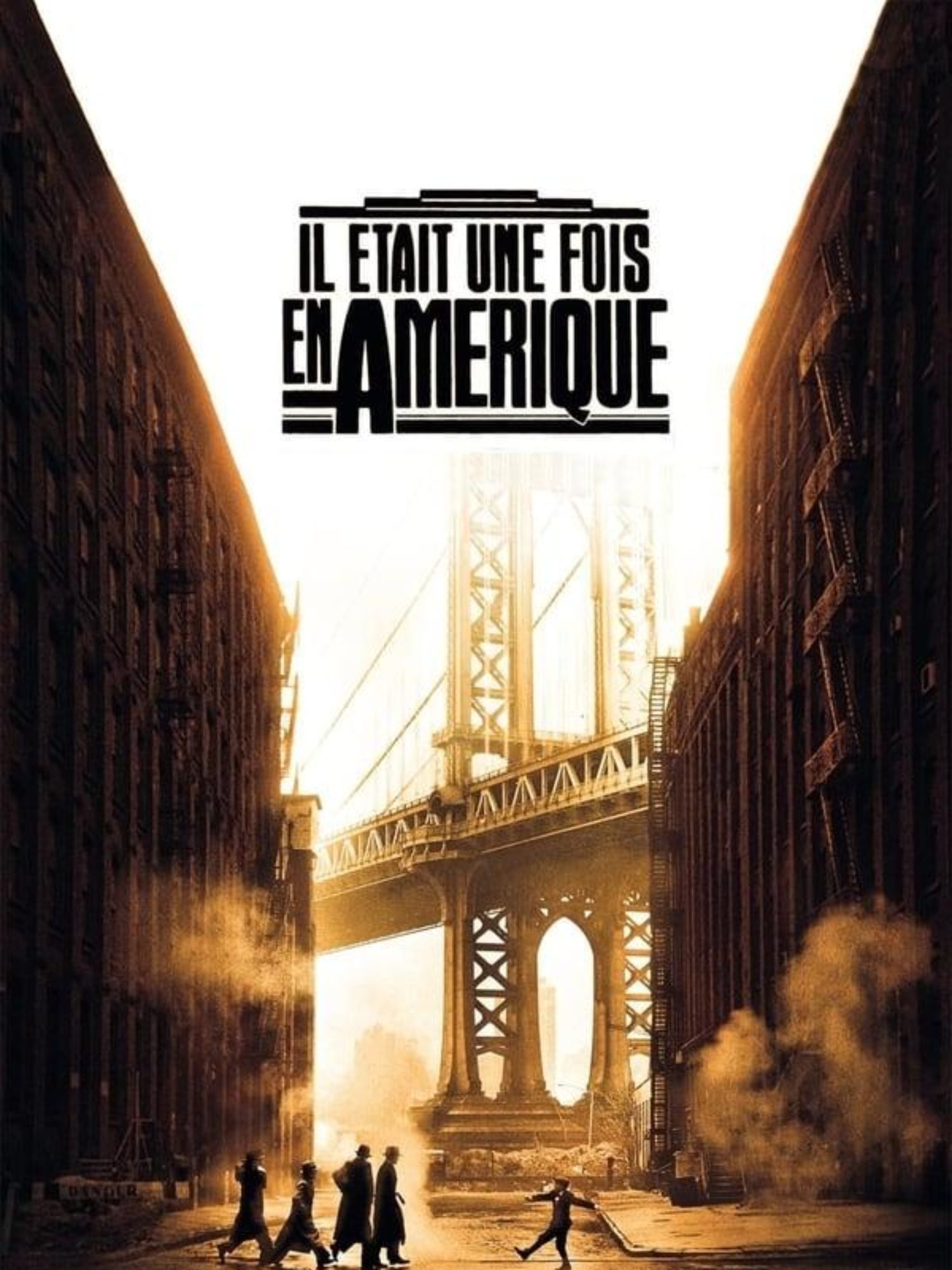(Sanshô Dayû)
1954
de: Kenji Mizoguchi
avec: Kinuyo Tanaka, Yoshiaki Hanayagi, Kyôko Kagawa
Confinement ou non, Les Réfracteurs sont bien décidés à continuer sur leur ligne directrice: à la fois parler d’actu quand elle se présente, mais aussi remettre en lumière des classiques d’autrefois. Une mission d’autant plus importante lorsqu’on parle de cinéma étranger, son accès n’ayant pas toujours été aussi simple qu’aujourd’hui. Alors on se pose en tailleur et on évoque à travers “L’intendant Sansho” un autre maître du cinéma japonais: Kenji Mizoguchi.
On retrouve ici le Japon féodal. Dans ce contexte géopolitique, le film suit le parcours d’une famille de nobles destituée et condamnée à l’exil. On va tout particulièrement s’attarder sur les enfants, Zushiö (Yoshiaki Hanayagi) et Tamaki (Kinuyo Tanaki), séparés du reste de la famille par des marchands d’esclaves et condamnés à une vie de servitude sous le joug du terrible intendant Sansho (Eitarô Shindô).
Au premier niveau de visionnage donc, celui de l’histoire concrète, on se retrouve face à un récit relativement classique, que le cinéma s’est souvent réapproprié pour le transposer à d’autres époques et d’autres lieux. N’oubliez pas les potos qu’on parle d’un film de 1954: des films américains sur l’esclavage, on en a alors encore très peu d’exemples, et le climat est davantage à la ségrégation qu’à la paix sociale.
Un brin précurseur pour offrir un film poignant, Mizoguchi n’est pas en reste visuellement non plus. Sans grande démonstration, il frappe avec précision. Prenons l’exemple de sa gestion de la foule: souvent d’un avis clair et d’une attitude collective unie, c’est là en fait un artifice du cinéaste pour amplifier les sentiments. Un amas d’esclaves qui supplie l’intendant de ne pas marquer au fer un fuyard comme il est horriblement tradition dans cette plantation: c’est sur toute la détresse de ces femmes et hommes qu’on appuie. Une foule qui écoute tête baissée et genou au sol les propos d’un puissant seigneur: c’est là aussi une certaine façon de mettre en lumière la déférence et le respect des tristes bagnards.
Ajoutez à cela une notion du feu et de l’eau plutôt sympa. On ne parle pas de grandes effusions aux cascades furieuses, calmez-vous les barjots, mais de symboliques affirmées. L’eau, parfois comme une frontière idéalisée, parfois comme un artifice funeste dont le calme camoufle des noyés, c’est franchement bien vu. Les flammes d’un brasero qui crépitent, c’est la persécution qu’on symbolise. Point culminant de l’utilisation du feu, les scènes déjà évoquées où les esclaves sont marqués au fer: en cadrant quelques secondes sur les braise brûlante qui chauffe le métal, Mizoguchi peut jouer du hors-champ pendant la torture pour suggérer l’horreur bien plus efficacement que s’il l’avait étalée.

« Un putain de recommandé! »
Mais soyons clair: le contexte du film est peut-être le Japon féodal mais voilà pour nous une oeuvre qui transcende ce status-quo pour continuer à poser de vraies questions sur la notion de travail, qui plus est pénible, dans notre société moderne. Mizoguchi déplace l’époque mais pour parler de toi la caissière! Toi l’éboueur! Toi le facteur! Et ça, dès qu’on commence à aborder le combat de la justice sociale, vous savez que les yeux de vos Réfracteurs s’illuminent.
En se plaçant dans une époque plus codifiée, Mizoguchi schématise la nôtre. Derrière les traits de l’intendant Sansho pourrait se cacher votre patron. La violence physique vous apparaît alors surfaite? Quel chance vous avez! Allez donc demander à quelqu’un qui met en rayon de lourds paquets depuis 40 ans si le travail ne l’a pas marqué comme au fer brûlant.
Dans l’ombre de l’intendant, les puissants. Ceux à qui profite le crime. Ce sont nos politiques et les hauts dirigeants, toujours prompts aux beaux discours mais bien moins loquaces lorsqu’on parle de diminuer les dividendes. Mizoguchine se gêne pas pour les écorcher au passage de sa caméra.
Puis il y a les autres, les esclaves. Nous. D’un côté les serviles, que les coups de fouet ont brisé, uniquement bons à trimer jusqu’à leur dernier souffle. Puis il y a les plus méprisables: ceux qui ont tellement goûté la violence qu’ils n’hésitent pas désormais à l’appliquer aux autres. Ceux qui ont été tellement bien dressés qu’ils deviennent les intermédiaires de Sansho, prêts à en découdre pour protéger leur maître, comme de vulgaires clébards.
Pour casser ce cercle vicieux, Mizoguchi avance une hypothèse qui tient presque du miracle: il construit un personnage, issu de cette misère, élevé socialement, mais prêt à tout sacrifier pour mettre fin à l’abominable. Un personnage volontairement trop beau pour être vrai: la solution individuelle est trop improbable, le cinéaste invite à une réflexion plus collective.

Au premier degré, un récit autour de l’esclavage réussi et prenant. Mais surtout, au second niveau, un brûlot et une caricature sociétale profonde: Mizoguchi fait étalage du talent qui l’a rendu si cultissime.