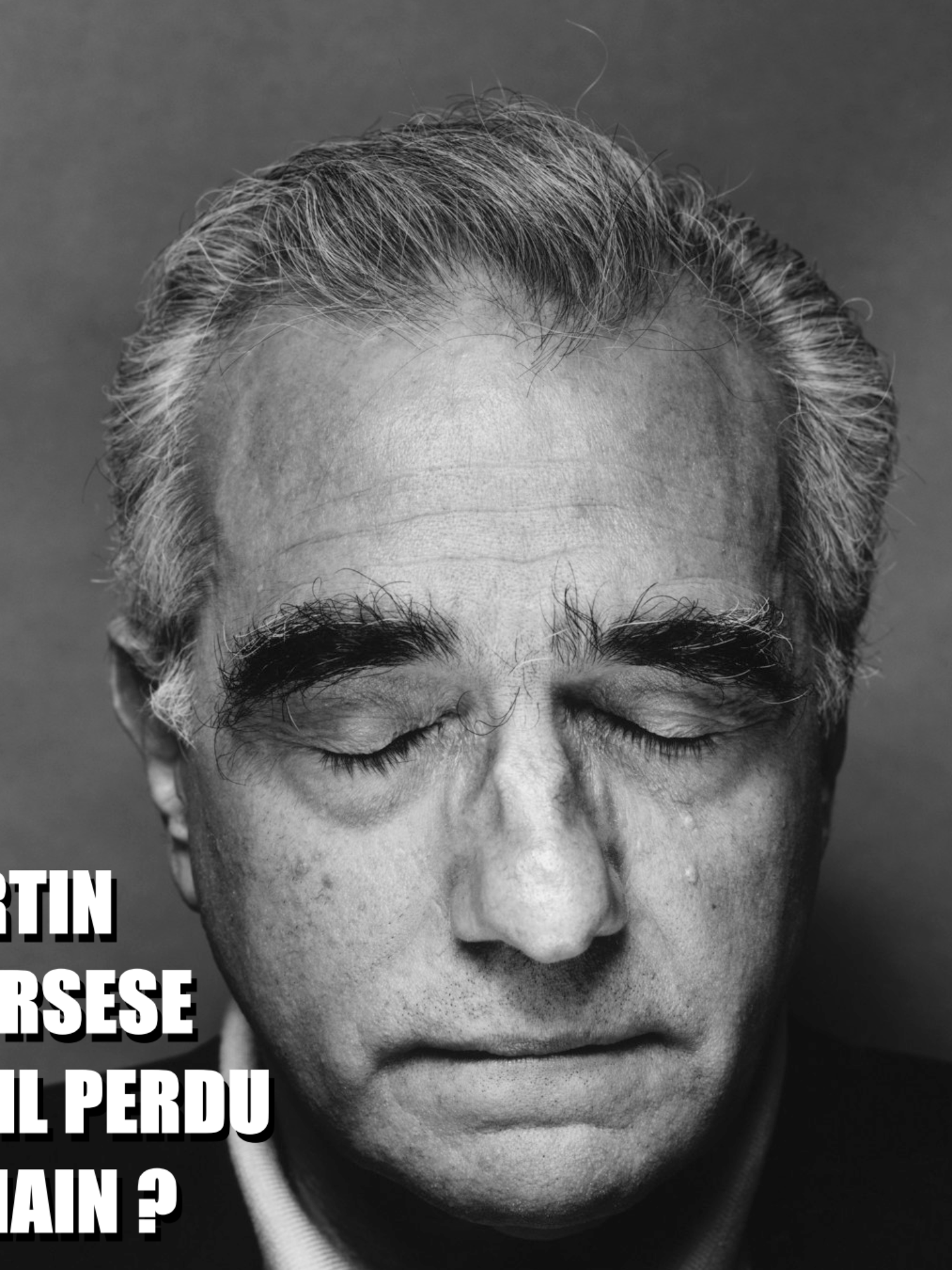(The Hudsucker Proxy)
1994
Réalisé par : Ethan Coen, Joel Coen
Avec : Tim Robbins, Jennifer Jason Leigh, Paul Newman
Film fourni par Elephant Films
Après dix ans de carrière et avec seulement quatre longs métrages à leur actif, les frères Coen atteignent un premier sommet de popularité au début des années 1990. En une poignée de films, le binôme s’est forgé une identité artistique unique, faite d’humour noir et d’audace formelle. Partout dans le monde, les cinéphiles saluent l’avènement de deux auteurs émérites et complices, promis à un destin triomphant. Des louanges qui ont accompagné la diffusion de Sang pour sang à Sundance en 1984, à la prestigieuse Palme d’Or qui récompense Barton Fink en 1991, l’originalité des deux cinéastes est chaleureusement accueillie par la critique et l’industrie courtise ses nouveaux enfants chéris. Les frères Coen jouissent alors d’une liberté presque totale dans l’élaboration de leurs œuvres, de l’écriture du scénario au montage final, et ils mettent à profit cette aisance pour porter à l’écran un projet depuis longtemps en gestation dans leur imagination débridée, mais jusqu’alors impossible à financer. Pour mettre en scène Le grand saut, Joel Silver accorde aux deux cinéastes le plus gros budget de leur carrière, et les frères concrétisent un rêve qui les habitent depuis leurs tout débuts, en étroite collaboration avec leur ami Sam Raimi, co-scénariste et assistant réalisateur sur le film. Le long métrage est un pari économique dont les risques semblent néanmoins calculés, mais la première métamorphose de Joel et Ethan Coen est synonyme de lourd échec commercial. En délaissant le cynisme de leurs débuts pour s’essayer à l’exercice d’une comédie plus légère et optimiste, les artistes dévoilent une autre facette de leur sensibilité artistique annonciatrice de leur futur, mais les spectateurs jusqu’à présent acquis à leur cause peinent à retrouver à l’écran la patte qui les avaient préalablement envouté. Le grand saut déroute et ne rencontre finalement pas son public dans les salles obscures. Seules les longues années qui se sont écoulées depuis la sortie du film en 1994 ont permis sa réhabilitation, car à l’évidence, rarement les frères Coen se seront montrés aussi ambitieux visuellement que dans Le grand saut. La démesure des décors fait écho à la décadence de personnages avares, et le rire potache devient un levier de dénonciation de la bassesse humaine au cœur d’une grande fable galvanisante. Disponible en Blu-ray et DVD chez Elephant Films depuis peu, le long métrage s’apprécie enfin à sa juste valeur et marque une étape cruciale dans la filmographie de deux génies du septième art.

À la suite du suicide du président des industries Hudsucker, le groupe est en pleine déroute. Livrés à eux-même, les membres du conseil d’administration vivent sous la menace de voir les actions de l’entreprise rachetées par les concurrents de la firme au début de la nouvelle année, et s’essayent à toutes les manigances pour conserver leur emprise sur l’empire économique qui règne sur l’Amérique des années 1950. Afin de prendre le pouvoir, le vice président Mussburger (Paul Newman) établit un audacieux stratagème. En nommant un parfait imbécile à la tête du groupe Hudsucker, il espère faire chuter la valeur en bourse de son entreprise, et ainsi s’accaparer les parts à bas prix. En guise de pion, il jette son dévolu sur Norville Barnes (Tim Robbins), un jeune cadre idéaliste, candide et influençable, jusqu’à présent relégué au sous-sol de l’imposant siège administratif de Hudsucker. Contre toute attente, le naïf Norville se révèle à la hauteur de sa tâche, notamment grâce à une invention ridiculement simple qu’il perfectionne depuis des années, le hula-hoop. Néanmoins, l’ivresse de la réussite perverti l’homme de bonne volonté, et l’élu se transforme lentement en nouvel ogre économique, incapable de percevoir l’amour qui s’offre à lui sous les traits de Amy Archer (Jennifer Jason Leigh), une journaliste qui enquête sous couverture au sein de l’entreprise.
Dans l’enfer de bitume et de béton d’un Chicago qui n’est jamais nommé, l’édifice qui tient lieu de siège administratif aux industries Hudsucker jette son ombre despote sur les hommes et les femmes qui s’agitent, dans l’ébullition des rues de la métropole. La bâtisse s’impose au cœur de la cité, apparaît comme une pyramide des temps modernes aux mains des pharaons du capitalisme. L’immeuble est une échelle de mesure de la réussite sociale qui accueille à sa base les prolétaires rendus serviles, et qui réserve le confort de son sommet à une classe dirigeante gargarisée de luxe et de pouvoir. Dans la nuit du quotidien et la grisaille permanente de la ville, le bastion de l’entreprise est un phare vers lequel sont rappelées toutes les âmes, le décor presque unique du film dans lequel s’affairent le patronat, les employés, et les simples observateurs. Hudsucker ordonne les êtres, régit la vie, et dicte jusqu’au rythme des secondes qui s’écoulent, matérialisé par la course des aiguilles de la gigantesque horloge qui orne le fronton de l’édifice, et qui est accompagnée d’un slogan de néon qui fait du futur une possession de l’empire économique. Plus implicitement, l’évocation rapide du “temps Hudsucker” dans le dialogue impose la volonté de l’entreprise comme référentiel des heures et des minutes auxquelles sont soumis les employés. L’Amérique des années 1950 s’est transformée, mais elle a reconstitué un schéma oppressif dissimulé sous le fard de la modernité. Des nouveaux régents se sont substitués aux grands tyrans de l’Histoire, les empereurs et les rois sont devenus directeurs et vice-présidents, mais une même appétence pour l’autocratie accompagne leur gouvernance. Le culte de la personne s’affiche au détour d’un plan qui confronte Norville, conscient de ses errances, à son buste de bronze. L’ancien forçat des bas étages est devenu dictateur des hauteurs, et il doit affronter son image pour vaincre le démon de l’égoïsme. Le lieu opprime l’individu et contraint ses principes brièvement espérés inflexibles. Les personnages du grand saut sont les nouveaux esclaves d’une ère paritaire, synthétisée dans ce microcosme de colonnes de marbre. Les frères Coen multiplient ainsi les judicieux emprunts architecturaux aux représentations iconiques des temples de l’oppression. Le vide occupe une place prépondérante dans la mise en image des deux réalisateurs et l’abysse écrase les protagonistes, mais les évocations esthétiques assumées de Metropolis, Brazil, voire même des constructions des régimes fascistes du siècle passé, ressuscitent le spectre de la barbarie institutionnalisée. Mussburger est le nouveau guide suprême déviant de ce royaume de la servitude. Le sublime Paul Newman, magnifique de vice et de cruauté dans un rôle aux antipodes de sa philosophie de philanthrope, donne corps à l’horreur habilement caricaturée d’une économie de marché qui a renié la vertu humaine. Dans son bureau, le patron est maître du temps, symbolisé par une portion de l’horloge du bâtiment, et de l’espace, illustré par un globe de notre planète qui constitue l’unique ornement de la pièce. Une classe dirigeante qui ne produit rien de concret, prospère à la sueur du front d’un prolétariat souvent invisibilisé. Sur les murs de la salle de réunion, des tableaux montrant des ouvriers acharnés dans leur tâche rappellent au spectateur que les ogres se nourrissent du labeur des plus démunis, pourtant les parvenus ont oublié qu’ils bénéficient du travail de leurs administrés. Il ne sont plus que sinistres punisseurs, prompts à renvoyer pour le moindre prétexte fallacieux, ou sous le simple coups d’une pulsion primaire. Ils récoltent les fruits que d’autres ont cueilli à leur place, et s’en félicitent dans l’opulence de soirées mondaines où se côtoient les actionnaires et autres profiteurs. Tout le cynisme splendide inhérent au cinéma des frères Coen réside dans cette peinture au vitriol d’un monde croqué avec une fausse retenue, et dans la caricature d’une méritocratie inexistante. Pour survivre, le groupe Hudsucker a besoin de récompenser la médiocrité, de promouvoir les incapables et de céder à l’adoration des imbéciles. Le système défaillant s’enrichit consciencieusement de sa propre bêtise. À la lumière de cette représentation savoureusement lunaire de l’idiotie, Le grand saut s’inscrit pleinement dans la filmographie des frères Coen.

Le long métrage prend dès lors des allures d’affrontement entre la sophistication des jeux de manipulation des dirigeants historiques de Hudsucker, et l’extrême simplicité de Norville, d’une pureté émotionnelle navrante de béatitude. Absolument tous les personnages du grand saut sont marqués par une forme assumée d’imbécilité, dans un truculent jeu d’écriture scénaristique qui fait du film une farce au sens théâtral. Néanmoins, une approbation idéologique est conférée au protagoniste, inconscient de sa sottise mais animé de nobles idées, face à des manipulateurs qui ourdissent leur complot par appât du gain. Le héros des frères Coen est un lointain héritier de ceux de Frank Capra, une même sagesse du cœur l’habite. Norville n’est pas né dans la cité des hauts immeubles, il est un provincial venu sur ce qu’il croit être la terre promise du mérite, comme le personnage principal de Monsieur Smith au Sénat. Il est sans cesse nostalgique de son village natal, dans de nombreuses séquences qui servent de support à l’humour euphorisant du film, mais qui traduisent également la volonté des frères Coen de forcer la rencontre improbable entre la ruralité et les grandes métropoles de la côte Est américaine. Les États-Unis des années 1950 sont divisés, une partie de la nation est encore innocente dans le sérail des campagnes, et une autre moitié du pays est déjà pervertie par l’essor de nouveaux rythmes de vie irraisonnés. Hypnotisée par les cadences robotiques d’existences blafardes, les hommes ont perdu leur capacité à s’émerveiller de la simplicité de ce qui les entoure, et ont fait le deuil d’une partie de leur altruisme. Le grand saut fait du projet de hula-hoop de Norville un gag, exprimé par les croquis industriels qu’il produit et qui ne montre à l’écran qu’un simple cercle sur des feuilles de papier. Pourtant le protagoniste témoigne ainsi d’un souci d’apporter de la joie aux plus jeunes générations mais aussi d’une faculté à percevoir et à transformer les motifs basiques présents dans son environnement. Sans discontinuer, le long métrage reproduit pléthore de formes rondes, présentes à travers l’horloge du siège de Hudsucker, le monocle du président du groupe, la trace d’une tasse de café qui encercle l’annonce d’emploi providentielle de Norville, et même l’auréole d’un ange. Le protagoniste est hilarant de candeur, mais il détient une part de sagesse issue de son regard simplet sur la vie. Il est le créateur dévoué au bonheur des autres, contre les pourvoyeurs du malheur. Dans un monde vertical, lui seul s’élève des bas-fonds aux hautes sphères. Les rapports de domination sont figés dans Le grand saut, seule la chute vers le trottoir est possible, mais Norville se démarque en étant l’unique personnage qui s’élève dans les étages de l’immeuble. Il connaît une ascension tout aussi fulgurante que la dégringolade suicidaire du président de Hudsucker, selon un principe de vases communicants scénaristique astucieux. Il est également l’unique garant d’une spiritualité, qui se heurte ostensiblement au pragmatisme délétère des citadins. Le dollar est le nouveau Dieu d’un monde ivre de profit, les télégraphes débitent les cours de la bourse comme une nouvelle Bible, mais Norville continue quant à lui de rêver à l’après vie, à la réincarnation, et communique même avec les esprits au terme d’un dénouement hautement mystique. Néanmoins, Le grand saut refuse de déifier cet apôtre de l’émotion, pris dans la tempête de l’arrivisme. La corruption née d’une position de pouvoir gangrène tous les hommes et le protagoniste ne peut pas se soustraire à cette fatalité. Si le long métrage est compatissant avec le personnage principal, et si Norville se rend rapidement compte de ses erreurs, une phase inévitable de séduction du luxe étreint son être. Les illusions de grandeurs privent tous les hommes de leur dignité mais les repentis peuvent atteindre l’illumination.
L’immobilisme qui marque le monde du travail n’est brisé que par un extraordinaire concours de circonstances, sans lequel l’évolution de rapport d’employeurs à employés vers une plus grande parité, est rigoureusement impossible. Avant l’avènement du messie de l’innocence, le domaine de l’entreprise est un enfer de sueur et d’effort, un temple démoniaque qui crache son étouffante fumée dans les sous-sol où s’affairent les préposés au tri postal. Épreuve des corps et cadence des machines omniprésentes à l’écran ne font plus qu’un, et privé de toute vue vers l’extérieur, l’homme n’a plus que la servitude comme horizon. Après des années de travail, un employé qui distribue les lettres ne nourrit que l’espoir absurde de devenir responsable des colis. À nouveau, le rire est l’instrument de la satire, les personnages du grand saut sont des clowns tristes, tragicomiques par nature. L’effort est vain, l’acceptation de nouvelles responsabilités n’est accompagnée d’aucune contrepartie salariale, elle est même un péril potentiel. Lors de l’apparition d’une “Lettre bleu”, réservée à la communication entre directeurs du groupe industriel, tous les prolétaires ont conscience que le messager peut être tué d’un renvoi et il convient de se cacher pour se dérober à la colère patronale injuste. Le grand saut pose un regard désabusé sur les années 1950 qui ont vu se consolider les grands empires financiers, après l’âge de la guerre et des privations. Le monde du travail est dépeint comme hautement concurrentiel et avec une acidité diaboliquement perverse, le film dénonce une privation de la considération humaine, au bénéfice d’un effroyable système sociétal qui rend chaque employé remplaçable en quelques secondes. Face à un tableau d’offres d’emploi, au mécanisme rigoureusement similaire à celui qui annonce l’arrivée des trains dans une gare, les chômeurs ne sont que les passagers impuissant d’un wagon prompt à dérailler. Il n’existe aucune récompense au travail habilement effectué, seule la flatterie permet une maigre considération. Le peuple s’échine pour survivre, tandis que dans les hauteurs, la cour du roi Mussburger exerce son pouvoir sans considération humaine. Le grand saut reproduit à l’exact le modèle monarchique en métamorphosant un liftier en bouffon apte à se moquer de tous. Pour cette classe dirigeante déconnectée des aspirations et angoisses des plus démunis, le blagueur est une fenêtre tronquée sur un monde interdit. La seule rencontre concrète entre le patronat et le prolétariat ne peut se conclure que dans le sang. Au sommet de leur tour d’ivoire, les nouveaux régents sont voués à choir de leur piédestal pour se heurter à la vérité du trottoir. Si le président Hudsucker est le seul à se donner la mort en sautant du haut de l’immeuble, le long métrage réitère à de très nombreuses reprises des tentatives avortées de pareil suicide. La chute est l’unique issue, la violence du choc une fatalité presque inexorable. Une ombre macabre plane sur un récit fait d’incessantes évocations de mort, physique ou spirituelle, et en épousant l’humour noir de circonstance aux moments opportun, les frères Coen poursuivent leur exploration de la duplicité humaine maquillée en cynisme. Norville est l’unique chevalier blanc du grand saut, la seule incarnation d’une forme de compassion naturelle, qui se meut en amour pour Amy. L’homme de vertu à transformé de son innocence le coeur de la femme pragmatique en quête de vérité. Le rêve a transcendé la réalité pour tracer une nouvelle voie, et les deux auteurs du film se laissent eux aussi gagner par la candeur de leur protagoniste en bénissant l’union de leurs personnages.

Le grand saut est alors une lutte sans merci entre la froideur et l’austérité d’un monde prisonnier de ses dysfonctionnements, et l’envie profonde de croire en la bonté de l’être humain. Les frères Coen replacent l’individu et l’amour au cœur des grandes foules de la cité, avec perte et fracas, mais aussi un profond optimisme. Norville réveille le cœur endormi d’Amy, et la journaliste est un indispensable rappel à l’ordre de la vertu morale pour le nouveau dirigeant. Les réalisateurs maîtres de leur récit s’approprient leur œuvre et la signent en s’abandonnant à plusieurs Deus Ex Machina, parfaitement volontaires, et toujours incarnés par des hommes simples et sans pouvoir qui exercent leur influence par inadvertance ou par le biais d’une envolée fantastique. Suspendu dans le vide, Mussburger ne doit ainsi son salut qu’à la considération d’un tailleur qui a confectionné son pantalon à l’aide d’une double couture, alors que le vice-président l’avait refusé pour minimiser le prix de ses vêtements. L’altruisme a sauvé une vie, et en accord avec la filmographie des deux cinéastes, une action anodine à des répercussions essentielles sur le long métrage. Beaucoup plus ouvertement, et dans une somptueuse saillie poétique, le temps et les hommes s’arrêtent totalement lorsque l’employé préposé à l’entretien de l’horloge de l’immeuble Hudsucker entrave les engrenages de la machine, sauvant par la même occasion Norville d’une chute mortelle. Les invisibles deviennent actifs, tels des divinités hors du commun au centre d’une épopée qui se déguise brièvement en conte de Noël. Une société entière gravite autour de l’entreprise Hudsucker. Les mondes de la presse, de l’art et même de la médecine se mettent au diapason des nouveaux dépositaires du pouvoir américain, mais avec une pointe d’anarchisme, Le grand saut impose la fantaisie en idéal. Majoritairement marqué par des teintes grises, le long métrage est inopinément griffé de la couleur des cerceaux de hula-hoop, expression d’une joie primaire enfantine face aux entraves des adultes. Les frères Coen nourrissent un regard sombre sur la modernité, mais plus que tout, ils veulent croire à la bonté qui réside dans le cœur de chacun.

Injustement incompris à sa sortie, Le grand saut apparaît aujourd’hui comme une œuvre charnière dans la carrière de deux prodiges de l’écriture et de la caméra. La malice du scénario et l’ambition visuelle démesurée sublime un film optimiste et galvanisant.
Le grand saut est disponible en combo Blu-ray / DVD, chez Elephant Films, avec en bonus :
- Le Film par Frederic Mercier
- Bandes-annonces
- Jaquette réversible
- Livret Collector 24 pages – Le Grand Saut Un film d'(h)auteur des frères Coen – par David Mikanowski